![[Idées lecture ] Les meilleurs livres de la littéraire américaine contemporaine](https://www.letournepage.com/wp-content/uploads/2019/01/z9862114QPolki-nie-musza-zawsze-wygladac-tak-samo-rowne-rz.jpg)
.
Depuis plusieurs décennies, la qualité, la richesse et la diversité de la littérature américaine est incomparable.
« Houlà ! », allez-vous me dire. « Que voilà une affirmation bien péremptoire ! Et que dire de la littérature française (anglaise/espagnole/italienne/japonaise : rayez les mentions inutiles) ?! »
Et je vous répondrai : « Ben oui, mais non ! Si de l’autre côté de la manche, il y a de très grands auteurs, indubitablement, la production britannique n’arrive pas à la cheville (aux genoux ? au nombril ? à l’épaule ?) de son homologue U.S. Quant aux autres pays évoqués… on passe à autre chose ? » Mais après tout, c’est normal : 325 millions d’habitants, 9 millions de km², les Etats-Unis, pays d’immigration multiethnique, est un monde, un gisement de talents incomparable
Ceci dit, que retenir de la production américaine depuis la seconde guerre mondiale (c’est le critère que j’ai pris en compte pour définir le terme « contemporain ») ?
La très large sélection – près d’une centaine de romans ! – que je présente ici (établie en fonction de plusieurs thèmes) est, malgré ses dimensions, tout sauf exhaustive. Elle correspond à mes lectures – nombreuses-, à mes goûts – éclectiques -, à mes rejets de certaines réputations bien établies (pas de noms, par charité !).
A vous de voir si, au fil de vos découvertes, mes goûts s’approchent des vôtres. C’est le propre de ce site : Le Tourne Page, c’est le cri d’amour sincère d’un lecteur aux livres !
Romans de l’Amérique des grandes villes, romans des grands espaces et de l’Amérique profonde, romans noirs, romans fantastiques, romans de SF : il y en a pour tous les goûts.
NB : cette sélection comporte également quelques romans écrits par des auteurs canadiens.
*
Romans américains : la richesse d’un monde*
– Cliquez sur la couverture du livre pour accéder à la page Amazon afin de l’acquérir,
ou sur le lien « Lire la suite » pour accéder à la critique complète du livre –
Rappel : le modèle économique du Tourne Page repose sur le principe de l’affiliation. En cliquant sur le lien permettant d’accéder au partenaire du Tourne Page, Amazon, pour acquérir un livre conseillé, le visiteur permet au Tourne Page de percevoir une commission sur le chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire.
Le Tourne Page a été créé pour la promotion du livre et de la lecture. Pour que l’entreprise puisse vivre et prospérer (elle représente un investissement en temps quotidien considérable) mais aussi pour qu’elle garde son indépendance, il est essentiel que les visiteurs passent par ces liens pour acheter les livres qu’ils ont identifiés sur le site.
*
Les romans de l’Amérique moderne et des grandes villes
Trust – Hernan Diaz (2022)
Editions de l’olivier – 400 pages – 23.50 €
Le pitch : Wall Street traverse l’une des pires crises de son histoire. Nous sommes dans les années 1930, la Grande Dépression frappe l’Amérique de plein fouet. Un homme, néanmoins, a su faire fortune là où tous se sont effondrés. Héritier d’une famille d’industriels devenu magnat de la finance, il est l’époux aimant d’une fille d’aristocrates. Ils forment un couple que la haute société new-yorkaise rêve de côtoyer, mais préfèrent vivre à l’écart et se consacrer, lui à ses affaires, elle à sa maison et à ses oeuvres de bienfaisance.
Tout semble si parfait chez les heureux du monde… Pourtant, le vernis s’écaille, et le lecteur est pris dans un jeu de piste. Et si cette illustre figure n’était qu’une fiction ? Et si derrière les légendes américaines se cachaient d’autres destinées plus sombres et plus mystérieuses ?
Mon avis : Trust : jolie couverture graphique, et surtout joli titre pour un récit qui a obtenu en 2023 le prestigieux prix Pulitzer.
Car, si le mot, en langage quasi universel, renvoi au capitalisme, sujet (trop) évident du roman d’Hernan Diaz, il a également une double signification, toute autre, en anglais.
Car Trust, pour nos amis anglo-saxons, c’est aussi le vocable correspondant à « confiance » en français. Et la confiance, c’est tout le sujet viscéral du roman. Et c’est ce qui le rend assez unique.
Lorsque le dernier arbre – Michael Christie (2021)
Le livre de poche – 672 pages – 9.90 €
Le pitch : 2038. Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la planète en un désert de poussière. L’un des derniers refuges est une île boisée, au large de la Colombie-Britannique, qui accueille des touristes fortunés venus admirer l’ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme guide, sans véritable espoir d’un avenir meilleur. Jusqu’au jour où un ami lui apprend qu’elle serait la descendante de Harris Greenwood, un magnat du bois à la réputation sulfureuse.
Commence alors un récit foisonnant et protéiforme dont les ramifications insoupçonnées font écho aux événements, aux drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été abattu ?
Mon avis : Lorsque le dernier arbre n’est pas un très bon titre, même s’il attire le chaland, car le titre original de ce roman canadien anglophone est Greenwood (Le bois vert) qui, lui, colle exactement avec le sujet et les personnages ce livre exceptionnel, que je ne risque pas d’oublier de sitôt.
Le récit démarre dans un proche futur, où une catastrophique écologique d’ampleur planétaire a détruit quasiment tous les arbres et, du même coup, ruiné la civilisation humaine.
Avec ça, on pourrait penser qu’il ‘agit d’un roman de SF écologique… mais pas du tout ! Car, rapidement, grâce à la plume incroyablement mature et affutée de Michael Christie (dont c’est le premier roman), nous allons plonger dans le passé.
L’hôtel de verre – Emily St. John Mandel (2020)
Rivages/noir – 444 pages – 10.50 €
Le pitch : Au milieu d’une nature sublime, un hôtel de luxe comme une tentation mortifère. Inspirée par l’escroquerie de Bernard Madoff, Emily St. John Mandel raconte le point de bascule des vies de ses personnages dans un suspense sous hypnose.
« Et si vous avaliez du verre brisé ? » Comment cet étrange graffiti est-il apparu sur l’immense paroi transparente de la réception de l’hôtel Caiette, havre de grand luxe perdu au nord de l’île de Vancouver ? Et pourquoi précisément le soir où on attend le propriétaire du lieu, le milliardaire américain Jonathan Alkaitis ? Ce message menaçant semble lui être destiné. Ce soir-là, une jeune femme prénommée Vincent officie au bar ; le milliardaire lui fait une proposition qui va bouleverser sa vie.
Mon avis : Tout ceux qui, ces dernières années, ont croisé sur leur route de lecture le roman Station eleven savent qu’Emily St. John Mandel est une auteure qui compte désormais dans le paysage de la littérature anglosaxonne (voir ma critique ailleurs sur le site). Avec L’hôtel de verre, l’auteure canadienne confirme qu’elle doit être considérée comme une des meilleures plumes contemporaines sévissant de l’autre côté de l’Atlantique.
Dans cet impressionnant récit, aussi touffu et complexe que Station eleven, Emily (appelons la par son prénom, sinon c’est trop compliqué !) embarque le lecteur vers une destination inconnue.
Les cygnes de la cinquième avenue – Melanie Benjamin (2016)
Le livre de poche – 480 pages – 8.20 €
Le pitch : Babe Paley est la plus en vue des Cygnes de la Cinquième Avenue, ces femmes de la haute société new-yorkaise des années 1950. Son atout indéfinissable : son style. Elle incarne l’élégance, fait souvent la une de Vogue, mais ce que personne ne voit, c’est le sentiment de solitude qu’elle laisse dans son sillage, en dépit de sa fortune, de ses enfants, de son mari riche et puissant.
Jusqu’au jour où Truman Capote surgit dans sa vie. Leur amitié est instantanée et fulgurante. Babe trouve chez l’écrivain prodige, aussi génial qu’extravagant, la passion qui manquait à son existence. Grâce à elle, Truman accède à cette élite qui le fascine tant. Et à ses secrets, ses rumeurs, ses scandales, y puisant son inspiration, au risque de trahir Babe.
Mon avis : Depuis le début du siècle, la mode au cinéma est aux biopics, ces films tournés autour de la vie d’une personne célèbre, artiste, personnage historique. Le réalisateur a le choix entre deux méthodes : soit dérouler chronologiquement la biographie du sujet, soit réinventer sa vie au travers d’un prisme de lecture spécifique.
Quelle que soit la méthode retenue, j’avoue être la plupart du temps dubitatif face au résultat obtenu, surtout si je connais vraiment bien le personnage central. Malheureusement, cette mode est en train de gagner la littérature. Au point que nos amis critiques ont créé un néologisme pour qualifier le genre : l’exofiction !
Au cours de ces trois dernières années, combien de « romans » écrits à partir d’une célébrité ? Des dizaines, tous moins intéressants les uns que les autres (ce commentaire n’engage que moi, bien entendu). Un mouvement révélateur, à mon avis, de la pauvreté d’inspiration des auteurs contemporains…
En découvrant le pitch des Cygnes de la cinquième avenue, je me suis dis que Mélanie Benjamin avait sacrifié à cette nouvelle mode. Mais la jolie couverture vintage, et le sujet de ce biobook (Truman Capote ? un des plus grands auteurs américains du siècle dernier, à n’en pas douter !), si je puis utiliser ce néologisme, m’ont convaincu d’y jeter un œil. Bien m’en a pris, car c’est sur un véritable roman coup de cœur que je suis tombé, incapable que j’ai été de lâcher le livre avant d’en avoir parcouru les presque 500 pages !
La chute des princes – Robert Goolrick (2014)
10/18 – 240 pages – 6.60 €
Le pitch : New York, années 1980. Robert Goolrick nous invite au bal des vanités, où une bande de jeunes hommes vont vendre leur âme au dollar et se consumer dans une ronde effrénée, sublime et macabre. Ils ont signé pour le frisson, une place sur le manège le plus enivrant que la vie ait à leur offrir. Et ces princes vont jouer toute la partie : les fêtes, les drogues, l’alcool, les corps parfaits des deux sexes, les pique-niques dans la vaisselle de luxe, les costumes sur mesure taillés par des Anglais dans des tissus italiens, les Cadillac, le sexe encore et toujours, les suites à Las Vegas, des morts que l’on laisse en chemin mais pour lesquels il n’est pas besoin de s’attarder parce qu’on va les retrouver vite.
Vite, toujours plus vite, c’est la seule règle de ce jeu. Aller suffisamment vite pour ne pas se laisser rattraper. Parce que les princes sont poursuivis par de terrifiants monstres : le sida, les overdoses, le regard chargé de honte de leurs parents, le dégoût croissant de soi-même, un amour s’excusant de n’avoir sauvé personne.
Mon avis : Quand on lit La chute des princes (découvert par pure curiosité, pour la beauté de la photo de la couverture, en édition format poche), on ne peut s’empêcher de faire des rapprochements avec plusieurs livres célèbres.
Un rapprochement, de prime abord, avec le Loup de Wall Street, le récit sidérant et véridique d’un trader qui, au sommet de la bulle financière américaine du début du siècle, part dans tous les excès : argent, fêtes, drogues, sexe. Cela se terminera très mal, comme dans celui-ci.
Mais l’immense différence entre les deux romans tient – outre l’époque (nous sommes ici dans les années 80) – dans l’intention.
Mrs Hemingway – Naomi Wood (2014)
Folio – 352 pages – 8.00 €
Le pitch : Ernest Hemingway était un homme à femmes. Mais il ne se contentait pas d’enchaîner les histoires. Ses maîtresses, il en a fait des Mrs Hemingway. Ainsi la généreuse Hadley Richardson a-t-elle été remplacée par la très mondaine Pauline Pfeiffer, et l’intrépide Martha Gellhorn par la dévouée Mary Welsh, au fil d’un scénario qui ne variait que de quelques lignes : la passion initiale, les fêtes, l’orgueil de hisser son couple sur le devant de la scène, puis les démons, les noires pensées dont chacune de ses femmes espérait le sauver.
Naomi Wood se penche sur la figure d’un colosse aux pieds d’argile, et redonne la voix à celles qui ont sacrifié un peu d’elles-mêmes pour en ériger le mythe.
Mon avis : Haldley, Fife, Martha. Mary. Quatre prénoms féminins. Ceux des quatre femmes qu’Ernest Hemingway épousera, au fil de sa vie aventureuse, des Etats-Unis à la France, l’Espagne, les îles… Ceux des quatre parties du très beau roman de Naomi Wood, une jeune auteure a qui je prédis une bien belle carrière, pour autant qu’elle maintienne le cap sur l’exigence thématique et stylistique dont elle a su faire preuve ici.
Mrs Hemingway est un roman d’exofiction, genre éminemment à la mode. Il faut dire que broder un texte d’imagination autour d’un ou plusieurs personnages célèbres ayant réellement existé est séduisant. Après tout, la trame scénaristique est déjà là : il suffit de broder autour, pensent nombre d’auteurs.
Et pourtant, il n’y a rien de plus casse-gueule que de réinventer le réel, et la très large majorité des romans d’autofiction sont totalement décevants. Ce n’est pas le cas pour Mrs Hemingway. Au contraire : Naomi Wood m’a totalement convaincu, et même séduit.
Un pays à l’aube – Dennis Lehane (2008)
Rivages/noir –864 pages – 10.65 €
Le pitch : Septembre 1918. L’Amérique se remet difficilement de la Première Guerre mondiale. L’économie est ébranlée, l’inflation fait des ravages. Les luttes syndicales fleurissent, les groupes anarchistes et les premiers mouvements de défense de la cause noire prospèrent.
Luther Laurence, jeune ouvrier noir, est amené à disputer une partie de base-ball face à l’étoile montante Babe Ruth, une expérience qu’il n’oubliera jamais. L’agent de police d’origine irlandaise Danny Coughlin, est chargé par le lieutenant McKenna d’infiltrer les milieux syndicaux et anarchistes de Boston pour repérer, puis expulser les « fauteurs de troubles ».
Tandis que Luther fuit son passé, Danny cherche désespérément le sens de sa vie présente, en rupture avec le clan familial. Dans une ville où gronde la révolte, la grève des forces de police va mettre le feu aux poudres.
Mon avis : Dennis Lehane est, depuis maintenant de nombreuses années, un des auteurs majeurs du polar américain contemporain (je vous invite d’ailleurs à lire l’intégralité de son oeuvre, que je chroniquerai peu à peu sur le site). Mais avec Un pays à l’aube, publié en 2010, l’auteur change carrément de braquet et de dimension, l’oeuvre romanesque qu’il livre est d’une très grande ambition… et le résultat est à la hauteur de l’ambition !
Soyons franc, direct et catégorique : ce roman doit être considéré comme une oeuvre majeure de la littérature américaine de ce nouveau siècle ! Mais qu’est-il arrivé à Lehane ? La réponse est simple : il est tout simplement passé de l’écriture de romans racontant des histoires, à une fresque romanesque racontant l’Histoire, avec un grand H.
Les bâtisseurs de l’empire – Thomas Kelly (2007)
Rivages/Noir – 590 pages – 9.65 €
Le pitch : Michael Briody, immigré irlandais déchiré entre son désir de refaire sa vie en Amérique et sa loyauté envers la cause républicaine dans sa patrie, s’échine sur le chantier pharaonique de l’Empire State Building.
Par la mafia irlandaise, il rencontre Grace, dont il s’éprend. Mais Grace appartient à Johnny Farrell, relais du maire de New York auprès de la douteuse machine du parti démocrate. Plus l’Empire State s’élève vers le ciel, plus Briody prend conscience que ses fondations reposent sur un bourbier d’argent sale…
Mon avis : Thomas Kelly (né en 1961) est un auteur quasiment inconnu en France, et je me demande encore pourquoi la notoriété ne s’est pas abattue sur lui comme cela aurait dû. Peut-être est-ce dû au fait qu’il n’a publié que trois romans, le dernier (celui-ci) datant de 2005 ?
Kelly, c’est – sous un format et une toile de fond relativement proches du roman policier – l’Irlande à New York, c’est l’histoire de New York, c’est l’Amérique, quoi !
Achetez ce roman (pas si facile que ça à trouver, d’ailleurs !) et plongez dans ce récit merveilleux sur toile de fond historique, la construction de l’Empire State Building, racontée de manière absolument extraordinaire !
Le temps où nous chantions – Richard Powers (2003)
Cherche Midi / 10/18 – 1 056 pages – 11.10 €
Le pitch : En 1939, lors d’un concert de Marian Anderson, David Strom, un physicien juif allemand émigré aux États-Unis pour fuir les persécutions nazies, rencontre une jeune femme noire, Delia Daley. Ils se marient et élèvent leurs trois enfants dans le culte exclusif de la musique, de l’art, de la science et de l’amour universel, préférant ignorer la violence du monde autour d’eux.
Cette éducation va avoir des conséquences diverses sur les trois enfants. Jonah devient un ténor de renommée mondiale, Ruth va rejeter les valeurs de sa famille pour adhérer au mouvement de Black Panthers, leur frère Joseph tentera de garder le cap entre l’aveuglement des uns et le débordement des autres, afin de préserver l’unité de sa famille en dépit des aléas de l’histoire.
Élu meilleur livre de l’année 2003 par The New York Times et The Washington Post.
Mon avis : Prodigieux roman d’un auteur que j’ai découvert par cette porte exceptionnelle. La richesse de ce livre est telle qu’il est difficile de mettre en avant ce qui est le plus remarquable.
Je parlerais avant tout, du style, tout à fait exceptionnel, une plume d’un classicisme parfait. Un style tenu, très neutre, mais capable de faire passer les sentiments les plus puissants grâce à la richesse de sa composition.
Après, il y a les thèmes principaux, placés en strates complexes tout au long de ce très long roman (plus de 1 000 pages en poche !), le premier étant la question de l’acceptation de l’autre et du métissage aux États-Unis. Le second, c’est le rôle de la musique dans la vie humaine.
On ressort de ce livre bouleversé, le cerveau et le cœur en ébullition tant Richard Powers a su vous impliquer dans toutes les thématiques évoquées.
La poursuite du bonheur – Douglas Kennedy (2001)
Pocket – 588 pages – 8.50 €
Le pitch : Manhattan, Thanksgiving 1945. Artistes, écrivains, musiciens… tout Greenwich Village se presse à la fête organisée par Eric Smythe, dandy et dramaturge engagé. Ce soir-là, sa soeur Sara, fraîchement débarquée à New York, croise le regard de Jack Malone, journaliste de l’armée américaine.
Amour d’une nuit, passion d’une vie, l’histoire de Sara et Jack va bouleverser plusieurs générations. Un demi-siècle plus tard, à l’enterrement de sa mère, Kate Malone remarque une vieille dame qui ne la quitte pas des yeux. Coups de téléphone, lettres incessantes… Commence alors un harcèlement de tous les instants. Jusqu’au jour où Kate reçoit un album de photos… La jeune femme prend peur : qui est cette inconnue ? Que lui veut-elle ?
Mon avis : Vous n’avez jamais lu Douglas Kennedy, vous ne faites pas partie de la cohorte de lecteurs qui, durant des années, ont dévoré -à juste raison – tous ses premiers livres ? Quel dommage ! Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire…
Ne partez surtout pas sur l’idée préconçue que cet auteur américain d’origine, mais français de cœur est un auteur grand public, dans le mauvais sens du terme, celui qui induit le fait que plus que c’est grand public, plus c’est facile et mal écrit. Car Kennedy n’est pas de la dimension de certains auteurs dont je tairais le nom pour ne pas les offenser, qui publient chaque année à date fixe un roman « à suspens » (vous voyez de qui je veux parler) ou un roman « d’amour » (là, aussi, pas la peine de mettre un nom), qui ne possède ni fond, ni forme.
S’il a su conquérir le public français, au fil du temps, c’est parce que quasiment tous ses premiers romans sont formidables. La poursuite du bonheur fait partie de ceux-là.
Le récital des anges – Tracy Chevalier (2001)
Folio – 448 pages – 9.70 €
Le pitch : Londres, janvier 1901 : la reine Victoria vient de mourir. Comme la coutume l’impose, les familles se rendent au cimetière. Leurs tombes étant mitoyennes, les Waterhouse et les Coleman font connaissance et leurs petites filles se lient immédiatement d’amitié. Pourtant, les familles n’ont pas grand-chose en commun. L’une incarne les valeurs traditionnelles de l’ère victorienne et l’autre aspire à plus de liberté.
Dans le cimetière, véritable coeur du roman, Lavinia et Maude se retrouvent souvent et partagent leurs jeux et leurs secrets avec Simon, le fils du fossoyeur, au grand dam de leurs parents. Lavinia est élevée dans le respect des principes alors que Maude est livrée à elle-même : sa mère, Kitty Coleman, vit dans ses propres chimères. Ni la lecture, ni le jardinage, ni même une liaison ne suffisent à lui donner goût à la vie. Jusqu’au jour où elle découvre la cause des suffragettes. La vie des deux familles en sera bouleversée à jamais.
Mon avis : Le récital des anges est, pour moi, peut-être le meilleur roman de Tracy Chevalier.
Une histoire familiale subtile, touchante, avec des personnages auxquels on s’attache (les histoires enfantines sont toujours porteur ses d’émotions, pour peux qu’on prenne le soin d’éviter la facilité), doublé d’une analyse sociologique intéressante.
Et une toile de fond historique absolument passionnante. J’avoue avoir découvert, au détour des pages de ce roman, des détails absolument étonnants sur un sujet que je pensais pourtant connaître un peu.
Le ventre de New York – Thomas Kelly (1998)
Rivages/Noir – 469 pages – 10.60 €*
Le pitch : Les frères Adare ont grandi dans une famille ouvrière du Bronx. A la mort du père, Paddy Adare est élevé par son oncle et devient le bras droit d’un chef de gang irlandais. Son frère Billy suit une autre voie et entre à l’université. Pour financer ses études, il travaille au creusement d’un tunnel qui doit alimenter la ville de New York en eau potable. Deux itinéraires, deux mondes incompatibles qui vont s’affronter.
Mêlant étroitement fiction et réalité, Thomas Kelly dépeint l’univers hallucinant des tunnels où des hommes-taupes creusent au péril de leur vie, un univers qu’il a côtoyé de près pour y avoir lui-même travaillé.
Mon avis : Le ventre de New York est le premier des – seulement – trois romans écrits par Thomas Kelly au cours des vingt dernières années (quel dommage que sa productivité soit si faible !). Et, dès le premier roman, le lecteur sait qu’il a affaire à un auteur exceptionnel, que je ne saurais mieux comparer qu’à un Dennis Lehane doté d’une fibre particulièrement sociale.
Kelly, comme tout grand auteur américain de romans noirs, se nourrit de ses origines et de ses expériences. Il est irlandais – on s’en doutait un peu avec un nom pareil ! – et ses personnages principaux le sont aussi (il y a donc beaucoup de flics parmi eux !). Il a travaillé dans le bâtiment, et ses héros sont des ouvriers – mineurs de fond pour construire une canalisation d’alimentation en eau ici, constructeurs de gratte-ciel dans Les bâtisseurs de l’empire.
Il a passé son enfance et sa jeunesse et son adolescence dans le Bronx, et ses romans sont autant de plongées hyper réalistes dans le New York populaire. Irlandais, manœuvres, flics et voyous, New York… voilà de quelle chair sont composés les romans rares et les rares romans de Thomas Kelly. Et le résultat est assez exceptionnel.
Les heures – Michael Cunningham (1998)
10/18 – 224 pages – 7.10 €
Le pitch : Clarissa, Laura et Virginia, bien que vivant à des époques et dans des lieux différents, sont réunies par un solide point commun. Clarissa, que ses amis surnomment Mrs Dalloway, est éditrice à New York et prépare une réception pour son ami Richard qui vient de recevoir la consécration littéraire au moment où il se meurt du sida , Laura vit en Californie et vole à sa famille des heures qu’elle passe à l’hôtel à lire Mrs Dalloway, et Virginia n’est autre que Virginia Woolf en 1923 à Londres, alors qu’elle s’apprête à écrire Mrs Dalloway.
Trois destins subtilement entrecroisés. Pour dire la difficulté mais aussi le bonheur de vivre.
Mon avis : Prix Pullitzer 1999. Prenez garde ! Si vous vous lancez dans la lecture de ce court roman (court, mais d’une densité extrême), vous n’en sortirez pas intact !
Sur un principe de construction apparemment simple (trois vies de femme, à des époques différentes, entrent en résonance par une alternance de chapitres, tout au long de l’oeuvre), mais profondément subtile dans sa mise en oeuvre, Michaël Cunningham met en perspective la coloration spleenesque de la vie de Virginia Woolf et des thèmes de son oeuvre.
L’écriture de Cunningham est d’une simplicité confondante (du moins, en apparence !), mais crée, peu à peu, une atmosphère douce-amère, désenchantée, qui gagne l’esprit du lecteur au point de l’immerger profondément dans ces histoires croisées.
Un dernier verre au bar sans nom – Don Carpenter (1995)
10/18 – 480 pages – 8.40 €
Le pitch : Lorsqu’il rencontre Jaime sur les bancs de la fac, Charlie en tombe immédiatement amoureux. Elle est bien meilleur écrivain, mais c’est lui qui décroche un prix et ambitionne d’écrire le «Moby Dick de la guerre ».
Dans le sillage charismatique du couple, déménagé à Portland, une bande d’écrivains se forme. Au tournant des années 1950-1960, tous rêvent de succéder à une Beat Generation agonisante. De la Californie à l’Oregon, entre succès éphémères et échecs cuisants, ils écument les bars de la côte Ouest et font le deuil de leurs illusions.
Ce magnifique roman posthume, tiré de l’oubli grâce au dévouement de Jonathan Lethem qui s’est occupé d’éditer le manuscrit, déploie tous les thèmes chers à Don Carpenter qui y livre une ultime déclaration d’amour, amère mais lumineuse, à la littérature.
Mon avis : L’histoire de l’édition est jalonnée de textes inédits de grands auteurs retrouvés après leur mort et publiés, tels quels ou retravaillés, dotés d’un important appareil critique pour expliquer l’intérêt d’une telle publication.
La plupart du temps, le résultat est décevant, parfois même pitoyable. Car, si l’auteur n’avait pas proposé le roman, les nouvelles ou l’essai à un éditeur, c’est sans doute parce qu’il considérait que le texte n’en valait pas la peine; et qui mieux que l’auteur peut juger de la valeur de ses propres écrits ?
Mais, de temps un temps, un petit miracle survient. Et c’est le cas pour Un dernier verre au bar sans nom qui, remanié a minima par l’auteur Jonathan Lethem comme ce dernier l’explique fort bien et de manière totalement transparente dans la postface du livre, se révèle être un bijou de roman, un véritable petit chef-d’oeuvre !
La couleur de l’eau – James McBride (1995)
Gallmeister – 265 pages – 9.50 €
Le pitch : « Enfant, je n’ai jamais su d’où venait ma mère. » Arrivé à l’âge adulte, James McBride interroge celle qui l’a élevé et dont la peau est tellement plus claire que la sienne. Il découvre l’histoire cachée de Ruth, fille d’un rabbin polonais qui a bravé tous les interdits pour épouser un Noir protestant en 1942. Reniée par sa famille, elle élève James et ses onze frères et soeurs dans la précarité, le chaos et la joie. Pour elle, peu importe la couleur de peau. Seul compte l’avenir de ses enfants. Ils feront des études, et ainsi choisiront leur vie.
Tressant leurs souvenirs, James McBride raconte, plein d’amour et de fierté, une femme forte et secrète, lucide et naïve, imperméable aux préjugés : sa mère.
Mon avis : Les Etats-Unis se sont développés sur les bases d’un principe a priori positif et vertueux : le melting pot.
Depuis trois siècles, les immigrants arrivent du monde entier sur le territoire américain et, en une, deux ou trois générations, ils se fondent dans le terreau commun, y intégrant la richesse de leurs spécificités tout en récupérant celles apportées par leurs prédécesseurs.
Processus vertueux ? Cela a été parfois vrai, mais à quel prix ?!
Le très beau livre de James McBride illustre à merveille les obstacles auxquels sont confrontés les « nouveaux » américains, pour autant qu’ils soient un tantinet différents des autres.
Corps et âme – Franck Conroy (1993)
Gallimard / Folio – 704 pages – 10.20 €
Le pitch : A New York, dans les années quarante, un enfant regarde, à travers les barreaux du soupirail où il est enfermé, les chaussures des passants qui marchent sur le trottoir. Pauvre, sans autre protection que celle d’une mère excentrique, Claude Rawling semble destiné à demeurer spectateur d’un monde inaccessible.
Mais dans la chambre du fond, enseveli sous une montagne de vieux papiers, se trouve un petit piano blanc désaccordé. En déchiffrant les secrets de son clavier, Claude, comme par magie, va se découvrir lui-même : il est musicien.
Ce livre est l ‘histoire d’un homme dont la vie est transfigurée par un don. Son voyage, à l’extrémité d’une route jalonnée de mille rencontres, amitiés, amours romantiques, le conduira dans les salons des riches et des puissants, et jusqu’à Carnegie Hall…
Mon avis : Si je ne devais emporter qu’une (grosse) valise de livres sur une île déserte, Corps et âme serait certainement dedans. L’histoire de cet enfant surdoué qui, parce que c’est son destin, parce qu’il a aussi la chance de rencontrer un homme formidable qui va le guider, va plonger dans la musique et en faire sa vie.
Roman d’apprentissage, roman de destinée, vaste fresque sur la musique sous toutes ces formes ou presque (classique, contemporaine, jazz bien sûr), Corps et âme est une oeuvre quasi universelle.
Si vous n’accordez aucune importance à la musique, lisez-le quand même, cela sera sans doute un peu moins extraordinaire, mais lisez-le quand même car c’est avant tout un chef d’oeuvre littéraire et sa lecture vous fera bourdonner le cœur !
Le maître des illusions – Donna Tartt (1992)
Pocket – 720 pages – 8.20 €
Le pitch : En décrochant une bourse à l’université de Hampden, dans le Vermont, Richard Papen ne laisse pas grand-chose derrière lui : la Californie, qui lui déplaît , son adolescence, faite de souvenirs incolores , et ses parents, avec qui il ne s’entend pas.
Hampden est une porte de sortie inespérée, l’opportunité de vivre une nouvelle vie. Passées quelques semaines, il est bientôt attiré par un professeur atypique, Julian Morrow, esthète capricieux qui enseigne les lettres classiques à cinq étudiants apparemment très liés. Contre l’avis de ses professeurs, il tente de s’introduire dans le groupe de ces jeunes gens marginaux sur qui courent les plus folles rumeurs. Et il est loin d’imaginer ce que lui coûtera sa curiosité.
Mon avis : J’ai été un des premiers français à lire Le maître des illusions, il y a vingt ans, et depuis je n’ai pas arrêté d’en faire la promotion autour de moi.
Comme pour tous les livres qui m’ont un jour fasciné, je n’ai cessé de l’offrir à mes amis en insistant sur le fait qu’il devrait les toucher, d’une manière ou d’une autre, car ce merveilleux roman est un roman d’initiation.
J’adore les romans d’initiation quand ils sont réussis, car il touche à l’essence même de la vie : le passage de l’enfance à l’âge adulte. Le maître des illusions (quel beau titre, beaucoup plus beau, pour une fois, que le titre orignal : The secret history) est, sur ce point, une réussite absolue.
American psycho – Bret Easton Ellis (1991)
Editions 10/18 – 449 pages – 10.20 €
Le pitch : Avec son sourire carnassier et ses costumes chics, Patrick Bateman correspond au profil type du jeune Yuppie des années Trump. Comme ses associés de la Chemical Bank, il est d’une ambition sans scrupules. Comme ses amis, de il rythme ses soirées-cocktails pauses cocaïne.
À la seule différence que Patrick Bateman viole, torture et tue. La nuit, il dévoile sa double personnalité en agressant de simples passants, des clochards, voire un ami. Mais il ne ressent jamais rien. Juste une légère contrariété lorsque ses scénarios ne se déroulent pas exactement comme prévu…
Mon avis : Lorsque j’ai lu American psycho, au début des années quatre-vingt-dix, j’ai fait des cauchemars pendant plusieurs jours. Cela ne m’était jamais arrivé, et cela n’est plus jamais arrivé dans ma vie de grand lecteur.
Autant dire que je mets un avertissement énorme : la lecture du roman de Bret Easton Ellis est réservée, je dis bien réservée, aux adultes, et aux adultes qui ne sont pas facilement impressionnables !
Ce livre est absolument hors-norme, une pierre dans l’histoire littéraire de la fin du XX° siècle. Un chef-d’oeuvre ? Un foutage de gueule ? En tous cas, sans aucun doute, le livre qui suscite le plus de réactions violentes, polémiques et contradictoires de la part de ses lecteurs !
Le bûcher des vanités – Tom Wolfe (1987)
Le livre de poche – 917 pages – 9.90 €
Le pitch : Sherman McCoy mène une vie luxueuse entre Wall Street, dont il est l’un des jeunes lions, et Park Avenue. Un soir, revenant de l’aéroport avec sa maîtresse, il rate la sortie de l’autoroute, et se perd dans le Bronx. Au moment où il croit enfin échapper à ce quartier de tous les dangers, deux jeunes noirs s’avancent, menaçants, vers sa Mercedes… Le couple parvient à s’enfuir, mais écrase l’un des deux hommes.
Pour Sherman McCoy, c’est le début de la chute. Sa vie affective et professionnelle est pulvérisée, et l’univers dont il se croyait le maître flambe sur le bûcher de toutes les vanités. Graduellement, inexorablement, l’étau se resserre, sans que l’on sache, jusqu’aux toutes dernières pages, comment le cauchemar se terminera.
Mon avis : Lorsque Le bûcher des vanités est sorti, il y a tout jute trente ans, le monde littéraire s’est arrêté de tourner un moment, sidéré par l’impact incroyable de ce roman qui ne ressemblait à rien d’autre ; à rien ! Trois décennies plus tard, ce chef-d’oeuvre n’a pas perdu une miette de sa force, de sa puissance et doit être considéré comme un des grands romans américains du XX° siècle.
Que vous découvriez ce monstre en format broché (700 pages, un bon kilo et demi) ou en édition poche (plus de 900 pages), vous serez d’abord impressionné par sa dimension physique. Mais cette impression sera vite effacé par le choc que vous recevrez en pleine tronche dès que vous aurez lu la première page et que vous aurez été confronté au style de Tom Wolfe.
La trilogie new-yorkaise – Paul Auster (1985-1986)
Actes Sud – 444 pages – 9.70 €
Le pitch : De toutes les qualités qui ont justifié le succès de la Trilogie new-yorkaise, l’art de la narration est sans doute la plus déterminante. C’est qu’il suffit de s’embarquer dans la première phrase d’un de ces trois romans pour être emporté par les péripéties de l’action et étourdi jusqu’au vertige par les tribulations des personnages.
Très vite pourtant le thriller prend une allure de quête métaphysique, et la ville illimitée, insaisissable – New York – devient un gigantesque échiquier où Auster dispose ses pions. De ces trois romans, il avoue d’ailleurs vers la fin de La Chambre dérobée qu’ils sont une seule et même histoire considérée à des stades différents de la conscience qu’il a pu en avoir.
Et d’ajouter : » Il y a longtemps que je me démène pour dire adieu à quelque chose… » Or il est vrai que, dans l’art de dire la dépossession, il est passé maître.
Regroupe les trois romans : La Cité de verre, La chambre dérobée, Revenants.
Mon avis : Avec ces trois romans publiés à quelques mois d’intervalle, Paul Auster révolutionne la narration romanesque classique et en fait quelque chose… qui ne ressemble à rien d’autre !
A lire pour la qualité intrinsèque de l’oeuvre, mais aussi comme un des textes majeurs sur la ville de New-York.
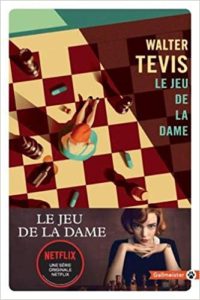
Le jeu de la dame – Walter Tevis (1983)
Gallmeister – 370 pages – 11.40 €
Le pitch : Kentucky, 1957. Après la mort de sa mère, Beth Harmon, neuf ans, est placée dans un orphelinat où l’on donne aux enfants de mystérieuses « vitamines » censées les apaiser. Elle y fait la connaissance d’un vieux gardien passionné d’échecs qui lui en apprend les règles. Beth commence alors à gagner, trop vite, trop facilement. Dans son lit, la nuit, la jeune fille rejoue les parties en regardant le plafond où les pièces se bousculent à un rythme effréné.
Plus rien n’arrêtera l’enfant prodige pour conquérir le monde des échecs et devenir une championne. Mais, si Beth prédit sans faute les mouvements sur l’échiquier, son obsession et son addiction la feront trébucher plus d’une fois dans la vie réelle.
Mon avis : Ce roman écrit en 1983 par Walter Tevis n’aurait sans doute jamais été traduit et publié (pour le première fois, semble-t-il) en France par l’éditeur Gallmeister sans le succès fabuleux de l’adaptation en série sur Netflix, fin 2020.
Dès sa mise en ligne, j’ai été littéralement scotché devant mon écran pendant les huit épisodes de la saison (unique), fasciné par l’univers abordé et les thèmes développés, l’esthétique de la série (les 60’s aux Etats-Unis), la qualité de la réalisation et, bien entendu, le jeu étonnant de l’actrice principale.
J’ai alors découvert qu’il s’agissait, donc, d’une adaptation. Le jeu de la dame est un bouquin absolument formidable, que je place immédiatement dans ma bibliothèque idéale. Sa lecture m’a permis de découvrir, mieux que je ne l’avais fait jusqu’alors dans mon long parcours de grand lecteur, à quel point l’écriture d’un roman peut être, lorsque le talent est là, véritablement cinématographique.
Le choix de Sophie – William Styron (1979)
Folio – 636 pages – 12.80 €
Le pitch : A Brooklyn, en 1947, Stingo, jeune écrivain venu du Sud, rencontre Sophie, jeune catholique polonaise rescapée des camps de la mort. A la relation de la rencontre du jeune homme avec l’amour, se superposent la narration du martyre de Sophie, l’évocation de l’univers concentrationnaire et de l’holocauste nazi.
Les deux veines, autobiographique et historique, irriguent en profondeur ce roman et fusionnent en une émouvante parabole sur l’omniprésence du Mal, symbolisé par l’horreur nazie, mais aussi par l’esclavage et le racisme brutal ou larvé de la société américaine, l’intolérance à tous les degrés, la férocité de la lutte de l’homme pour la vie ou la survie la plus élémentaire.
Mon avis : Lorsque Le choix de Sophie est sorti dans les librairies, en 1979, il a immédiatement rencontré un immense succès, tant critique que commercial. Bien plus : le roman de William Styron a acquis le statut instantané de classique de la littérature mondiale.
Près de quarante ans plus tard, personne ne cherchera à le contester. Une preuve parmi d’autres ? Aujourd’hui, qui ne connait pas, et n’a jamais utilisé, l’expression « c’est un choix de Sophie » pour décrire le choix entre deux solutions aussi insupportables, mauvaises l’une que l’autre ?

L’étoffe des héros – Tom Wolfe (1979)
Folio – 544 pages – 10.20 €
Le pitch : En toile de fond : la guerre froide que se livrent les Américains et les Russes. L’enjeu : rien moins que les étoiles. Le projet : Mercury. Les héros : sept astronautes à la conquête du ciel, courageux, pleins d’expérience, prêts à payer. de leur peau pour goûter à la gloire.
Héroïque, Chuck Yeager qui a franchi le premier le mur du son. Héroïque, John Glenn qui effectue le premier vol orbital jamais réalisé par un Américain. Héroïque, Gus Grissom qui réussit sa difficile mission… mais voilà qu’il saute à la mer, pris de panique ! Ils ont peur, ces héros ? Et leurs femmes pleurent ? Ça, des as ? Ou » des fils de p…, des salopards « , comme le prétend Pancho Bannes, la patronne du bar, thêàtre de scènes d’un grand comique. Ou des singes, puis-qu’ils subissent les mêmes tests que les animaux de laboratoire et qu’on leur dit sans cesse que le premier à effectuer le projet Mercury sera… un chimpanzé. Ou des pantins entre les mains des médias américains.
Un peu de tout cela, donc des hommes, écrit en substance Tom Wolfe. Et leur » Etoffe » est humaine, tout simplement.
Mon avis : J’espère que vous avez cliqué sur la couverture du livre, pour lire mon commentaire, car le dessin choisi par Folio est absolument hideux… Il serait en effet dommage de passer à côté de ce livre fabuleux, certainement le meilleur que j’ai eu la chance de lire au cours de mon existence sur la conquête spatiale .
Tom Wolfe, outre le fait qu’il était un merveilleux auteur de fiction (Le bûcher des vanités, comme meilleur exemple) est aussi un des inventeur, en 1973, du concept de « nouveau journalisme ».
Le monde selon Garp – John Irving (1978)
Points – 680 pages – 8.90 €
Le pitch : Jenny Fields ne veut pas d’homme dans sa vie mais elle désire un enfant. Ainsi naît Garp. Il grandit dans un collège où sa mère est infirmière. Puis ils décident tous deux d’écrire, et Jenny devient une icône du féminisme.
Garp, heureux mari et père, vit pourtant dans la peur : dans son univers dominé par les femmes, la violence des hommes n’est jamais loin…
Un livre culte, à l’imagination débridée, facétieuse satire de notre monde.
Mon avis : livre dynamite, livre iconoclaste, Le monde selon Garp a donné un grand coup de pied en 1978 à la littérature américaine qui, grâce à lui (le coup de pied au cul…) a fait trois pas en avant.
On y retrouve tous les thèmes et toutes les obsessions de John Irving, qui à partir de cet ouvrage rentre dans sa grande période, qui se prolongera jusqu’à son chef d’oeuvre, Une prière pour Owen.
Ragtime – E.L. Doctorow (1975)
Pavillons Poche – 416 pages – 10.00 €
Le pitch : Lors de sa publication en 1975, Ragtime fut porté aux nues par la critique américaine avant de devenir un best-seller mondial. Avec cette tragi-comédie nostalgique mais pleine de bruit et de fureur dépeignant la naissance de l’Amérique moderne et les débuts de l’âge du jazz, E. L. Doctorow accédait au rang de grand écrivain. Aux héros de son invention, il mêle, entre autres, Ford, Freud, Jung et Houdini dans un kaléidoscope de personnages.
Ragtime, porté à l’écran par Miloš Forman en 1981, est aujourd’hui un classique de la littérature américaine du XXe siècle.
Mon avis : Peut-être avez-vous vu, il y a de cela pas mal d’année, l’excellent film de Milos Forman, adaptation du roman de E.L. Doctorow ? Non ? Alors il y a peu de chance que vous ayez déjà entendu parler de Ragtime, best seller publié il y a près d’un demi-siècle aux Etats-Unis car, il faut bien l’avouer, l’édition française était passé complètement à côté de l’oeuvre, avant sa récente publication dans l’excellente collection Pavillons poche.
Un oubli regrettable, indubitablement, car pour peu que la littérature américaine de qualité vous passionne, vous ressortirez ravi de la lecture de ce récit foisonnant, complexe et pourtant d’un accès bien plus facile qu’on bien voulu le dire certaines critiques.
Attention : Ragtime n’a rien à voir avec le style de jazz syncopé du même nom ! Ou alors, si peu, que cela ne vaut même pas la peine d’en parler. Non, le seul rapport, c’est l’époque : le roman se passe lors de l’émergence du jazz moderne, au début du XX° siècle.
Le parrain – Mario Puzo (1969)
Pavillons poche – 840 pages – 12.50 €
Le pitch : Aux yeux de ses voisins, Don Corleone est un patriarche, un respectable père de famille qui a su donner à ses enfants une éducation où les rigoureux principes de la morale sicilienne s’adaptent aux nécessités de la vie américaine. Mais sa vraie famille est plus vaste , c’est une des » familles » de la Mafia dont il est un des chefs les plus aimés, mais aussi les plus respectés, car il est raisonnable et juste. Pour eux, il est le Parrain.
Le Parrain, c’est l’évocation d’un monde souterrain qui sape les fondations de l’Amérique, d’une pègre redoutable que la société voudrait ignorer, mais que de retentissants scandales ne cessent de révéler au grand jour. De New York à Las Vegas, des somptueuses villas de Hollywood au maquis de Sicile, voici le portrait d’une nation gangrenée par ses syndicats du crime, sa guerre des gangs et ses puissances occultes
Mon avis : Dire que j’ai attendu 50 ans pour lire ce chef-d’oeuvre ! Tout ça pour des idées préconçues : le premier véritable best-seller de l’histoire de l’édition ne pouvait être qu’un livre préfabriqué. Quelle erreur !
Fan absolu, depuis toujours, de la trilogie de Coppola (3 chefs-d’oeuvre), j’ai découvert avec effarement que le roman de Mario Puzo leur est supérieur en tout point ! En fait, cet énorme bouquin (840 pages en poche, dans la magnifique collection Pavillons Poche) correspond simplement au premier film de la trilogie ! C’est dire s’il est autrement plus riche que le film.
Alors que dire… c’est littéralement scotchant du début jusqu’à la fin. Oui, vous êtes scotché au livre !
La vallée des poupées – Jacqueline Susann (1966)
10/18 – 480 pages – 8.80 €
Le pitch : 1945. Anne Welles quitte sa famille et son fiancé de Nouvelle-Angleterre pour débarquer à New York, la tête pleine de rêves et de gloire. Elle y devient secrétaire d’un avocat spécialisé dans le théâtre et fait la connaissance de deux autres jeunes femmes qui prévoient de faire carrière dans le monde du spectacle: l’ambitieuse et prometteuse Neelly O’Hara et la très belle mais peu talentueuse Jennifer North.
Des bureaux d’agents d’artistes aux coulisses de Broadway, des plateaux d’Hollywood aux premières émissions TV, le roman suit leur ascension (et chute) respective, au rythme de leurs rencontres plus ou moins heureuses, carrière, amitié, amours bien sûr et autres trahisons et désillusions…
Mon avis : Avec La vallée des poupées, 10 /18 continue à explorer le passé récent de la littérature américaine dite populaire, en exhumant de grands romans, best-sellers à leur époque, souvent adaptés au cinéma, comme Peyton Place. Merci 10 /18 pour cette initiative !
Si Peyton Place était le reflet d’une certaine Amérique des années 50, celle des petites villes rétives à l’évolution des mœurs, La vallée des poupées en est celui d’une autre Amérique, celle des grandes villes des années 60.
Les poupées, dans ce long roman qui se lit d’une traite, comme on avalerait en binge watching les trois saisons d’une série, ce ne sont pas les filles, mais bien les petites pilules que les actrices, chanteuses et modèles, héroïnes de cette histoire, finissent toutes par avaler. Pour maigrir, pour dormir, pour supporter les rythmes de travail, le harcèlement des hommes…
Stoner – John Williams (1965)
J’ai lu – 377 pages – 7.60 €
Le pitch : Fils de paysan, William Stoner débarque à l’université du Missouri en 1910 pour y étudier l’agronomie. Délaissant ses cours de traitement des sols, il découvre les auteurs, la poésie et décide de se vouer à la littérature, quitte à décevoir les siens.
Devenu professeur alors que la Première Guerre mondiale éclate, cet homme solitaire et droit traversera le siècle et les tumultes de sa vie personnelle avec la confiance de celui qui a depuis longtemps trouvé son refuge : les livres
Mon avis : Ne passez pas à côté de cette petite merveille, dont la traduction a été assurée par Anna Gavalda ! La quatrième de couverture en fait largement état, mais c’est amplement mérité : c’est elle, en effet, qui a repéré le texte outre-atlantique et qui a fait le nécessaire pour qu’une édition française du roman soit publiée. Un acte altruiste, pour permettre aux lecteurs français de découvrir ce roman publié en 1965 et qui n’avait jamais été édité en France jusqu’alors.
Le thème du roman est formidable : un homme de (très) basse extraction devient un professeur d’Université, avec pour seule et unique mission : transmettre aux autres sa passion des livres, qui est depuis son enfance le moteur de sa vie.
Paris est une fête – Ernest Hemingway (1964)
Folio – 352 pages – 8.50 €
Le pitch : Au cours de l’été 1957, Hemingway commença à travailler sur les «Vignettes parisiennes», comme il appelait alors Paris est une fête. Il y travailla à Cuba et à Ketchum, et emporta même le manuscrit avec lui en Espagne pendant l’été 59, puis à Paris, à l’automne de cette même année.
Le livre, qui resta inachevé, fut publié de manière posthume en 1964. Pendant les trois années, ou presque, qui s’écoulent entre la mort de l’auteur et la première publication, le manuscrit subit d’importants amendements de la main des éditeurs. Se trouve aujourd’hui restitué et présenté pour la première fois le texte manuscrit original tel qu’il était au moment de la mort de l’écrivain en 1961.
Mon avis : Merci à Gallimard d’avoir présenté, cinquante après sa publication initiale, cette version revue et augmentée du recueil originalement appelé Vignettes parisiennes. L’occasion de faire découvrir aux plus grand nombre le génie d’Hemingway, puisque la sortie en poche de l’ouvrage a rencontré un incroyable succès, plusieurs centaines de milliers d’exemplaires vendus.
Paris est une fête est un merveilleux titre, mais celui choisi par Hemingway est beaucoup plus fidèle à son intention première, lorsqu’il écrivit cette succession de nouvelles en très grande partie autobiographiques.
Mrs Bridge – Evan S. Connell (1959)
10/18 – 312 pages – 7.80 €
Le pitch : Tout allait bien, semblait-il. Les jours, les semaines, les mois passaient, plus rapidement que dans l’enfance, mais sans qu’elle ressentît la moindre nervosité. Parfois, cependant, au coeur de la nuit, tandis qu’ils dormaient enlacés comme pour se rassurer l’un l’autre dans l’attente de l’aube, puis d’un autre jour, puis d’une autre nuit qui peut-être leur donnerait l’immortalité, Mrs. Bridge s’éveillait.
Alors elle contemplait le plafond, ou le visage de son mari auquel le sommeil enlevait de sa force, et son expression se faisait inquiète, comme si elle prévoyait, pressentait quelque chose des grandes années à venir.
Mon avis : Mrs Bridge et son pendant, Mr Bridge, constituent un phénomène de l’édition américaine d’après-guerre, resté pendant de longues décennies presque complètement inconnu en France. Incroyable le manque de porosité entre l’édition outre-atlantique des années 50 à 70 et son pendant français ! Que de grands romans à succès restés alors quasiment coincés entre les deux continents ! Heureusement, les éditeurs français comme Belfond et 10/18 (pour le format poche) ressuscitent depuis peu nombre de ces best-sellers qui sont aussi d’excellents romans…
Mrs Bridge, publié en 1959, est certainement un des romans les plus remarquables que j’ai pu lire au cours de ces dernières années. Remarquable, car il ne ressemble à rien de comparable.
Petit déjeuner chez Tiffany – Truman Capote (1958)
Folio – 192 pages – 7.40 €
Le pitch : Holly Golightly adore traîner chez Tiffany, parce que tout y est beau. Holly au pas léger, gracile comme un songe, comme une Audrey Hepburn moulée dans une robe noire devenue légendaire, traverse l’existence telle un chat qui, n’ayant pas de nom, s’en invente un. De son passé de Lulamae, il lui reste pourtant quelque chose de plus profond que la frivolité qu’elle affiche avec impertinence, une absence de lest qui conduit à une existence de courants d’air.
Jusqu’au jour où, des années après la disparition de la gosse, une photo vient raviver le souvenir de sa voix rauque et de sa silhouette de vent dans la mémoire du narrateur, qui lui fournira un hommage littéraire en guise de racines.
Sur un ton tantôt léger et amusant, tantôt grinçant et poétique, maniant à plaisir l’ironie, le narrateur nous livre ses souvenirs de l’époque où l’amitié les liait et où gravitait autour de cet être libre et sauvage une myriade de personnages farfelus.
Mon avis : Le monde entier, ou presque, connait ce bref roman, grâce au film mythique de Blake Edwards, symbole de la légèreté new-yorkaise des 60’s, et à Audrey Hepburn, qui incarne Holly Golightly avec une grâce absolument fascinante. Mais si vous avez déjà visionné ce film, avez-vous lu le chef-d’oeuvre de Truman Capote ?
Si ce n’est pas le cas, je vous invite avec fermeté (c’est obligatoire !) à passer une ou deux heures en compagnie de la complexe Holly Golightly et du narrateur, son voisin fasciné par le personnage.
Deux êtres qui vont, le temps d’une parenthèse dans leur vie, se rapprocher comme on le fait dans les vrais récits d’amitié…
Vous découvrirez alors à quel point le film est proche du roman sur certains points, et très éloigné sur d’autres. Mais, de toute manière, vous tomberez sous le charme de la plume d’un des plus grands écrivains américains du XX° siècle.
L’homme au complet gris – Sloan Wilson (1955)
10/18 – 456 pages – 8.80 €
Le pitch : Tom Rath est un modèle de réussite sociale : une très jolie femme, trois enfants et une maison de banlieue new-yorkaise. Mais dans l’Amérique des années 1950, seuls l’ambition et le salaire définissent la valeur d’un homme. Pour s’y conformer, le jeune trentenaire postule au service presse d’une compagnie de médias basée à Manhattan.
Perdu dans cet univers d’effervescence et de profit, où tous les employés portent un complet gris, Tom cherche désespérément à concilier réussite sociale et aspirations personnelles. Et lorsqu’il croise un ancien soldat dans l’ascenseur, les traumatismes du passé refont surface…
Mon avis : L’homme au complet gris est un roman publié aux Etats-Unis en 1955, où il rencontre dès sa sortie un immense succès, au point qu’il est adapté dès l’année suivante au cinéma, avec Grégory Peck, alors au fait de sa gloire, dans le rôle principal. Les éditions Belfond (et 10 /18 pour l’édition poche) ont pris l’initiative (formidable) de le rééditer pour le faire connaître au public français. Cette initiative s’inscrit dans le mouvement de redécouverte des grands succès de la littérature américaine d’après-guerre entamé il y a deux ans par l’éditeur, à côté de titres comme La vallée des poupées ou Peyton Place.
Autant le dire tout de suite : c’est une nouvelle excellente surprise !
L’attrape-cœurs – J.D. Salinger (1951)
Pocket – 256 pages – 9.50 €
Le pitch : Phénomène littéraire sans équivalent depuis les années 50, J. D. Salinger reste le plus mystérieux des écrivains contemporains, et son chef-d’œuvre, L’attrape-cœurs, roman de l’adolescence le plus lu du monde entier, est l’histoire d’une fugue, celle d’un garçon de la bourgeoisie new-yorkaise chassé de son collège trois jours avant Noël, qui n’ose pas rentrer chez lui et affronter ses parents.
Trois jours de vagabondage et d’aventures cocasses, sordides ou émouvantes, d’incertitude et d’anxiété, à la recherche de soi-même et des autres. L’histoire éternelle d’un gosse perdu qui cherche des raisons de vivre dans un monde hostile et corrompu.
Mon avis : Impossible de ne pas placer ici un des romans fondateurs de la littérature américaine moderne, tant il est important pour les habitants du grand pays.
Ceci dit, je n’ai jamais vraiment accroché à ce récit dont je trouve le style très daté (en français courant : je trouve que cela n’a pas très bien vieilli…)
Les romans des grands espaces et de l’Amérique profonde
Ce que nous cache la lumière – Tim Gautreaux (2021)
Le seuil – 512 pages – 23.50 €
Le pitch : Tout absorbés qu’ils sont par leurs affaires de cœur, de foi, d’argent, par leurs marottes diverses et variées, occupés à peser les avantages et les inconvénients de la vie au sein de petites communautés aussi soudées que scrutatrices, les personnages de ces nouvelles tentent d’affronter les déceptions du quotidien. Ce sont des voix discrètes, rarement entendues, des vieilles filles un peu tristes, des ferrailleurs, des artisans, des retraités… souvent détestables, parfois admirables.
Sur les rives du Mississippi, sous la neige du Minnesota ou dans les montagnes de Caroline du Nord, Tim Gautreaux cartographie des existences bien loin des mondanités et des grands drames. Il manie la malchance sans sentimentalité, nous offre dans une prose ciselée des histoires bouleversantes ou hilarantes et, surtout, nous rappelle avec humour et empathie qu’il est, en général, inutile de prendre les choses trop au sérieux.
Mon avis : Dans ses remerciements, en fin de livre, Tim Gautreaux écrit : « Les nouvelles n’ont pas bonne presse de nos jours« . Il a parfaitement raison, mais qu’est-ce que l’auteur américain dirait s’il était français !
Aux Etats-Unis, de nombreux auteurs renommés ont fait leur carrière ou leur renommée grâce aux nouvelles, avec des recueils qui se vendent et sont largement appréciés; mais en France, l’édition de nouvelles est un parcours d’obstacle et un luxe pour l’éditeur, car l’exercice n’est que très rarement apprécié et considéré par les lecteurs. Quel dommage…
Vous voulez une preuve de la magie de la nouvelle, sans pour autant aller piocher dans les œuvres de Maupassant, Somerset Maugham ou Jim Harrison ?
Alors plongez-vous directement dans Ce que nous cache la lumière, le merveilleux recueil du grand Tim Gautreaux , je vous garantie (satisfait ou remboursé !) que vous sortirez de sa lecture l’âme plus large, un léger sourire au coin des lèvres et l’oeil humide !
Lady Chevy – John Woods (2020)
Albin Michel – 480 pages – 22.90 €
Le pitch : Amy Wirkner, lycéenne de 18 ans, est surnommée « Chevy » par ses camarades en raison de son surpoids. Solitaire, drôle et intelligente, elle est bien décidée à obtenir une bourse pour pouvoir aller à l’université et quitter enfin ce trou perdu de l’Ohio où la fracturation hydraulique empoisonne la vie des habitants, dans tous les sens du terme. Mais alors qu’elle s’accroche à ses projets d’avenir et fait tout pour rester en dehors des ennuis, les ennuis viennent la trouver.
Convaincue que l’eau de la région devenue toxique est à l’origine des malformations de naissance de son petit frère, elle accepte de participer avec son meilleur ami Paul à un acte d’écoterrorisme qui va très mal tourner. Mais Amy refuse de laisser l’erreur d’une nuit briser ses rêves, quitte à vendre son âme au diable…
Mon avis : Une ou deux fois par an, je tombe sur un grand roman américain contemporain. Vous trouvez que c’est peu ? Moi, je trouve que c’est déjà pas mal, j’aimerais bien pouvoir dire la même chose de la littérature française ! La littérature américaine est saine, pleine de vigueur, même si elle n’échappe pas aux méfaits et aux excès des écoles d’écriture et à l’influence pernicieuse de l’enseignement universitaire.
La preuve de cette vitalité ? Lady Chevy en est un excellent exemple. L’auteur ? John Woods, un jeune trentenaire dont c’est le premier roman.
Issu d’une enfance et adolescence dans l’Ohio, il a traversé comme beaucoup d’américains les affres et les cahots des mutations économiques du pays, la montée des extrémismes politiques et religieux, les tempêtes du mandat Trump.
Là où chantent les écrevisses – Delia Owens (2019)
Points – 480 pages – 8.50 €
Le pitch : Les rumeurs les plus folles courent sur » la Fille des marais » de Barkley Cove, en Caroline du Nord. Pourtant Kya n’est pas cette créature sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. Abandonnée à l’âge de dix ans par sa famille, c’est grâce au jeune Tate qu’elle apprend à lire et à écrire, découvre la science et la poésie.
Mais Tate, appelé par ses études, doit partir à son tour. Et lorsque l’irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même…
Mon avis : Là où chantent les écrevisses : avec un aussi joli titre, le roman de Delia Owens ne pouvait pas passer inaperçu. Mais de là à ce qu’il devienne un des livres les plus vendus dans le monde au cours de ces dernières années, il y a un précipice que les amateurs ont pourtant franchi avec allégresse !
Le miracle du bouche-à-oreille, en matière de littérature, m’a toujours fasciné : pas de doute les lecteurs forment une immense communauté, hétérogène certes, mais réelle !
Pourtant, rien ne laissait entrevoir la reconnaissance quasi unanime des critiques professionnelles et amateures à l’égard de ce premier roman. Oui, un premier roman pour une jeune auteure qui venait de franchir les 70 balais avec un dynamisme indéniable.
Avant tout biologiste et zoologiste, ayant vécu un quart de siècle au Botswana, c’est une véritable spécialiste des animaux qui, après quelques essais « sérieux », a décidé de transcrire son amour de la nature sauvage au fil de sa plume, dans un magnifique roman que vous n’êtes pas près d’oublier.
Dernière saison dans les rocheuses – Shannon Burke (2018)
10/18 – 286 pages – 7.50 €
Le pitch : En 1820, aux Amériques, le commerce des fourrures est un moyen périlleux de faire fortune. À peine le jeune William Wyeth s’est-il engagé auprès de la compagnie de trappeurs la plus téméraire de l’État qu’il manque de se faire tuer.
Il découvre alors la force des liens entre les hommes, dont la survie ne dépend que de leur solidarité. Chasse au bison, nuits passées à dormir sur des peaux de bête, confrontations aux forces de la nature ou aux tribus indiennes, la vie de trappeur est rude, mais William a soif d’aventures. Il a quitté sa famille pour le grand Ouest, sauvage et indompté. Il devra réunir plus de courage et d’habileté qu’il ait jamais cru avoir pour en sortir vivant.
Retour aux sources pour cette expédition de trappeurs, dans la tradition des grands romans d’aventure à l’américaine
Mon avis : La littérature américaine fourmille actuellement de romans historiques ayant pour cadre la nouvelle frontière, cette ligne qui délimitait la progression des aventuriers et des colons vers l’ouest. La conquête de l’Ouest est furieusement à la mode.
Il faut dire que c’est un vaste, immense sujet : que de récits passionnants sur le wild west, la lutte contre les tribus indiennes, la chasse aux bisons… mais à côté de quelques réussites indiscutables (au hasard : Deadwood, Mille femmes blanches et, un cran au dessus, Le fils de Philip Meyer), que de nanars !
Avec Dernière saison pour les rocheuses, troisième roman de Shannon Burke, un jeune auteur new-yorkais, je vous garantie du 100 % qualité premium !
Nuits Appalaches – Chris Offutt (2018)
Gallmeister – 240 pages – 9.20 €
Le pitch : De retour de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, traverse à pied ses Appalaches natales pour rentrer chez lui. Sur son chemin, il croise Rhonda, quinze ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d’un trafiquant d’alcool de la région.
Au cours des années qui suivent, cinq enfants naissent, qui deviennent leur raison de vivre. Mais quand une enquête des services sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens.
Mon avis : Court et affuté comme un couteau de chasse, Nuits Appalaches (quel joli titre français !) est un roman de Chris Offutt publié par les Éditions Gallmeister.
La note américaine – David Grann (2018)
Pocket – 432 pages – 7.95 €
Le pitch : 1921, Oklahoma. Dépossédés de leurs terres, les Indiens Osages ont été parqués dans une réserve aride. Mais sous leurs pieds coule un océan de pétrole. De quoi rameuter, en quelques mois, les vautours blancs assoiffés d’or noir. Bientôt, les membres les plus riches de la tribu disparaissent, l’un après l’autre. Balle dans la tête, empoisonnement, incendie…
L’État fédéral n’a d’autre choix que d’ouvrir une enquête. À sa tête : le futur directeur du FBI, l’ambitieux John Edgar Hoover, bien décidé à faire de ce dossier brûlant son marchepied vers la gloire… Il lui faudra s’associer aux Indiens s’il veut réussir à élucider l’une des affaires criminelles les plus fascinantes de l’histoire américaine.
Mon avis : Vous avez lu le pitch ? Bien ! Maintenant, dîtes-moi si vous avez compris que ce roman n’en est pas un, mais plus simplement une enquête journalistique. Non ? Cela me rassure !
Et pourtant, c’en est bien une : David Grann, journaliste, s’est appuyé sur de longues recherches personnelles pour raconter cette incroyable (mais vraie !) histoire, où l’histoire américaine et le polar se sont rencontrés.
Cependant, il est fort possible que la confusion ait été volontairement entretenue car j’ai ressenti l’impression, en dévorant cette enquête passionnante, de revivre, d’une certaine manière, l’expérience inoubliable de la lecture de De sang froid, le livre marqueur de Truman Capote.
Washington Black – Esi Edugyan (2018)
Folio – 480 pages – 8.50 €
Le pitch : La Barbade, 1830. Washington Black, onze ans, est esclave dans une plantation détenue par un homme cruel. Très vite, sa vivacité et ses talents de dessinateur impressionnent le frère de son maître, l’excentrique Christopher Wild. Cet explorateur abolitionniste le prend sous son aile pour l’assister dans un projet fou : construire un ballon dirigeable.
Quand un jour Wash est accusé à tort d’un crime, les deux hommes sont contraints de fuir. S’envolant des Antilles au pôle Nord, de Londres au Maroc, c’est un voyage extraordinaire qui attend le jeune Wash en ce siècle de découvertes. Mais le chemin le plus dur à parcourir sera celui qui le mènera vers la liberté.
Mon avis : Les romans sur l’esclavage sont à la mode. Je sais, cette affirmation a quelque chose de choquant dans son expression même, et pourtant il faut bien l’admettre : un auteur américain aura, en ce premier quart du XXI° siècle, d’autant plus de chance de se faire repérer que son roman touche de près à ce traumatisme majeure de l’histoire de son pays.
Une preuve parmi tant d’autres : le prix Pulitzer attribué en 2017 à Colson Whitehead pour Underground railroad.
Heureusement, certains de ces romans au thème si prévisible donnent prétexte à une ouverture sur un heureux imprévu. C’est le cas avec Washington Black !
Des nouvelles du monde – Paulette Jiles (2016)
Folio – 288 pages – 7.50 €
Le pitch : Hiver 1870. Le capitaine Kyle Kidd parcourt le Texas et lit à voix haute des articles de journaux devant un public avide de nouvelles du monde. Un soir, à Wichita Falls, on lui propose de ramener une petite fille chez elle près de San Antonio. Ses parents ont été tués quatre ans plus tôt par les Kiowas, qui ont épargné et élevé Johanna comme une des leurs. Le vieil homme, veuf, accepte en échange d’une pièce d’or, mais sait qu’il lui faudra apprivoiser cette enfant sauvage qui guette la première occasion de s’échapper.
Ainsi commence un voyage splendide et périlleux, aux allures de western. Dans ces terres vierges où la loi n’engage que ceux qui la respectent, ces deux solitaires en marge du monde vont tisser un lien précieux qui fera leur force.
Mon avis : Des nouvelles du monde est le premier roman de Paulette Jiles traduit en France en 2018, grâce aux éditions Quai Voltaire. Pourtant, Paulette Jiles, née en 1943, a publié de très nombreux romans aux Etats-Unis; mais c’est sans doute le fait que ce dernier récit ait obtenu une place de finaliste au National book award en 2016 qui a attiré l’attention de l’éditeur français.
Et qu’il soit remercié de son initiative, car Des nouvelles du monde est un très grand et très beau récit western, dans la grande tradition américaine !
Nos disparus – Tim Gautreaux (2015)
Points – 576 pages – 8.40 €
Le pitch : De retour à La Nouvelle-Orléans après la Grande Guerre, Sam Simoneaux assiste impuissant à l’enlèvement d’une petite fille. À la recherche de l’enfant, il embarque à bord de l’Ambassador, bateau à aubes qui sillonne le Mississippi au rythme endiablé des concerts de jazz.
Au gré des escales et des bagarres, Sam ne tarde pas à mettre au jour un fructueux commerce d’enfants animé par la pègre des bayous.
Mon avis : Surtout, ne vous fiez pas au titre, à la couverture, et au pitch de ce roman, tous trois un peu terne ! Allez au delà de cela et – faites-moi confiance – vous découvrirez un des plus merveilleux romans américains de ce XXI° siècle…
Tim Gautreaux, j’ai déjà eu l’occasion d’en parler à l’occasion de la magnifique découverte du Dernier arbre, un des trois romans écrits par cet auteur à la vocation (ou à l’expression) tardive.
Un récit du grand sud, la Louisiane du début du XX° siècle. Bayous, chaleur, moustiques, lutte des hommes frustres contre la nature sauvage. Une capacité à développer des personnages d’une complexité et d’une profondeur formidable.
Alors imaginez mon plaisir, immense, quand je me suis immergé dans ce long, long récit, au tempo aussi lent que le débit du Mississippi.
L’invention des ailes – Sue Monk Kidd (2014)
10/18 – 552 pages – 9.10 €
Le pitch : Caroline du Sud, 1803. Fille d’une riche famille de Charleston, Sarah Grimké sait dès le plus jeune âge qu’elle veut faire de grandes choses dans sa vie. Lorsque pour ses onze ans sa mère lui offre la petite Handful comme esclave personnelle, Sarah se dresse contre les horribles pratiques de telles servilité et inégalité, convictions qu’elle va nourrir tout au long de sa vie. Mais les limites imposées aux femmes écrasent ses ambitions.
Une belle amitié nait entre les deux fillettes, Sarah et Handful, qui aspirent toutes deux à s’échapper de l’enceinte étouffante de la maison Grimké. À travers les années, à travers de nombreux obstacles, elles deviennent des jeunes femmes avides de liberté et d’indépendance, qui se battent pour affirmer leur droit de vivre et se faire une place dans le monde.
Une superbe ode à l’espoir et à l’audace, les destins entrecroisés de deux personnages inoubliables !
Mon avis : « Joie ! Joie ! Noël ! Noël ! » aurais-je pu crier en tournant la dernière page de cet épais roman dans lequel je me suis immergé, plusieurs soirs de suite.
Quel plaisir de déguster un roman aussi bien écrit (le style de Sue Monk Kidd est d’une fluidité et d’une richesse remarquable), dont la lecture est génératrice de tant d’émotions mais aussi de découvertes historiques !
Je ne peux donc que vous recommander chaudement ce remarquable récit « sudiste » racontant (vous avez lu le pitch ci-dessus) le destin parallèle de deux petites filles, devenues femmes, Sarah la blanche, la maîtresse et Handful la noire, l’esclave, de 1805 à 1838.
Nos premiers jours – Jane Smiley (2014)
Rivages – 592 pages – 9.80 €
Le pitch : Walter et Rosanna Langdon caressent un rêve : posséder une ferme à eux, un giron protecteur où fonder une famille. C’est sur les terres sublimes de l’Iowa que se bâtit la légende des Langdon et de leurs enfants, qui vont connaître, de près ou de loin, les bouleversements de la première moitié du XXe siècle.
Cette traversée commence en 1920, à l’aube de la Dépression, et s’achève en 1953. Le temps pour une génération d’éclore ; pour une autre de voir le monde changer.
Dans cette puissante saga familiale, Jane Smiley épouse le rythme de la vie-même, les caprices du temps, du hasard, de l’Histoire.
Mon avis : Attention : derrière la jolie couverture toute en douceur de cet épais roman au titre un peu fade, se cache une entreprise tout à fait originale !
Jane Smiley (quel patronyme superbe !), prix Pulitzer 1992, s’est lancé en 2014 dans un pari a priori difficile à tenir : raconter le dernier siècle américain au travers de la vie d’une famille.
Nos premiers jours est donc le premier tome d’une trilogie aujourd’hui (promptement) achevée. Plus de 600 pages denses par tome, près de 2 000 pages au total, et le pari fou d’une narration au ton aussi neutre que possible où l’auteure, comme une historienne, déroule la vie de ses nombreux personnages avec une précision d’entomologiste.
Le fils – Philipp Meyer (2013)
Le livre de poche – 792 pages – 8.90 €
Le pitch : Vaste fresque de l’Amérique de 1850 à nos jours, Le Fils de Philipp Meyer, finaliste du prestigieux prix Pulitzer 2014, est porté par trois personnages, trois générations d’une famille texane, les McCullough, dont les voix successives tissent la trame de ce roman exceptionnel.
Eli, enlevé par les Comanches à l’âge de onze ans, va passer parmi eux trois années qui marqueront sa vie. Revenu parmi les Blancs, il prend part à la conquête de l’Ouest avant de s’engager dans la guerre de Sécession et de bâtir un empire, devenant, sous le nom de « Colonel », un personnage de légende.
À la fois écrasé par son père et révolté par l’ambition dévastatrice de ce tyran autoritaire et cynique, son fils Peter profitera de la révolution mexicaine pour faire un choix qui bouleversera son destin et celui des siens. Ambitieuse et sans scrupules, Jeanne-Anne, petite-fille de Peter, se retrouvera à la tête d’une des plus grosses fortunes du pays, prête à parachever l’oeuvre de son arrière-grand-père.
Mon avis : Pour une fois,le pitch du roman rédigé par l’éditeur est à la fois clair, complet et suffisamment précis pour se faire une véritable idée de ce que renverse la jaquette. C’est par là que j’ai commencé, en 2014, attiré par le thème de cet énorme roman « de l’Amérique ».
Et je ne l’ai pas regretté une seconde ! Le fils est un roman exceptionnel.
Une sorte de synthèse des mythes du grand sud de l’Amérique, entre le roman (La trilogie des confins de Cormac Mac Carthy, ou Lonseome dove de Larry McMurtry) et le film (Géant de Georges Stevens). Un texte dont la lecture vous procurera les mêmes sensations que le visionnage d’un film américain des années 50 diffusé en 70 mm dans une salle avec écran géant. J’exagère à peine… !
Les suprêmes – Edward Kelsey Moore (2013)
Actes sud – 414 pages – 9.70 €
Le pitch : Elles se sont rencontrées dans les années 1960 et ne se sont plus jamais quittées : tout le monde les appelle « les Suprêmes », en hommage au célèbre groupe des années 1970.
Complices dans le bonheur comme dans l’adversité, ces trois irrésistibles « quinquas » afro-américaines aussi puissantes que fragiles ont fait d’un des restaurants de leur petite ville de l’Indiana. Longtemps marquée par la ségrégation leur quartier général où, tous les dimanches, entre commérages et confidences, rire et larmes, elles élaborent leurs stratégies de survie et se gavent de poulet frit.
Rendez-vous avec vos futures meilleures amies.
Mon avis : Ce roman publié en 2014, écrit par un américain black (ça, c’est le terme que je continue d’utiliser pour parler des personnes à la peau noire, malgré les tonnes de politiquement correct en cours aux U.S !), violoncelliste professionnel de renom, qui composa ici son premier roman, est un coup de maître mais aussi un de mes coups de cœur absolus de ces dernières années.
400 pages pour raconter les aventures et suivre le destin de ces trois « Suprêmes », trois amies afro-américaines (ça, c’est le politiquement correct!) qui se retrouvent dans leur restaurant favori, chez Earl all-you-can-eat (titre original du roman), voilà ce que propose l’auteur. Rien de bien sexy, a priori.
Et pourtant ! En allant au delà d’un pitch un peu mollasson, le lecteur va tomber sur une pépite ! Les Suprêmes est un véritable feu d’artifice d’émotions contradictoires.
Le diable, tout le temps – Donald Ray Pollock (2012)
Le livre de poche – 369 pages – 9.50 €
Le pitch : De l’Ohio à la Virginie-Occidentale, de 1945 à 1965, des destins se mêlent et s’entrechoquent : un rescapé de l’enfer du Pacifique, traumatisé et prêt à tout pour sauver sa femme malade , un couple qui joue à piéger les auto-stoppeurs , un prédicateur et un musicien en fauteuil roulant qui vont de ville en ville, fuyant la loi.
La prose somptueuse de ce premier roman de D. R. Pollock contraste avec les actes terribles de ses personnages. Un univers terrifiant que la critique n’hésite pas à comparer à ceux de Flannery O’Connor, Jim Thompson ou Cormac McCarthy.
Mon avis : Alors, j’y vais carrément : je crois qu’il s’agit du meilleur livre que j’ai lu en 2014, et un des meilleurs de ces dix dernières années ; ce qui, vu le nombre de pages que j’ingurgite régulièrement depuis 50 ans, est un sacré compliment, je vous le jure !
Mais, me demanderez-vous, pour quelles raisons ? La première – et c’est la marque des chefs-d’oeuvre – c’est que ce roman d’une noirceur inégalé – jamais un livre n’eut un titre plus approprié ! – ne ressemble à aucun autre. Impossible de le classer, de le mettre en parallèle avec un autre : c’est unique.
Nos âmes la nuit –Kent Haruf (2012)
Pavillons poche – 192 pages – 8.00 €
Le pitch : Dans la petite ville de Holt, Colorado, Addie, une septuagénaire veuve depuis des décennies, fait une étrange proposition à son voisin, Louis, également veuf : voudrait-il bien passer de temps à autre la nuit avec elle, simplement pour parler, se tenir compagnie ? La solitude est parfois si dure…
Bravant les commérages, Louis se rend donc régulièrement chez Addie. Ainsi commence une très belle histoire d’amour, lente et paisible, faite de confidences chuchotées dans la nuit, de mots de réconfort et d’encouragement. Une nouvelle vie apaisée, toute teintée du bonheur de vieillir à deux.
Hymne à la tendresse et à la liberté parcouru d’un grand vent d’humour, Nos âmes la nuit est l’oeuvre qui a fait connaître Kent Haruf au grand public, quelques mois après sa mort.
Mon avis : Le pitch de l’éditeur est complet, précis, et surtout… parfaitement exact, y compris dans ses appréciations et ses qualificatifs, ce qui est assez rare pour le souligner !
Nos âmes la nuit est le livre le plus bouleversant que j’ai eu la chance et le privilège de lire en 2017. Pourtant, aucun pathos dans ce récit court et aussi lumineux dans son expression et son contenu qu’une journée de printemps.
Kent Haruf raconte, avec une économie de moyens sidérante (si tous les auteurs pouvaient prendre exemple sur lui !), le dernier amour d’un couple qui se trouve, aux portes de la mort.
Féroces – Robert Goolrick (2010)
10/18 – 288 pages – 6.60 €
Le pitch : Les Goolrick étaient des princes. Et tout le monde voulait leur ressembler. C’étaient les années 50, les femmes se faisaient des coiffures sophistiquées, elles portaient des robes de taffetas ou de soie, des gants et des chapeaux, et elles avaient de l’esprit. Les hommes préparaient des cocktails, des Gimlet, des Manhattan, des Gibson, des Singapore Sling, c’était la seule chose qu’ils prenaient au sérieux. Dans cette petite ville de Virginie, on avait vraiment de la classe, d’ailleurs on trouvait son style en lisant le New Yorker.
Chez les Goolrick, il y avait trois enfants, tous brillants. Et une seule loi : on ne parle jamais à l’extérieur de ce qui se passe à la maison. A la maison, il y avait des secrets. Les Goolrick étaient féroces.
Mon avis : Se faire secouer par un livre, cela n’est pas fréquent, mais cela arrive. Volontairement ou pas, on tombe parfois sur un roman dont le contenu est si terrible qu’il vous retourne l’intérieur.
Mais se faire secouer par un livre tout en restant, jusqu’au bout, stupéfait, pétrifié par la qualité de la forme, du fond, du style, c’est assez rare. C’est ce qu’il vient de m’arriver avec Féroces, de Robert Goolrick.
La couleur des sentiments – Kathryn Stockett (2009)
Babel – 624 pages – 9.70 €
Le pitch : Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques mois, Martin Luther King marchera sur Washington pour défendre les droits civiques. Mais dans le Sud, toutes les familles blanches ont encore une bonne noire, qui a le droit de s’occuper des enfants, mais pas d’utiliser les toilettes de la maison.
Quand deux domestiques, aidées par une journaliste, décident de raconter leur vie au service des Blancs dans un livre, elles ne se doutent pas que la petite histoire s’apprête à rejoindre la grande, et que leur vie ne sera plus jamais la même.
Mon avis : La couleur des sentiments : qui n’a pas ce roman en mémoire ? Vous ? Eh bien il est temps de rattraper le temps perdu !
Un méga succès de librairie dans le monde entier en 2010 (des millions d’exemplaires), un giga succès dans les salles pour l’adaptation cinématographique (impeccable) en 2013. Et en prime, contrairement à d’autres best sellers au succès identique, il s’agit vraiment d’une très grande réussite littéraire!
Parvenir à faire rire et émouvoir, rires et larmes mélangés, sur un sujet aussi casse-gueule que la ségrégation raciale aux États-Unis, ce n’est pas facile et pourtant, Kathryn Stockett y est parfaitement parvenu.
La route – Cormac McCarthy (2007)
Editions de l’Olivier / 10/18 – 250 pages – 7.10 €
Le pitch : L’apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, couvert de cendres. On ne sait rien des causes de ce cataclysme. Un père et son fils errent sur une route, poussant un caddie rempli d’objets hétéroclites et de vieilles couvertures. Ils sont sur leurs gardes, car le danger peut surgir à tout moment. Ils affrontent la pluie, la neige, le froid.
Et ce qui reste d’une humanité retournée à la barbarie.
Mon avis : Prix Pulitzer 2007.
Ce roman post-apocalyptique est un chef d’oeuvre terrifiant, qui ne manquera pas, j’en suis certain, d’inspirer indirectement quelques films d’horreur qui sauront en détourner les codes.
L’écriture blanche (comme le paysage, couvert de cendres) de McCarthy est somptueuse ; elle se développe dans un contexte qui en démultiplie les effets. C’est une écriture « à l’os », qui vous prend là, de part et d’autre du larynx, et qui vous étouffe peu à peu. À la fin, vous avez des visions, par manque d’air, et vous voyez… la route.
No country for old men – Cormac McCarthy (2005)
Points – 298 pages – 7.10 €
Le pitch : À la frontière du Texas, Moss découvre un carnage : un homme à moitié mort, d’autres déjà froids, des armes, de l’héroïne et deux millions de dollars. La tentation est trop forte.
Mais on ne vole pas impunément des narco trafiquants. Moss devient l’objet d’une impitoyable chasse à l’homme. À ses trousses, un vieux shérif et un tueur psychopathe de la pire espèce…
Mon avis : Si vous ne devez lire que trois romans de Cormac McCarthy, un des auteurs majeurs de l’Amérique de la fin du XX° siècle, il faut absolument que celui-ci en face partie, car c’est un chef-d’oeuvre, au même titre que La route.
Cette espèce de thriller – même si le terme n’est pas vraiment approprié – est probablement de son livre le plus accessible, car il y a une véritable intrigue, prenante, avec de nombreux rebondissements, qui fait office de colonne vertébrale au roman.
Attention, l’oeuvre n’est pas d’une lecture facile pour autant : l’histoire est terrible, l’ambiance oppressante, les faits sanglants.
Le livre de Joe – Jonathan Tropper (2003)
10/18 – 416 pages – 8.80 €
Le pitch : A priori, Joe Goffman a tout pour lui : un quatre pièces dans les quartiers chic de Manhattan, des aventures sentimentales en série, une décapotable dernier cri et des dollars comme s’il en pleuvait.
Une vie de rêve née deux ans plus tôt, avec la parution de son premier roman Bush Falls, un best-seller corrosif rapidement adapté à l’écran. Dans ce livre, il évoquait une adolescence passée entre un père et un frère moins préoccupés à l’aimer qu’à marquer des paniers au basket, ses deux meilleurs amis ne trouvant rien de mieux à faire que d’afficher leur relation homosexuelle dans une petite ville de province très conservatrice !
Seulement voilà, ce passé riche en névroses irrécupérables refait surface lorsque le père de Joe plonge brutalement dans le coma. Contraint de courir à son chevet, le romancier, qui n’a pas remis les pieds à Bush Falls depuis dix-sept ans, va se frotter à l’hostilité des résidents locaux, bien décidés à lui faire payer ses écarts autobiographiques.
Mon avis : Dès son premier roman, en 2004 – car Le livre de Joe est un premier roman, aussi incroyable que cela puisse paraître quand on découvre la maîtrise narrative déployée et la maturité des thèmes abordés – Tropper a remporté un très grand succès, d’ailleurs plus commercial que critique.
Car, voilà son seul malheur, sa plume terriblement spirituelle et sa manière de se moquer apparemment des sujets les plus graves ont souvent généré une bonne dose de dédain de la part des pisse-vinaigres de la critique.
Ne vous fiez pas à ces empêcheurs de tourner en rond. Si Jonathan Frenzen vous barbe, si Richard Ford vous endort, précipitez vous sur les romans de Jonathan Tropper !
Le dernier arbre – Tim Gautreaux (2003)
Points – 480 pages – 8.10 €
Le pitch : Byron Aldridge, constable d’une scierie de Louisiane, noie dans l’alcool et la musique les traumatismes de la Grande Guerre. Pour le sauver, son frère Randolph rejoint l’exploitation. L’un fait régner l’ordre à coups de feu, l’autre croit au dialogue.
Au cœur des marais, les deux frères vont devoir s’allier pour affronter les Buzetti, gangsters propriétaires du saloon, qui ont juré de les tuer avant le dernier arbre coupé…
Mon avis : Comment ai-je découvert Tim Gautreaux ? Eh bien… un peu malgré moi, car l’auteur américain n’est quasiment pas connu en France et, il faut le dire, le titre et la couverture de son roman le plus connu sont bien peu engageants !
Heureusement, quelque chose dans le pitch du Dernier arbre m’a accroché l’œil et, même si l’ouvrage est resté sur une étagère plus d’un an, j’ai fini par l’ouvrir.
Dès le premier chapitre : magie littéraire, j’ai été aspiré et transporté dans le temps (l’après première guerre mondiale), l’espace (le fin fond de la Louisiane) et, dès lors, plus rien n’a compté…
Disons le tout net : ce premier roman de Tim Gautreaux, publié en France (mais le deuxième dans l’ordre chronologique) écrit à l’âge à l’âge de 56 ans, est un grand livre.
Le déclin de l’empire Whithing – Richard Russo (2001)
10/18 – 640 pages – 10.20 €
Le pitch : Bienvenue à Empire Falls, autrefois puissant centre industriel du Maine, à présent livré à la faillite et l’ennui. Miles Roby est gérant d’un snack. Sa femme l’a quitté, leur fille fait sa crise d’adolescence, Max, son père, est un profiteur excentrique, et Mrs Whithing, sa patronne, le tyrannise.
Coincé dans cette vie misérable, hanté par le souvenir d’une mère dévouée, Miles veut comprendre.
Entre secrets et mensonges, drames et joies, les histoires se mêlent dans cette fresque romanesque, prix Pulitzer 2002, où Richard Russo dresse avec humour et tendresse le portrait de l’Amérique d’aujourd’hui.
Mon avis : Richard Russo est un des auteurs américains majeurs de ses trente dernières années et, s’il ne fallait qu’un exemple pour le démontrer, c’est certainement avec ce merveilleux roman, son chef d’oeuvre, qu’il faudrait le faire. Voilà, je n’ai rien d’autre à ajouter. Lisez le.
Non, cela ne vous suffit pas ? Vous ne me faites pas confiance ? Quel dommage… me voilà donc obligé de m’employer à vous en convaincre !
La dernière récolte – John Grisham (2001)
Pocket – 456 pages – 8.20 €
Le pitch : ous les étés, dans la bourgade de Black Oak, Arkansas, les paysans se préparent à la récolte du coton. La ferme Chandler, dirigée par le solide grand-père Eli, recrute les indispensables saisonniers, » ceux des collines » et les Mexicains. Ensemble, ils ramasseront le coton avant la saison des inondations.
Pour le petit Luke Chandler, c’est toujours l’occasion de rencontres, même si la cueillette est difficile pour un enfant de sept ans. Mais Luke ne compte pas rester à la ferme : plus tard, c’est sûr, il deviendra professionnel de base-ball…
Pour l’heure, au cours de ce qui sera sa dernière récolte, Luke va cueillir les premières leçons de la vie. Et elles ne seront pas toujours aussi douces que du coton…
Mon avis : Mine de rien, au cas où certains l’ignoreraient, John Grisham est un homme du sud. Né dans l’Arkansas, il a passé l’essentiel de son enfance, de son adolescence et de ses études dans le Mississipi, où il devient avocat (pendant dix ans) avant d’être élu à la chambre des représentants.
C’est donc un vrai gars du deep south.
Tout cela pour en arriver au fait qu’au delà de sa réputation de meilleur auteur de thriller juridique (genre qu’il a probablement d’ailleurs inventé), il n’a jamais laissé tombé les thèmes du sud.
Mais s’il a situé nombre de ses romans dans un cadre géographique et thématique du sud des Etats-Unis, La dernière récolte est certainement son roman le plus personnel, dont l’inspiration autobiographique transparaît dès la première page. C’est en effet un jeune garçon, Luke, qui est le narrateur. A travers sa vision de gamin, c’est toute une époque et un cadre de vie qui resurgissent, sous les yeux du lecteur.
Les locataires de l’été – Charles Simmons (1998)
Libretto – 160 pages – 8.30 €
Le pitch : « C’était pendant l’été de 1968 que je tombai amoureux et que mon père se noya. »
Cette première phrase cinglante annonce sans préavis les événements qui bouleverseront la vie d’un adolescent qui durant la belle saison tombera amoureux de la petite voisine, découvrira que son père est lui aussi tourmenté par le désir et se trouvera confronté à la mort… Un livre où le sens de la formule et un récit ensorcelant ne sont pas sans rappeler les plus grandes tragédies grecques.
Mon avis : Je dois bien vous avouer quelque chose : si j’ai découvert et acheté ce livre, c’est bien parce que je suis tombé en arrêt devant sa magnifique couverture, éclairée par ce lumineux tableau d’Edward Hopper.
Comment mieux traduire la luminosité, la transparence d’un après-midi d’été sur la mer, qu’avec cette image d’un voilier flottant entre la mer et le ciel d’un pareil bleu opalescent, sur lequel quatre silhouettes jeunes regardent dans la même direction ?
Rarement une illustration aura mieux reflété le contenu et l’ambiance d’un roman que ce tableau.
Les locataires de l’été n’est, pendant presque l’intégralité des 150 pages du livre, qu’une sorte de conte d’été presque magique, tant il restitue avec perfection la légèreté de certaines journées que vous, moi, avons vécu un jour de vacances au bord de l’océan.
Mille femmes blanches – Jim Fergus (1998)
Pocket – 512 pages – 7.90 €
Le pitch : En 1874, à Washington, le président Grant accepte la proposition incroyable du chef indien Little Wolf : troquer mille femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l’intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart viennent en réalité des pénitenciers et des asiles…
L’une d’elles, May Dodd, apprend sa nouvelle vie de squaw et les rites des Indiens. Mariée à un puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre tribus et les ravages provoqués par l’alcool. Aux côtés de femmes de toutes origines, elle assiste à l’agonie de son peuple d’adoption…
Mon avis : Lorsque ce roman sort en France, en 2000, publié par Le Cherche Midi, l’éditeur est bien incapable d’imaginer le succès qu’il va remporter.
Ce récit a certes reçu un accueil largement positif, deux ans plus tôt, aux U.S., mais de là à vendre plus de 400 000 exemplaires sur notre territoire, grâce à la magie du bouche-à-oreille… !
En découvrant cette histoire, près de vingt ans plus tard, il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre les raisons de ce vif succès : Mille femmes blanches est le prototype absolument parfait du roman à trame historique à la fois bien écrit (le style est d’une fluidité parfaite), très habilement composé, mêlant aventures exotiques, pédagogie historique et ethnique, tout en délivrant un message humaniste sincère…
L’homme qui voulait vivre sa vie – Douglas Kennedy (1998)
Pocket – 512 pages – 7.90 €
Le pitch : Un poste important, une vaste maison, une femme élégante, un bébé : pour tout le monde, Ben Bradford a réussi.
Pourtant à ses yeux, rien n’est moins sûr : de son rêve d’enfant – être photographe – il ne reste plus rien. S’il possède les appareils photo les plus perfectionnés, les occasions de s’en servir sont rares. Et le sentiment d’être un imposteur dans sa propre existence est de plus en plus fort.
Mon avis : L’homme qui voulait vivre sa vie est le premier roman de Douglas Kennedy (si l’on met de côté le merveilleux Cul de sac, renommé Piège nuptial).
C’est aussi celui qui m’a fait découvrir ce très grand écrivain populaire – dans le sens noble du terme – alors que sa notoriété n’avait pas encore explosé.
C’est aussi probablement son livre le plus efficace, si ce n’est son meilleur, car on y trouve tout ce qui fera de Kennedy, pendant plus de dix ans, un des plus grands story teller du début du siècle.
On y trouve déjà son « truc » narratif, avant qu’il n’en fasse – parfois – un procédé : la bascule d’un destin. Un homme, installé confortablement dans sa vie, va prendre de plein fouet un événement qui va le contraindre à se réinventer et à passer à autre chose.
Je ne vais pas y aller par quatre chemins : ce roman est une merveille de tourne page, un prototype du genre.

Minuit dans le jardin du bien et du mal – John Berendt (1994)
Pocket – 388 pages – 4.50 €
Le pitch : Savannah, Géorgie, une ville orgueilleusement repliée sur elle-même depuis des siècles, dernier vestige du vieux Sud. John Berendt, un journaliste new-yorkais, y débarque un jour et, littéralement envoûté par l’élégance mystérieuse de la cité, il décide de partir à sa découverte.
Pendant huit ans, il analyse la société savannahienne avec une minutie digne d’un entomologiste. Il va être le témoin d’événements extraordinaires et rencontrer des personnages extravagants : un vieux Noir, qui s’obstine à promener un chien mort depuis vingt ans, un biologiste névropathe qui menace d’empoisonner la ville entière , un sublime travesti noir prénommé Chablis, une femme, médecin vaudou qui se livre à d’étranges pratiques la nuit dans les cimetières, un richissime antiquaire, meurtrier de l’un de ses amants, dont l’incroyable procès-fleuve va déchaîner les passions…
Mon avis : Nombreux sont les cinéphiles amateurs du beau film de Clint Eastwood. Mais quand je leur explique qu’il s’agit de l’adaptation d’un des chefs-d’oeuvre de la littérature américaine, ils sont la plupart du temps complètement surpris.
En France, personne ne connaît ce merveilleux récit, alors que c’est un best-seller absolu aux États-Unis. Il est donc temps que j’en fasse la promotion !
Tout d’abord, une précision : ce livre est l’exact mélange entre un roman et une chronique documentaire, un mélange tout à fait unique à ma connaissance dans la littérature.
Le droit de tuer – John Grisham (1994)
Pocket – 696 pages – 8.90 €
Le pitch : À Clanton, dans le Mississippi, la petite Tonya Hailey est sauvagement violée et torturée. En plein tribunal, son père, Carl Lee, tue les deux accusés. Son sort semble scellé : la chambre à gaz.
En effet, nous sommes dans le sud des États-Unis et Carl Lee est afro-américain… Mais Jake, un jeune avocat blanc, décide de le défendre. Le Ku Klux Klan fait front. Bientôt la haine embrase la petite ville de Clanton…
Mon avis : Un des grands romans de John Grisham – un homme du sud (il faut absolument lire La dernière récolte qui représente l’essence même du roman sudiste) – sur le racisme ordinaire (si l’on peut dire !) des états du sud des Etats-Unis.
Sur près de 700 pages, l »histoire est terrible, passionnante, haletante. Elle se déroule à une époque où cela ne dérangeait pas tant de monde que ça de voir des hommes avec des robes et des cagoules défiler dans les rues…
Grisham parvient, comme dans tous ses meilleurs thrillers juridiques, à insérer et magnifier un sujet sociétal ou politique majeur dans le cadre d’un procès.
Je vous défie de ne pas avoir les tripes nouées à la lecture de certains passages ! Voilà le plus grand talent de Grisham : parvenir à sortir d’un classique sujet théorique et le personnaliser jusqu’à ce que ses lecteurs se sentent moralement et personnellement impliqués…
NB : l’histoire sera prolongée des années plus tard par l’auteur dans un roman (presque) aussi réussi, L’allée du sycomore.
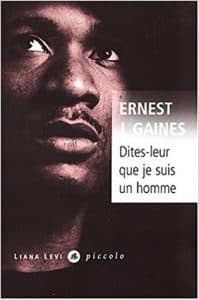
Dîtes-leur que je suis un homme – Ernest J. gaines (1993)
Editions Liane Levi – 304 pages – 10.50 €
Le pitch : Dans la Louisiane des années quarante, un jeune Noir, démuni et illettré, est accusé d’avoir assassiné un Blanc.
Au cours de son procès, il est bafoué et traité comme un animal par l’avocat commis d’office. Si le verdict ne fait aucun doute, l’accusé, lui, décide de mener un combat pour retrouver aux yeux de tous sa dignité humaine…
Mon avis : Une fois de plus, le syndrome du titre traduit de travers a frappé !
Si vous lisez ce merveilleux texte – ce dont j’espère vous convaincre ! -, vous comprendrez mon étonnement à la découverte du titre original : A lesson before dying. Un titre tellement, tellement plus beau, mais aussi fidèle à l’esprit du roman !
Mais fi de ces remarques liminaires ! Attaquons-nous au cœur du sujet : la promotion du chef-d’oeuvre d’Ernest J. Gaines.
Car ce roman de trois cents pages au style sec comme une barre de céréales mais au cœur fondant comme le plus délicieux des gâteaux à la crème (à la réflexion, je ne suis pas certain que l’excellence de mes métaphores gastronomiques vous frappe…) est un des meilleurs livres américains que j’ai eu l’occasion d’apprécier sur le sujet de la négritude et de ses malheureux corollaires, le racisme et la ségrégation.
Vous avez lu et apprécié Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, d’ Harper Lee, j’imagine ? Alors ce roman est pour vous.
Sur la route de Madison – Robert James Waller (1992)
Pocket – 190 pages – 7.00 €
Le pitch : Francesca Johnson, fermière de l’Iowa, était seule cette semaine-là ; son mari et ses enfants s’étaient rendus en ville pour la foire agricole. Sa rencontre avec Robert Kincaid, écrivain-reporter qui photographiait les ponts du comté de Madison, eut lieu au cours de l’été 1965.
Dès leur premier regard, ils surent qu’ils étaient faits l’un pour l’autre de toute éternité. Ils ne disposaient que de quelques jours pour se connaître, s’aimer et vivre une vie entière de passion silencieuse, avide et sans espoir.
Mon avis : Sur la route de Madison, pour 95 % de nos compatriotes, c’est un film réalisé en 1995 par Clint Eastwood avec, dans les rôles principaux, Meryl Streep et lui-même. Un immense succès mondial, parfaitement justifié, tant l’éphémère histoire d’amour entre les deux personnages était racontée et filmée avec finesse et émotion.
Mais avant le film, il y avait, un livre, publié juste avant (Spielberg avait acheté les droits pour le cinéma avant même la publication du livre), qui s’est vendu à… 60 millions d’exemplaires !
L’auteur, Robert James Waller, est un universitaire qui s’est mis à l’écriture tardivement. Le personnage principal, Rober Kincaid a, dans le livre, exactement son âge (52 ans) et c’est, comme lui, un passionné de photographie (la seule différence étant que Kincaid en a fait sa profession).
Si vous avez un coeur et une âme, vous ne pourrez qu’être bouleversé par cette histoire d’amour qui touche à l’absolu.
Une prière pour Owen – John Irving (1989)
Points roman – 752 pages – 12.30 €
Le pitch : » Quand meurt, de façon inattendue, une personne aimée, on ne la perd pas tout en bloc ; on la perd par petits morceaux, et ça peut durer très longtemps. »
Depuis le Canada où il s’est installé, John évoque avec nostalgie le puzzle de sa jeunesse, dans une petite ville du New Hampshire : la vie de collégien, les premiers émois amoureux, la quête du père inconnu, les débuts sournois de la guerre du Vietnam ; et par-dessus tout l’amitié parfaite avec Owen – l’irrésistible Owen qui s’était voué à la double tâche de réparer le tort causé à John et de sauver le monde.
Mon avis : Probablement le sommet de l’oeuvre romanesque de John Irving, Une prière pour Owen est un roman complexe et simple à la fois, drôle et terriblement triste, optimiste et profondément pessimiste, porteur d’une réflexion profonde sur la nature et la destinée humaine.
Indispensable.
Dalva – Jim Harrison (1988)
10/18 – 471 pages – 7.50 €
Le pitch : Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva s’installe dans le ranch familial du Nebraska et se souvient : l’amour de Duane, les deuils, l’arrachement à ce fils nouveau-né qu’elle cherche obstinément.
Meurtrie mais debout, elle découvre l’histoire de sa famille liée à celle du peuple sioux et d’une Amérique violente. Chef-d’œuvre humaniste, Dalva est un hymne à la vie.
Mon avis : Jim Harrison est l’écrivain des grands espaces, mais aussi celui qui a porté pour la première fois l’attention de la littérature américaines sur les minorités indiennes.
Depuis, combien d’auteurs ont-ils repris le flambeau, rendant le genre incroyablement populaire ? Des dizaines !
A lire, indispensable, au même titre que les nouvelles rassemblées sous le titre Légendes d’Automne.
Beignets de tomates vertes – Fannie Flag (1987)
J’ai lu – 473 pages – 7.80 €
Le pitch : Evelyn Couch, une femme entre deux âges (« Je suis trop jeune pour être vieille et trop vieille pour être jeune » dit-elle), dépressive, rend visite à une parente dans un hôpital.
Là, elle fait la rencontre d’une charmante octogénaire, Ninny Threadgoode, qui lui raconte des histoires vécues soixante ans plus tôt.
Cette rencontre va bouleverser sa vie.
Mon avis : Ce roman publié en 1987 fait partie d’une catégorie bien particulière : celle des œuvres qui ont remporté un succès formidable au moment de leur sortie dans leur pays d’origine puis qui, dans les vingt ans qui ont suivi, ont vu leur notoriété cannibalisée par l’adaptation cinématographique.
Demandez autour de vous : vous verrez que le titre évoque le film (excellent d’ailleurs) dans la plupart des esprits. Et pourtant… quel bouquin formidable !
Formidable dans sa composition, complexe, ambitieuse, avec une multitude de courts chapitres où se croisent les voix de différents narrateurs (et d’une chronique de journal) au fil du temps (un demi-siècle, avec des allers et retours incessants).
Formidable dans son contenu avec de nombreux sujets très sérieux (le racisme en premier plan, mais aussi la misère, le féminisme, l’homosexualité) traités avec un talent fou.
Lonesome dove – Larry McMurtry (1985)
Gallmeister – 1184 pages – 2*12.00 €
Le pitch : À Lonesome Dove, Texas, les héros sont fatigués. Augustus McCrae et Woodrow Call ont remisé leurs armes après de longues années passées à combattre les Comanches. En cette année 1880, pourtant, l’aventure va les rattraper lorsqu’ils décident de voler du bétail au Mexique et de le convoyer jusque dans le Montana pour y établir un ranch.
Commence alors un immense périple à travers l’Ouest, au cours duquel le convoi affrontera de violentes tempêtes, des bandes de tueurs et d’Indiens rebelles… et laissera de nombreux hommes derrière lui.
Mon avis : Lonesome dove est un roman d’aventure, c’est aussi un pur roman western au cours duquel, pendant 1 200 pages, le lecteur suit une bande de cowboys décidés à voler, puis à convoyer un immense troupeau de vaches tout le long de la côte ouest américaine, du sud au nord.
Attention : ne fuyez pas ! Les mots western et cowboys évoque chez les français, la plupart du temps, des films un peu surannés avec John Wayne en héros fort et solitaire ou, au mieux quelques longs métrages où Clint Eastwood cligne des yeux en regardant le soleil se coucher à l’horizon… et pourtant, Lonesome dove est à mille lieues de ces images d’Epinal !
Non, je peux vous l’assurer, Lonesome dove est un des plus beaux romans d’aventure psychologique de toute l’histoire de la littérature américaine. Rien que ça.
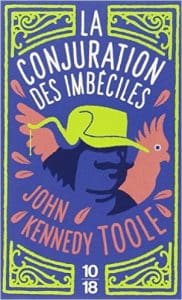
La conjuration des imbéciles – John Kennedy Toole (1980)
10/18 – 448 pages – 9.60 €
Le pitch : À trente ans passés, Ignatus vit encore cloîtré chez sa mère, à La Nouvelle-Orléans. Harassée par ses frasques, celle-ci le somme de trouver du travail. C’est sans compter avec sa silhouette éléphantesque et son arrogance bizarre…
Chef-d’oeuvre de la littérature américaine, La Conjuration des imbéciles offre le génial portrait d’un Don Quichotte yankee inclassable, et culte.
Mon avis : Passer des heures (ou plutôt : des pages) à vous convaincre de vous précipiter sur ce roman unique serait inutile. Sachez juste, s’il vous ne l’avez pas déjà découvert auparavant par vous-même – ce qui ne doit pas être le cas car, si vous lisez ce commentaire, c’est que vous n’aviez pas jusqu’à maintenant entendu parler de ce livre, sinon pourquoi perdre votre temps ? – que ce texte possède une « signature » d’édition unique dans la littérature.
L’éditeur Walter Percy reçoit, en 1976, une femme qui l’exhorte à lire le manuscrit posthume écrit par son fils avant son suicide à l’âge de 31 ans, persuadé de son absence de talent littéraire. Un peu contre son gré, il plonge dans cet énorme roman (500 pages ultra serrées en édition poche) et découvre, totalement ahuri, qu’il s’agit d’une oeuvre majeure, inclassable.
Le livre est publié, remporte un succès phénoménal et remporte le prix Pulizer en 1981.
True Grit – Charles Portis (1968)
Editions Le rocher – 253 pages – 6.70 €
Le pitch : Une adolescente très têtue venge la mort de son père. Elle se fait aider d’un marshal borgne et d’un texas ranger assoifé d’argent.
Mon avis : Le pitch de l’éditeur est un peu court. Mais s’il résume bien l’histoire, qui est d’une certaine façon d’une linéarité exemplaire, il ne met absolument pas en valeur ce petit chef-d’oeuvre littéraire, connu uniquement en France pour l’adaptation (très fidèle) qu’en ont fait les frères Coen, mais publié uniquement en 2011 (avec une préface de Dona Tartt).
Un livre qui fait pourtant un carton aux États-Unis depuis sa sortie en 1968, où il est même devenu un vrai classique.
Inconnu ? Alors, précipitez-vous sur ce merveilleux livre, même si l’univers du « Far West » ne vous concerne pas du tout !
Outsiders – S.E. Hinton (1967)
Le livre de poche – 220 pages – 7.60 €
Le pitch : 1966. Tucsa, Oklahoma. Deux bandes rivales, les Socs, la jeunesse dorée de la ville, et les Greasers, sortes de blousons noirs aux cheveux gominés, se livrent une guerre sans merci.
Ponyboy Curtis, quatorze ans, est un Greaser. Il traîne dans les rues avec ses copains qui, comme lui, sont des loubards. Mais le meurtre d’un Soc bouleverse brutalement sa vie insouciante, le mettant hors la loi.
Au fil d’événements dramatiques, le jeune garçon va devenir adulte et faire l’apprentissage de l’amour et de la mort. Devenu un best-seller, Outsiders a été adapté au cinéma par Francis Ford Coppola, avec Matt Dillon dans le rôle principal.
Mon avis : Quel plaisir ! Aujourd’hui, j’ai la chance de m’adonner à nouveau à mon activité favorite : mettre (ou remettre) sous les feux des projecteurs un merveilleux livre un peu oublié, pour en faire profiter le plus grand nombre ! Rien que pour ce plaisir, cela valait le coup de créer ce site, je vous l’assure !
Je suis arrivé à ce court roman, il y a bien des années, comme souvent, par le chemin détourné de ma passion cinéphile.
Outsiders a en effet adapté au cinéma par le grand Francis Ford Coppola au début des années soixante, à l’époque où sa réussite commerciale lui permettait de monter à peu près n’importe quel projet (et avant que l’échec de ses studios American Zoetrope ne crashent sa carrière). Coppola adaptera d’ailleurs la même année un autre court roman de l’auteur (Rumble fish).
S.E. Hinton avait tout juste seize ans quand elle a écrit ce court récit qui met en scène deux bandes d’adolescents rivales, au fin fond de l’Amérique profonde. Comme dans West Side Story, l’affrontement des deux bandes va dégénérer et tourner au drame.
Little big man – Thomas Berger (1964)
Gallmeister – 736 pages – 13.50 €
Le pitch : Je m’appelle Jack Crabb. J’ai cent onze ans ; j’ai vécu la moitié de ma vie chez les Blancs et l’autre parmi les Indiens cheyennes. J’ai été pionnier, éclaireur, as de la gâchette, chasseur de bisons. J’ai aussi été prospecteur, joueur professionnel et tricheur, polygame et soldat. J’ai côtoyé Wyatt Earp, Buffalo Bill et le général Custer, ainsi que pas mal de braves et de chefs de différentes tribus.
Je suis le seul survivant de la bataille de Little Bighorn et le dernier témoin de la conquête de l’Ouest, qui ressemble à tout ce que vous voulez, sauf à ce qu’on vous montre au cinéma. Avant de perdre la mémoire, je vais vous raconter ma vie.
Mon avis : Vous connaissez certainement le film Little big man. Forcement, si vous êtes un brin cinéphile.
Mais je suis persuadé que, comme moi, vous n’aviez jusqu’à ce jour jamais entendu parler du roman dont est tiré le chef-d’œuvre d’Arthur Penn. Normal : aucun éditeur ne s’est donné la peine de le mettre vraiment en avant.
C’est désormais chose faite, car aux éditions Gallmeister, que je tiens une fois de plus à saluer pour sa capacité à faire vivre – ou revivre – de grands romans américains de ce côté-ci de l’Atlantique.
Et c’est un bonheur, car le roman d’une vie de Thomas Berger est tout simplement exceptionnel !
⇒ Lire la suite
Vol au dessus d’un nid de coucou – Ken Kesey (1962)
Le livre de poche – 480 pages – 8.40 €
Le pitch : « Un monde de carton-pâte peuplé de personnages en trompe-l’oeil, surgis de quelque histoire de fou qui serait vraiment drôle si ces héros n’étaient pas des types en chair et en os… »
Devenu un classique contemporain, le roman de Ken Kesey, paru en 1962, n’a rien perdu de sa puissance. Il plonge dans le chaos d’un hôpital psychiatrique où l’infirmière en chef Ratched règne en maître sur son service. Jusqu’à l’arrivée de McMurphy, un criminel qui simule la folie pour échapper à la prison.
Rebelle et gouailleur, bien décidé à redistribuer les cartes et à redonner un peu de dignité et d’espoir aux malades, il engage alors à ses risques et périls une résistance acharnée contre l’institution.
Criant de vérité, Vol au-dessus d’un nid de coucou est une dénonciation en règle de l’enfermement psychiatrique, un hymne à la vie envers et contre tous.
Mon avis : L’histoire de la littérature est parsemée de romans dont l’adaptation au cinéma a cannibalisé la réputation, au point de les rendre quasiment invisibles. Mais rares sont ceux qui, comme Vol au dessus d’un nid de coucou, ont été littéralement aspiré par le vortex de la célébrité d’un long métrage.
C’est sans doute la raison pour laquelle, pendant de très nombreuses années, j’ai totalement ignoré que le splendide film de Milos Forman était tiré d’une oeuvre littéraire ! Mais, même une fois découvert, comment parvenir à se plonger dans le roman de Ken Kesey en mettant de côté les innombrables images du film gravées dans sa mémoire ?
Les grimaces de Jack Nicholson ? Le géant indien muet jouant au basket ? L’infirmière en chef sadique ? La sortie de pêche en mer ? Les séances d’électrochoc ? Impossible : tout simplement impossible de les oublier.
Alors, je me suis lancé, la tête pleine d’images et d’émotions revisitées. Et, miracle, j’ai découvert – presque redécouvert, en fait ! – un grand roman.
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur – Harper Lee (1960)
Le livre de poche – 320 pages – 6.60 €
Le pitch : Dans une petite ville d’Alabama, à l’époque de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout.
Avocat intègre et rigoureux, il est commis d’office pour défendre un Noir accusé d’avoir violé une Blanche.
Mon avis : Tous les Américains ont lu le chef-d’oeuvre qu’est Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur à l’école.De nombreux jeunes lecteurs en ont fait de même en France, surtout au cours de ces dernières années, qui correspondent à une nécessaire période de réhabilitation d’Harper Lee. Jusqu’à il y a peu, notre beau pays n’avait pas su saluer ce chef d’oeuvre à la mesure de sa qualité.
Mais je croise encore parfois certaines personnes qui n’ont pas eu le plaisir de lire ce classique instantané. Paradoxalement, je trouve cela formidable : tant d’innocents à convertir ! Tant d’heures de plaisir à venir pour eux !
Alors, si vous en êtes (de ces innocents !), précipitez-vous sur ce chef-d’oeuvre d’humanisme, qui traite avec tant de subtilité le sujet de la ségrégation des noirs (blacks,afro-américains, le terme que vous préférez) aux États-Unis, tout en développant ce que je considère comme parmi les plus belles pages écrites sur l’enfance au cours du siècle dernier.
Butcher’s crossing – John Williams (1960)
10/18 – 336 pages – 7.80 €
Le pitch : Dans les années 1870, persuadé que seule la nature peut donner un sens à sa vie, le jeune Will décide de quitter le confort de Harvard pour tenter la grande aventure dans l’Ouest sauvage. Parvenu à Butcher’s Crossing, une bourgade du Kansas, il se lie d’amitié avec un chasseur qui lui confie son secret : il est le seul à savoir où se trouve l’un des derniers troupeaux de bisons, caché dans une vallée inexplorée des montagnes du Colorado.
Will accepte de participer à l’expédition, convaincu de toucher au but de sa quête. Le lent voyage, semé d’embûches, est éprouvant mais la vallée ressemble effectivement à un paradis. Jusqu’à ce que les deux hommes se retrouvent piégés par l’hiver…
Mon avis : Si je me suis lancé dans la lecture de Butcher’s crossing, c’est avant tout sur les promesses conjuguées de la magnifique couverture, d’une part, et du pitch de la quatrième de couverture, particulièrement séduisant.
Mais c’est aussi, lorsque j’ai réalisé, très vite, que l’oeuvre était le deuxième roman de John Williams (sur trois écrits, seulement, tout au long de sa vie, achevée en 1990) : j’ai découvert ce magnifique auteur il y a quelques années grâce à Stoner, formidable récit traduit en français grâce à Anna Gavalda.
Pourtant, ici, strictement aucun rapport avec Stoner, récit de la vie désastreuse d’un fils de paysan devenu professeur de littérature américaine. Juste un récit du midwest, une plongée dans les profondeurs du Kansas en 1870. Quatre hommes qui partent chasser le bison et affronter les merveilles, mais surtout les terribles dangers de la nature alors quasi inviolée.
Ce roman s’inscrit donc dans la mouvance du récit historique américain, centré sur la conquête, à partir de la deuxième partie du XIX° siècle des territoires inconnus, à l’ouest, et des populations « sauvages » que l’homme blanc affronte pour survivre et s’installer.
Peyton place – Grace Metalious (1956)
10/18 – 696 pages – 9.60 €
Le pitch : Etats-Unis, années 40. Peyton Place est une petite ville aux apparences tranquilles. Mais derrière les façades proprettes des demeures victoriennes ou celles plus vétustes des maisons des faubourgs, des drames se jouent.
Dans les beaux quartiers, Allison ignore tout du secret qui entoure sa naissance et du passé sulfureux de sa mère. Tout ce qui lui importe pour le moment est l’amitié de la jolie Selena Cross, issue des taudis de la ville, qui subit les violences d’un beau-père alcoolique…
Chronique au vitriol d’une petite ville américaine, où la condition des femmes est sans cesse bafouée, Peyton Place fit scandale lorsqu’il parut en 1956. Il est aujourd’hui devenu un best-seller international.
Mon avis : Peyton Place, c’est peut être un nom qui résonne faiblement dans votre mémoire, et encore…
Avant de me plonger dans la sortie en poche de cette réédition (merci aux Presses de la Cité d’avoir pris la peine de remettre ce petit bijou à la disposition des français) d’un roman de 1956, je n’avais que vaguement entendu parlé d’un feuilleton des années 50 qui avait eu un succès fou aux Etats-Unis.
Mais après avoir refermé le très épais volume (près de 700 pages en édition poche), j’étais bien mieux informé grâce à la remarquable postface d’Ardis Cameon (35 pages passionnantes). J’ai pu alors remettre les choses en perspective et reconstituer l’étonnante histoire ce livre remarquable.
A l’est d’Eden – John Steinbeck (1952)
Le livre de poche – 790 pages – 10.40 €
Le pitch : Dans cette grande fresque, les personnages représentent le bien et le mal avec leurs rapports complexes. Adam Trask, épris de calme, Charles, son demi-frère dur et violent, Cathy, la femme d’Adam, un monstre camoußé derrière sa beauté, leurs enfants, les jumeaux Caleb et Aaron.
En suivant de génération en génération les familles Trask et Hamilton, l’auteur nous raconte l’histoire de son pays, la vallée de la Salinas, en Californie du Nord.
Mon avis : John Steinbeck, écrivain majeur du XX° siècle, est avant connu pour sa capacité à écrire sur les petites gens (comme on disait dans le temps).
Ceux qui composent le peuple, ceux qui vivent en bas de l’échelle, qui affronte la misère, de manière plus ou moins courageuse, parfois drôle, parfois tragique.
Son roman le plus connu illustrant cette veine d’inspiration, c’est bien sûr Les raisons de la colère. Pourtant, aujourd’hui, avec tout le recul et l’expérience d’une vie de grand lecteur, c’est bien A l’est d’Eden que je retiendrais probablement pour illustrer le génie littéraire de Steinbeck.
Le passage du canyon – Ernest Haycox (1945)
Actes sud/Babel – 368 pages – 8.90 €
Le pitch : Oregon, 1850. Quand Logan Stuart, aventurier et homme d’affaires, arrive à Jacksonville, il découvre une bourgade sur laquelle plane la menace des Indiens… mais aussi les rivalités qui opposent prospecteurs, paysans et autres émigrants. Il va alors se retrouver au cœur de tous ces conflits.
Une bagarre qui éclate, un joueur prêt à tuer pour dissimuler ses dettes, des rumeurs qui courent, des colons soudainement massacrés, et voilà que toute une société animée par la passion de l’argent ou du jeu, l’amitié profonde ou les liaisons cachées, est sur le point d’exploser.
Mon avis : Ernest Haycox est un auteur américain ayant vécu très exactement (1899/1950) la première partie du XX° siècle.
Polygraphe assumé (une trentaine de romans, une centaine de nouvelles), il a connu dans son pays une vraie gloire de son vivant, porté par les très nombreuses adaptations de ses romans au cinéma, à la grande époque d’Hollywood.
Et en France ? Rien de rien, inconnu au bataillon ! Heureusement que, ces toutes dernières années, le grand réalisateur Bertrand Tavernier et les éditions Actes sud ont décidé de mettre – enfin ! – en lumière son œuvre, auprès des lecteurs français.
Heureusement, car quel grand écrivain que cet amateur de l’histoire fondatrice des Etats-Unis, dont l’essentiel de l’œuvre se déroule sur toile de fond de la conquête de l’ouest !
Après avoir ouvert la porte de sa bibliographie par le chef-d’œuvre Les fugitifs de l’Alder Gulch, j’ai poursuivi ma visite par le tout aussi brillant et attachant Le passage du Canyon, dans lequel j’ai retrouvé tout ce qui avait fait mon admiration et mon plaisir lors de ma lecture des fugitifs.
Les livres d’Haycox ne sont que charme et paradoxes.
Les fugitifs de l’Alder Gulch – Ernest Haycox (1942)
Actes sud/Babel – 384 pages – 8.90 €
Le pitch : Au milieu des années 1800, un couple improbable s’enfuit pour rejoindre le nouvel eldorado de la vallée de l’Alder Gulch, dans le Montana, où des milliers de chercheurs d’or s’aventurent pour faire fortune. Jeff Pierce est traqué par le frère de l’homme qu’il a tué. Sa compagne de route, Diana Castle, cherche à échapper à un mariage arrangé. Quel avenir leur réserve cet Ouest sauvage où la loi est piétinée ?
Avec ce portrait d’une communauté d’orpailleurs dans les contrées sauvages des États-Unis, Ernest Haycox se hisse au rang des plus grands auteurs de westerns. Il y déploie à merveille son art romanesque et sa connaissance de la nature humaine dans une authenticité parfaitement lyrique. Et offre au genre une héroïne forte et éclatante, un vent de modernité.
Mon avis : Vous savez quel est le plus grand plaisir d’un grand lecteur ? C’est de tomber, à peu près une fois par an, pas plus, parfois moins, sur un livre écrit par un auteur que l’on ne connait pas, dont on n’a même jamais entendu parler, et que ce livre se révèle être un vrai chef-d’œuvre, un très gros coup de foudre. C’est une rencontre de ce type que j’ai faite, ces derniers jours, avec Ernest Haycox.
Une fois le roman terminé, sidéré (pas le roman, le lecteur !), j’ai découvert qu’Haycox était considéré aux Etats-Unis comme un auteur majeur… de la première partie du XX° siècle, puis qu’il est mort (prématurément) en 1950. Un grand spécialiste de la littérature de l’ouest, de la littérature de western diraient certains, même si ce vocable me parait très réducteur, voire un peu péjoratif de ce côté ci de l’Atlantique.
Sous les dehors rugueux d’une apparente histoire d’hommes et de femmes, plongés dans la sauvage atmosphère de la ruée vers l’or des 1860’s (tout le récit, y compris les détails, s’appuie sur des faits réels), se cache un trésor de récit gorgé d’humanité et de violence, de délicatesse de sentiments et de violence terrifiante.
Les romans noirs, policiers, thrillers
Minuit à Atlanta – Thomas Mullen (2021)
Rivages/Noir – 288 pages – 20.00 €
Le pitch : Atlanta, 1956. L’ex-agent de police nègre Tommy Smith a démissionné pour rejoindre le principal journal noir d’Atlanta en tant que reporter. Mais alors que le Atlanta Daily Times couvrait le boycott organisé par Rosa Parks à Montgomery, son directeur est retrouvé mort dans son bureau, et sa femme injustement accusée d’assassinat par la police.
Qui pourrait en avoir après le principal patron de presse noir d’Atlanta ? Et qui était-il vraiment ? FBI, flics racistes, agents Pinkerton, citoyens opposés à la déségrégation : beaucoup de monde, en vérité, semble s’intéresser à cette affaire d’un peu trop près.
Après le succès de Darktown et Temps noirs, voici le troisième opus d’une saga criminelle qui explore les tensions raciales au début du mouvement des droits civiques.
Mon avis : Avec Minuit à Atlanta, voilà le troisième (et dernier) volet de cette trilogie d’Atlanta. Coup de bol pour les amateurs de polars historiques intelligents et documentés : c’est une réussite absolue et – sans doute – le meilleur de la série !
L’histoire se déroule en 1956, huit ans après le premier roman. Et si Mullen reprend une nouvelle fois ses personnages principaux, il a l’intelligence de déplacer le centre de gravité de l’histoire du milieu policier vers le milieu journalistique. Smith a quitté la police et il est devenu journaliste. Mais, être journaliste à Atlanta dans les années 50, quand on est noir, ce n’est pas plus facile – voire moins ! – que d’être flic.
Thomas Mullen développe largement le thème du rôle du journalisme noir dans ces années terribles où le pasteur Martin Luther Ling Jr lutte contre la discrimination, entrainant une partie de la population dans le début d’une révolte active qui ne va pas arrêter de s’amplifier (le roman se situe pendant la fameuse affaire Rosa Parks).
Mascarade – Ray Célestin (2017)
10/18 – 628 pages – 9.10 €
Le pitch : » C’est la guerre. En temps de guerre, on tire avant de discuter. » L’agent de police William Shoemaker, Chicago, 1925.
Du ghetto noir aux riches familles blanches, en passant par la mafia italienne tenue par Al Capone, Chicago vit au rythme du jazz, de la prohibition, et surtout du crime.
Alors que des mafieux et des politiques meurent empoisonnés après un dîner, les détectives Michael Talbot et Ida Davis enquêtent sur la disparition, à la veille de leur mariage, d’un couple de fiancés appartenant à la plus riche dynastie de la ville. Au même moment, Jacob Russo, photographe pour la police, se trouve confronté à une scène de crime qui lui en rappelle effroyablement une autre. Inspirée de faits réels, une histoire de sang et de swing sur fond de guerre des gangs.
Mon avis : Ray Célestin est le jeune auteur de polar qui monte. Après un premier titre très remarqué en 2015, Carnaval, élu meilleur premier roman de l’année par l’Association des écrivains anglais de polar (car, certes, Célestin est anglais, mais ses romans sont plus américains que nature !)), il publie en 2017 Mascarade.
Impossible de ne pas remarquer la magnifique couverture; impossible aussi de ne pas être tenté par le pitch de l’éditeur. Imaginez : un roman se déroulant à Chicago en 1925, sur fond de prohibition, en pleine guerre des gangs avec des personnages – au rôle consistant – de la pointure d’Al Capone (alors « patron » de la ville) et Louis Armstrong (alors jeune instrumentiste sur le point de devenir une star)… ?! Comment résister ? Impossible. Alors je n’ai pas résisté… et je n’ai pas été déçu !
Darktown – Thomas Mullen (2016)
Rivages/noir – 480 pages – 9.80 €
Le pitch : Atlanta, 1948. Répondant aux ordres d’en haut, le département de police d’Atlanta est forcé d’embaucher ses premiers officiers noirs. Parmi eux, les vétérans de guerre Lucius Boggs et Tommy Smith. Mais dans l’Amérique de Jim Crow, un flic noir n’a pas le droit d’arrêter des suspects, de conduire des voitures de police ou de mettre les pieds dans les locaux de la police…
Quand une femme métisse disparaît après avoir été vue pour la dernière fois dans la voiture d’un édile Blanc, Boggs et Smith soupçonnent leurs collègues de vouloir étouffer l’affaire. Leur enquête les confrontera à un policier brutal qui dirige depuis longtemps le quartier.
Mon avis : La lecture du pitch vous a donné l’eau à la bouche ? Oui ? C’est tout à fait normal, car l’idée de situer un roman policier dans le contexte historique – parfaitement véridique ! – d’un état ségrégationniste ayant permis à quelques noirs de devenir officiers de police est parfaitement géniale !
Alors n’hésitez pas une seconde à acheter cet épais roman (près de 500 pages bien denses) car les promesses du pitch sont tenues, largement.
Darktown mérite son beau titre car son intrigue est digne d’un grand roman noir, et son atmosphère est souvent irrespirable.
Avant que tout se brise – Megan Abbott (2016)
Le livre de poche – 416 pages – 7.60 €
Le pitch : Elle a les épaules élancées, les hanches étroites et mesure moins de 1,55 mètre. À quinze ans, Devon est le jeune espoir du club de gymnastique Belstars, l’étoile montante sur qui se posent tous les regards, admiratifs ou envieux. Quand on est les parents d’une enfant hors norme, impossible de glisser sur les rails d’une vie ordinaire. C’est du moins ce que pense Katie, la mère de Devon, qui se dévoue corps et âme à la réussite de sa fille, même si cela demande des sacrifices.
Lorsqu’un incident tragique au sein de leur communauté réveille les pires rumeurs, Katie flaire le danger et sort les griffes. Rien ni personne ne doit entraver la route toute tracée pour sa fille. Reste à déterminer quel prix Katie est prête à payer.
Mon avis : Situer un roman à suspens dans le milieu du sport de haut niveau, ah que voilà une excellente idée !
Sur ce point de départ assez original qui l’a visiblement merveilleusement inspiré, Megan Abbott – que j’avais repérée il y a trois ans pour Adieu Gloria, un délicieux premier roman noir « à la manière de » façon 50’s, mais version féministe – a construit un thriller absolument scotchant, qui m’a absorbé pendant deux jours.
Impossible de rendre les armes avant d’avoir terminé ce petit bijou de suspens, tant l’angoisse, distillée avec une technique diabolique par l’auteure, m’a saisi à la gorge !
Gangsterland – Tod Goldberg (2014)
10/18 – 456 pages – 8.90 €
Le pitch : Tueur à la solde de la mafia de Chicago, Sal Cupertine est ce qui se fait de mieux dans le genre : discret, redoutablement efficace et doté d’une mémoire hors norme. Jusqu’au jour où une opération tourne mal – très mal. Après avoir éliminé trois agents du FBI, Sal quitte la ville. Sa carrière est terminée. À moins que…
Une opération chirurgicale plus tard, Sal Cupertine n’est plus : voici David Cohen, rabbi à Las Vegas au sein d’un temple réformé. Armé de sa Torah, il se prend rapidement au jeu. Mais ses employeurs n’en ont pas terminé avec lui. Le cimetière dont Cohen a la responsabilité est utilisé par la mafia comme plaque tournante de trafics en tout genre et, pour ne rien arranger, le FBI est toujours à ses trousses. Bandit d’un côté, homme de Dieu de l’autre, Sal ne va pas s’en tirer si aisément !
Mon avis : Si, comme je l’imagine, vous venez de regarder la couverture – excellente ! – de ce roman puis de parcourir le pitch, vous devez être persuadé – comme je l’ai été, juste avant de l’acheter – qu’il s’agit d’un polar humoristique. Un tueur de la mafia italienne qui se retrouve dans la peau d’un rabbin, c’est l’occasion pour l’auteur de détourner tous les codes du genre et, par là même, la prévision d’un sacré bon moment pour le lecteur.
Eh bien non : ce livre n’est pas une parodie d’histoire de gangster ! Et ce n’est pas non plus un livre où vous risquez d’éclater de rire à tous les coins de page ! Par contre, l’anticipation d’une excellente lecture se justifie, largement, car ce bouquin un peu à part mérite vraiment le détour !
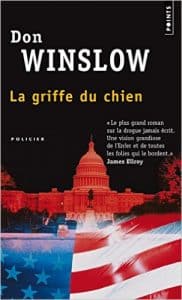
La griffe du chien – Don Winslow (2005)
Points roman – 832 pages – 8.70 €
Le pitch : Art Keller, le « seigneur de la frontière », est en guerre contre les narcotrafiquants qui gangrènent le Mexique.
Adán et Raúl Barrera, les « seigneurs des cieux », règnent sans partage sur les siccarios, des tueurs armés recrutés dans les quartiers les plus démunis. Contre une poignée de dollars et un shoot d’héroïne, ils assassinent policiers, députés et archevêques. La guerre est sans pitié.
Mon avis : Ce livre, un pavé de plus de 800 pages, est un roman, un thriller de la plus belle eau. Mais c’est aussi, en quelque sorte, une vaste fresque quasi documentaire sur la guerre menée par les États-Unis, avec plutôt moins que plus de réussite, contre les narcotrafiquants du reste du continent (et plus particulièrement du Mexique), pendant plus d’une génération.
Austère ? Que nenni ! Pas un instant ! Au contraire : dans cette saga rédigée sous la forme d’un thriller, passionnante de bout en bout, vous allez trembler, pauvres lecteurs, mais aussi découvrir tout un monde et apprendre une somme d’informations hallucinante sur la guerre des cartels.
Shutter Island – Dennis Lehane (2003)
Rivages noir – 392 pages – 8.15 €
Le pitch : Nous sommes dans les années cinquante. Au large de Boston, sur un îlot nommé Shutter Island, se dresse un groupe de bâtiments à l’allure sinistre. C’est un hôpital psychiatrique pour assassins.
Le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule ont été appelés par les autorités de cette prison-hôpital car l’une des patientes, Rachel Solando, manque à l’appel. Comment a-t-elle pu sortir d’une cellule fermée à clé de l’extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Oeuvre incohérente d’une malade ou cryptogramme ? Progressivement, les deux policiers s’enfoncent dans un monde de plus en plus opaque et angoissant, jusqu’au choc final de la vérité.
Mon avis : Shutter island est un livre un peu à part dans la bibliographie de Dennis Lehane.
Tout d’abord, comme pour Mystic river, il s’agit d’un « one shot », une histoire sans lendemain. ici, point de personnages récurrents comme dans la série des Patrick Kenzie et Angela Gennaro, où le tryptique allant de Un pays à l’aube à Ce monde disparu.
Ne le dis à personne… – Harlan Coben (2001)
Pocket – 448 pages – 7.80 €*
Le pitch : Pédiatre, David Beck exerce dans une clinique pour le compte de Medicaid, structure sociale qui prend en charge les pauvres sans couverture sociale. Il aime son métier et l’exerce avec passion. Mais sa vie a été brisée lorsque son épouse, Elizabeth, qu’il connaissait depuis l’enfance, fut assassinée par un tueur sadique qui marquait ses victimes au fer rouge.
Huit ans après ce drame, il reçoit un étrange e-mail codé dont la clé n’était connue que de lui-même et d’Elizabeth. Abasourdi, David essaie de se souvenir des détails qui entourèrent l’assassinat de sa femme, dont le propre père, officier de police, identifia formellement le corps.
Impatient, il guette le prochain message qui lui donne rendez-vous le lendemain. En cliquant sur un lien hypertexte, il découvre alors le site d’une caméra de surveillance de rue et dans la foule, il voit, stupéfait, passer Elizabeth qui le regarde en articulant « Pardon, je t’aime »…
Mon avis : C’est avec Ne le dis à personne qu’Harlan Coben, en 2001, s’est fait – outre une véritable fortune – une réputation dans le monde entier. C’est avec l’adaptation de ce thriller que Guillaume Canet, en 2006, s’est fait vraiment un nom comme réalisateur et que François Cluzet a relancé et boosté sa carrière d’acteur.
C’est dire si ce titre, considéré aujourd’hui comme l’archétype du thriller « à clef » par tous les amateurs du genre, est porteur de réussite. A juste raison car, très objectivement, le scénario de ce roman conduit de main de maître par l’auteur est un modèle de mécanique, où chaque fin de chaque chapitre est l’occasion pour le lecteur de reprendre sa respiration : Ne le dis à personne est un top Tourne Page !
Le poète – Michael Connelly ( 1996)
Le livre de poche – 768 pages – 9.20 €
Le pitch : Le policier Sean McEvoy est retrouvé mort dans sa voiture. Chargé d’une affaire de meurtre abominable, son enquête n’avançait pas. Lorsqu’il apprend le suicide de son frère, Jack, son jumeau, journaliste de faits divers, refuse d’y croire. En cherchant à comprendre, il découvre d’autres cas de policiers apparemment poussés au suicide par des meurtres non résolus. Tous ont été retrouvés avec, à leur côté, des lettres d’adieu composées d’extraits de poèmes d’Edgar Poe.
Un effrayant tableau d’ensemble commence à se dessiner. Jack fait pression sur les agents du FBI pour qu’une enquête soit ouverte sur ces suicides en série.
Mon avis : Tout le monde a lu, ou a au moins entendu parler du Poète de Connelly. Non ? Vous ne connaissez pas ? Heureux lecteur (ou heureuse lectrice) ! Vous ne savez pas la chance que vous avez : vous allez enfin découvrir le meilleur roman de Michael Connelly, mais aussi, j’ose le dire, un des classiques absolus de la littérature policière !
Mais pour quelle raison, allez-vous me demander ? Oui, pourquoi Le poète est-il un chef-d’oeuvre ? Je vous remercie d’avoir posé cette excellente question ! La réponse est paradoxale : parce qu’il ne ressemble pas aux autres livres de Connelly ! Ici, pas d’inspecteur Harry Bosch, le héros récurrent des romans de l’auteur. Et foin des personnages à la psychologie complexe qui font tout le charme de ses romans !
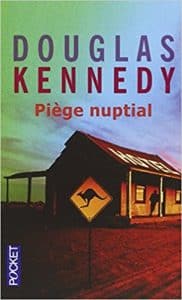
Piège nuptial – Douglas Kennedy (1994)
Pocket – 256 pages – 6.95 €
Le pitch : Fasciné par une carte d’Australie, Nick, un journaliste américain, décide de tout plaquer pour atterrir à Darwin. Une nuit fatale, un accident avec un kangourou et sa rencontre avec la jeune et robuste Angie vont le mener au coeur du bush, au milieu de nulle part, au sein d’un clan d’allumés coupés du monde.
Pris au piège, Nick va devoir user de tous les moyens possibles pour échapper à ceux qui l’ont adopté à son corps très défendant. En jeu : sa survie, tant physique que mentale…
Mon avis : Attention : Piège nuptial est le nouveau titre français (2009) du premier roman de Douglas Kenned, The Dead Heart, datant de 1994 et publié dans un premier temps en 1998 par Gallimard dans la Série Noire sous le titre Cul-de-sac.
J’ai découvert ce titre de Kennedy dans sa première mouture, il y a une dizaine d’années, après avoir apprécié tous ses premiers romans « américains » (même s’il s’agit du plus francophone des romanciers américains !).
Passé inaperçu lors de sa sortie, ce roman du bush australien est pourtant une vraie pépite, un petit bijou d’humour noir. L’histoire, totalement improbable, est à mille lieues des sources d’inspiration ultérieure de Kennedy. On pourrait la rebaptiser « Cauchemar chez les readnecks », tant le sort de Nick, le héros qui raconte cette histoire, prend le lecteur aux tripes, qui se prend au jeu en se mettant à sa place.
L’affaire pélican – John Grisham (1992)
Pocket – 432 pages – 7.90 €
Le pitch : Un flash spécial de la NBC plonge l’Amérique dans la stupeur. Le président des États-Unis annonce la mort de Jensen et Rosenberg, les deux plus hauts magistrats de la Cour suprême.
Leur disparition, à quelques heures d’intervalle, ne peut être le fait d’une coïncidence. Or ni la CIA ni le FBI ne savent par où commencer l’enquête. Seule Darby Shaw, brillante étudiante en droit, établit un lien entre les deux assassinats. Avec l’aide d’un journaliste du Washington Post, elle défie un ennemi invisible aux moyens illimités…
Mon avis : Troisième roman de John Grisham, publié un an après l’incroyable succès de La firme, L’affaire pélican remporte un succès encore plus éclatant : carrément vertigineux. En deux thrillers juridiques, l’auteur est devenu – avec Tom Clancy dont la carrière a démarré au même moment – un des deux principaux écrivains bestsellers américains. Mais était-ce mérité ?
Allez, je ne vais pas faire durer le suspens ! L’affaire pélican est, sans doute, au sens propre du terme (page turner), le meilleur Tourne Page de Grisham car c’est, probablement celui de ses romans qui présente la forme et le fond les plus évidents d’un thriller, juridique ou pas. Hollywood ne s’y trompera pas, en adaptant tout de suite le roman avec une Julia Roberts au sommet de sa jeune gloire de Pretty Woman.
Je ne vais pas revenir ici sur les raisons qui font que John Grisham est le pape du genre, mais je vais juste expliquer pourquoi ce récit est une réussite quasi parfaite.
Les égouts de Los Angeles – Michael Connelly (1992)
Le livre de poche – 576 pages – 8.20 €
Le pitch : Né d’un père inconnu et d’une mère qui se prostituait, l’inspecteur Harry (Hieronimus) Bosch – comme le peintre – voudrait bien oublier la guerre du Vietnam où il nettoyait des galeries souterraines creusées par le Viêt-Cong.
Malheureusement pour lui, l’un de ses anciens collègues, Billy Meadows, a été assassiné dans une canalisation d’écoulement des eaux de pluie d’Hollywood. Le meurtre étant lié à une affaire de braquage, il faudra bien que, secondé et manipulé par la belle Eleanor Wish, agent très spécial du FBI, il affronte à nouveau sa peur.*
Mon avis : Les égouts de Los Angeles est un récit fondateur pour Michael Connelly : il s’agit de son premier roman policier (il était auparavant journaliste). Et, forcément, première enquête pour Harry Hieronymus Bosch.
Il faut absolument que vous lisiez ce superbe roman avant les autres, car vous y trouverez à peu près tout ce qui explique la psychologie de Bosch : son enfance difficile, la guerre du Vietnam dont il ne sortira pas intact, avec les traumas liés – notamment – au monde souterrain (cela joue un rôle dans cette histoire).
La firme – John Grisham (1991)
Pocket – 480 pages – 8.40 €
Le pitch : Son attaché-case à la main, un jeune homme court à perdre haleine dans les rues de Memphis. Il s’appelle Mitch McDeere : troisième de sa promotion en droit à Harvard, il a surpris tout le monde en choisissant la firme Bendini, Lambert & Locke. Ce très confidentiel cabinet de Memphis a su, par des arguments irrésistibles, s’assurer sa collaboration.
Alors vers quel contrat mirifique notre brillant juriste est-il en train de se ruer, au point d’en oublier la gravité nécessaire à la profession ? Mitch a une excellente raison pour courir ainsi : sauver sa vie.
Mon avis : La firme est le second roman de John Grisham (après Non coupable), publié en 1991, et celui qui l’a révélé au grand public. Quand je parle de grand public, c’est un terme bien en dessous de la vérité : il vaudrait mieux parler d’immense public, car Grisham a, dès la sortie de ce livre, figuré dans le top cinq des auteurs les plus lus dans le monde… et cela fait un quart de siècle que cela dure, sans discontinuer, à raison d’un roman par an.
Grisham est l’inventeur du « thriller juridique ». L’auteur, avocat pendant près de dix ans avant de se lancer dans l’écriture, possède une connaissance solide des milieux juridiques ainsi que des procédures, tant civiles que pénales. Ces romans se passent presque tous sur une toile de fond juridique; non : en fait, le juridique ne constitue pas un fond, mais bien la colonne vertébrale de ses romans !
Dans l’expression thriller juridique, comme vous l’avez brillamment remarqué, il y a le mot thriller. Comment parvenir à passionner un lecteur, le scotcher littéralement durant 400 pages qui, le plus souvent, décrivent avec précision les méandres d’un procès ? Trois moyens :
Le silence des agneaux – Thomas Harris (1990)
Pocket – 384 pages – 6.50 €
Le pitch : Le FBI est mis en échec par un psychopathe qui accumule les meurtres dans le seul but de récupérer leur peau.
Lorsqu’il enlève la fille d’un sénateur, les fédéraux confient à la jeune Clarice Starling, encore élève stagiaire, l’inquiétante mission d’interroger le Dr Hannibal Lecter, emprisonné à vie pour meurtres et cannibalisme.
L’ancien psychiatre, grâce à ses connaissances sur la psychologie des déviants criminels, reste la seule personne à pouvoir mettre le FBI sur la piste du tueur. Lecter accepte de communiquer avec Clarice, mais à la condition qu’elle dévoile ses peurs, ses souvenirs d’enfance. En échange, il va peut-être l’aider à retrouver le tueur…
Mon avis : Courez lire, si ce n’est déjà fait, cet incroyable Tourne Page qui vous empêchera de dormir pendant une poignée de nuits :
La première, pour aller jusqu’au bout de la lecture de ce chef-d’oeuvre du thriller qui vous laissera, blême, aux lueurs de l’aube (ce moment où, coïncidence, les vampires vont se réfugier dans leur cercueil !), Les suivantes, parce que vous aurez les images terribles du roman qui vous tourneront dans la tête !
Certains d’entre vous objecteront qu’ils ont déjà visionné le formidable film avec Anthony Hopkins et Jodie Forster. Ce serait pourtant une grave erreur de faire l’impasse sur le roman de Thomas Harris. Outre le fait qu’il va beaucoup beaucoup plus loin dans les détails que son adaptation sur pellicule (et quels détails !), il est en tout point aussi parfait que le film : même tension, même plongée dans la folie du plus grand et génial des psychopathes de l’histoire de la littérature ; et même final époustouflant !
Le dahlia noir – James Ellroy (1987)
Rivages Noir – 558 pages – 10.70 €
Le pitch : Le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est découvert le corps nu et mutilé, sectionné en deux au niveau de la taille, d’une jeune fille de vingt-deux ans : Betty Short, surnommée le Dahlia Noir, par un reporter, à cause de son penchant à se vêtir totalement en noir.
Le meurtre est resté l’une des énigmes les plus célèbres des annales du crime en Amérique. Quarante après, James Ellroy s’est penché sur l’affaire Betty Short et lui a donné une solution romanesque, qu’il dédie à sa propre mère, elle-même assassinée le 22 juin 1958.
Octobre rouge – Tom Clancy (1984)
Le livre de poche – 505 pages – 8.20 €
Le pitch : Le bâtiment le plus précieux de la flotte soviétique – un nouveau sous-marin balistique commandé par son plus brillant officier – tente de passer en Amérique. La flotte soviétique entière a reçu l’ordre de le traquer et de le détruire à tout prix. Si la flotte américaine parvient à localiser Octobre rouge à temps pour l’amener à bon port, ce sera le plus beau coup de tous les temps.
Mais le sous-marin a deux millions de kilomètres carrés pour se cacher et un nouveau système de propulsion silencieux, impossible à détecter. La chasse dure dix-huit jours… À l’approche du but, tous les bâtiments convergent…
Mon avis : Tom Clancy est définitivement le pape du thriller espionnage/technologique, et Octobre rouge est la pierre angulaire de son oeuvre. Bien que le contexte politique (la guerre froide), trente ans plus tard, ait beaucoup évolué (quoi que…), ce roman n’a pas pris une ride.
Avec sa précision habituelle dans sa documentation militaire (c’est impressionnant de professionnalisme), Clancy vous embarque dans une épopée au suspens hallucinant, comme vous en lirez peu dans votre vie.
Rage noire – Jim Thompson (1972)
Rivages/noir – 217 pages – 7.00 €
Le pitch : C’est l’histoire d’un jeune noir à New York, dont la mère est blanche et qui ne connaît pas son père. Il a donc déjà des rapports terribles avec sa mère et, en plus, celle-ci l’oblige à coucher avec elle et c’est absolument épouvantable. Il atteint un degré de violence quasiment jamais atteint par un personnage de Thompson…
Et ce môme a douze ou treize ans, et il joue au noir forcené, le couteau entre les dents. Chaque fois, tous les soirs, il s’écroule à cause du rôle qu’il est obligé de tenir. C’est réellement un concentré de toute l’oeuvre de Thompson.
Mon avis : Parfois, le titre français d’un roman trahit son esprit. Ici, ce n’est pas le cas, puisque le jeune héros (qui n’a pas douze ou treize ans, comme l’écrit Aain Corneau dans le pitch, mais dix-huit) est noir, et qu’il est en rage. Mais je préfère tout de même le titre américain : Child of rage (enfant de la rage). D’abord, parce que c’est un titre magnifique, mais aussi parce que cette notion d’enfant est absolument au centre du propos développé par Jim Thomson.
Thomson, c’est le plus grand auteur de roman noir américain. Mais attention : du noir de chez noir ! A chaque fois que je termine un de ces livres, je crois avoir atteint le fond de sa « noircitude » qui est, ici, plutôt une « négritude » (mauvais jeu de mot, mais vous comprendrez mieux après avoir lu le roman), et à chaque fois, je découvre encore plus de profondeur à l’abîme. Mais avec Rage noir, l’auteur atteint vraiment le fond (c’est d’ailleurs son dernier livre, publié en 1972).
Pierre qui roule – Donald Westlake (1970)
Rivages/noir – 300 pages – 8.65 €
Le pitch : À peine sorti de prison, Dortmunder retrouve son vieil ami AndyKelp qui lui propose un coup fumant : subtiliser, au beau milieu d’une exposition, une émeraude de grand prix appartenant à un petit état africain. Facile ! Il suffit de réunir une bonne équipe et de concocter un plan à toute épreuve.
Aussitôt dit, (presque) aussitôt fait. Mais en dépit d’une implacable préparation, les choses ont comme une fâcheuse tendance à dévier de leur cours. Il faut dire que l’un des complices de Dortmunder a la brillante idée d’avaler la pierre pour échapper à la police, alors forcément cela complique un peu la tâche.
Mon avis : Donald Westlake est réputé être l’auteur de roman policier le plus drôle du monde. Si vous vous lancez dans la lecture de Pierre qui roule (et vous devez absolument le faire !), vous ne pourrez qu’en convenir; comme je l’ai fait, il y a quelques années.
Il s’agit du premier titre mettant en scène Dortmunder, le héros récurrent de Westlake, ce cambrioleur qui parvient toujours, toujours, à se retrouver dans des situations absolument impossibles.
Pour s’en sortir, Dortmunder va tenter des manœuvres improbables, toutes plus foireuses les unes que les autres, qui vont logiquement le plonger dans des situations encore plus inextricables (si ! si ! c’est possible !).
Luke la main froide – Donn Pearce (1965)
Rivages/Noir – 300 pages – 9.15 €
Le pitch : Envoyé au bagne pour avoir vandalisé des parcmètres, Luke Jackson s’y lie d’amitié avec un autre détenu, Dragline, et devient très populaire grâce à son flegme et sa joie de vivre contagieuse, mais aussi parce que c’est un homme insoumis.
Son personnage, symbole de la cool attitude et emblématique de son époque, finit par incarner une sorte de mythe anticonformiste. Un mythe que les forces de l’ordre ne toléreront pas très longtemps…
Mon avis : Comment ai-je pu passer à côté de ce fantastique bouquin jusqu’en 2014, alors que j’avais vu le film, comme beaucoup, trente ans plus tôt ? Mystère. Heureusement, il n’est jamais trop tard pour bien faire, et j’espère pouvoir ici vous faire gagner le temps que j’ai perdu de mon côté !
Ce roman est donc très peu connu. Pour quelle raison ? Je l’ignore, c’est une vraie énigme, car c’est une réussite totale, merci à Rivages/noir de m’avoir attiré l’œil avec sa belle couverture, avec ce grain de papier que j’adore ! Lancez-vous donc en toute confiance dans la lecture de ce récit absolument étonnant de la vie au jour le jour dans un bagne américain après-guerre.
Pottsville, 1280 habitants – Jim Thompson (1964)
Rivages/Noir – 270 pages – 8.00 €
Le pitch : Shérif de Pottsville, 1280 habitants, Texas, au début du vingtième siècle, Nick Corey mène une vie routinière pas trop fatigante dans la mesure où il évite de se mêler des affaires de ses administrés. Débonnaire, apparemment pas très malin, il se laisse même contester et humilier en public. Comme si ça ne suffisait pas, il est cocu et aux prochaines élections, il pourrait perdre sa place.
Il décide donc de commencer à faire le ménage…
Mon avis : Pottsville, 1280 habitants, c’est le titre, revu en 2016, du célèbre roman de Jim Thompson paru sous la couverture du numéro 1000 de la série noire sous le titre saugrenu 1275 âmes. Saugrenu, puisque le titre original est POP. 1280. Pourquoi Marcel Duhamel avait-il soustrait cinq habitants au titre américain ? Mystère !
Mais je me demande tout autant aujourd’hui pourquoi Rivages/Noir, quitte à retraduire le titre (et aussi tout le roman, merci !), est presque aussi peu précis que la première version ?! Car, diantre, POP. 1280, cela se traduit par POP. 1280, un point c’est tout ! Erreur étonnante de la part de l’éditeur, mais qui n’est pas la seule, puisque le pitch du livre est carrément mal écrit, imprécis et même faux…
Bref : pouf, pouf, comme disait Desproges, en dehors de ces problèmes de couverture, qu’y a-t-il là dedans, ma bonne dame ? Eh bien, tout simplement une petite perle de roman policier ethnique et humoristique.
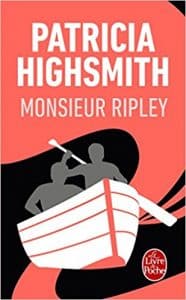
Monsieur Ripley – Patricia Highsmith (1955)
Le livre de poche – 318 page – 7.60 €
Le pitch : Italie, fin des années cinquante. Le jeune Dickie Greenleaf mène la dolce vita grâce à la fortune de son père, en compagnie de Marge Sherwood. Plutôt irrité par son comportement irresponsable, Herbert Greenleaf, riche armateur, demande à Tom Ripley de ramener son fils en Amérique.
Tom découvre un monde éblouissant, qu’il ne soupçonnait pas, et ira jusqu’au meurtre pour conserver cette vie de rêve.
Mon avis : On ne parle plus assez de Patricia Highsmith. Depuis sa mort, en 1988, elle survit dans les mémoires essentiellement grâce aux innombrables adaptations cinématographiques de ses romans (l’adaptation du présent roman est un film magnifique), alors que c’était avant tout, une auteure au style formidable. Pour moi, sans aucun doute, la reine du polar psychologique… mais aussi une championne de la nouvelle.
Mr Ripley est le roman fondateur de sa carrière et il n’a pas pris une ride (pour autant qu’un roman puisse avoir besoin un jour d’un lifting !).
Les romans fantastiques & fantasy
Le trône de fer – Intégrale T1 à 5 –
George R.R. Martin (1996 à 2012)
Editions Pygmalion – 1 044 pages (T1) 23.00 €
Le pitch : Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes…
En ces temps nimbés de brume, où la belle saison pouvait durer des années, la mauvaise toute une vie d’homme, se multiplièrent un jour des présages alarmants. Au nord du Mur colossal qui protégeait le royaume, se massèrent soudain des forces obscures; au sud, l’ordre établi chancela, la luxure et l’inceste, le meurtre et la corruption, la lâcheté et le mensonge enserrèrent inexorablement le trône convoité.
Dans la lignée des Rois maudits et d’Excalibur, Le Trône de fer plonge le lecteur, sans lui laisser reprendre souffle, dans un univers de délices et de feu.
Mon avis : Lorsque j’ai entamé la lecture de Le trône de fer, au tout début du millénaire, seuls neuf des quinze (ou plutôt trois des cinq volumes, voir plus bas) de la saga étaient parus, et les romans et le titre original, A Song of Ice and Fire (Un chant de glace et de feu) connus des seuls initiés. Quant au projet d’une adaptation (intitulé Game of thrones), il était encore dans les limbes.
Ce roman de fantasy m’avait été conseillé par un de mes amis, grand lecteur, alors que je sortais de la lecture enthousiaste d’une autre saga fantasy, L’assassin royal. Il m’avait alors dit : tu verras, Le trône de fer, c’est autre chose, c’est du costaud !.
Aujourd’hui, avec le recul, je pense qu’il était en dessous de la vérité : par l’ampleur de son récit et de son imagination, la multitude de thèmes et de personnages abordés, mais aussi par la qualité de son écriture, je pense que l’on doit placer cette série au niveau, si ce n’est devant la référence absolue en ce domaine : Le seigneur des anneaux.
Terreur – Dan Simmons (2007)
Pocket – 1 056 pages – 11.40 €
Le pitch : 1845, Vétéran de l’exploration polaire, Sir John Franklin se déclare certain de percer le mystère du passage du Nord-Ouest. Mais l’équipée, mal préparée, tourne court , le Grand Nord referme ses glaces sur Erebus et Terror, les deux navires de la Marine royale anglaise commandés par Sir John.
Tenaillés par le froid et la faim, les cent vingt-neuf hommes de l’expédition se retrouvent pris au piège des ténèbres arctiques. L’équipage est, en outre, en butte aux assauts d’une sorte d’ours polaire à l’aspect prodigieux, qui transforme la vie à bord en cauchemar éveillé.
Quel lien unit cette chose des glaces à Lady Silence, jeune Inuit à la langue coupée et passagère clandestine du Terror ? Serait-il possible que l’étrange créature ait une influence sur les épouvantables conditions climatiques rencontrées par l’expédition ? Le capitaine Crozier, promu commandant en chef dans des circonstances tragiques, parviendra-t-il à réprimer la mutinerie qui couve ?
Mon avis : Dans l’univers Dan Simmons, il y a des sommets splendides (L’échiquier du mal, Hypérion), et des abîmes sans fond (Flashback). Avec Terreur, on se retrouve clairement en altitude, pas loin d’un géant comme Ilium.
Même si ce roman n’a rien à voir avec de la Science Fiction, et si je l’ai classé dans la catégorie Fantastique, c’est uniquement pour ne pas vous tromper sur la marchandise : il y a bien un élément fantastique, très présent, dans ce très épais ouvrage (plus de 700 pages en version brochée, plus de 1 000 pages en poche), mais ce n’est pas l’essentiel du propos, loin de là.
En fait, Dan Simmons embarque ses lecteurs pour une expédition dans l’extrême Grand Nord, en plein milieu du XIX° siècle, au moment des voyages d’exploration vers les pôles. Nous voilà donc entraînés dans un voyage long, interminable (pour ceux qui qui le vivent et non ceux qui le lisent !), qui peut à peu va tourner au cauchemar. Cauchemar, car non seulement il y a le froid, dément, le vent, la promiscuité, la faim, mais il y a aussi autre chose qui rode, dehors…
World war Z – Max Brooks (2006)
Le livre de poche – 544 pages – 8.90 €
Le pitch : La guerre des Zombies a eu lieu, et elle a failli éradiquer l’ensemble de l’humanité. L’auteur, en mission pour l’ONU – ou ce qu’il en reste – et poussé par l’urgence de préserver les témoignages directs des survivants de ces années apocalyptiques, a voyagé dans le monde entier pour les rencontrer, des cités en ruine qui jadis abritaient des millions d’âmes jusqu’aux coins les plus inhospitaliers de la planète.
Il a recueilli les paroles d’hommes, de femmes, parfois d’enfants, ayant dû faire face à l’horreur ultime. Jamais auparavant nous n’avions eu accès à un document de première main aussi saisissant sur la réalité de l’existence de la survivance humaine au cours de ces années maudites.
Mon avis : Une fois de plus, nous voilà confronté au problème d’une adaptation cinématographique qui cannibalise (en l’espèce, c’est vraiment le cas de le dire !) complètement la notoriété d’un excellent livre, au point que la plupart des gens ignore même que le livre a existé.
Avec Worl War Z, que vous ayez aimé, ou détesté le film, même conseil : oubliez-le aussi vite ! Car à part quelques scènes évoquées, de-ci de-là, il n’a rien à voir avec le roman.
Roman ? Le terme paraît peu approprié puisque Max Brooks (oui ! Le fils de Mel ! Incroyable, non, c’est comme si le fils de Groucho – Marx, également ! – se lançait dans une série sur les vampires ?!) est construit comme un travail documentaire qui, sur le principe, pourrait être écrit par un historien ou un journaliste
La maison des feuilles – Mark Z. Danielewski (2000)
Denoël – 750 pages – 32 €
Le pitch : Johnny a trouvé un mystérieux manuscrit à la mort d’un vieil homme aveugle. Il décide de le mettre en forme et de l’annoter de façon très personnelle.
Le texte se présente comme un essai sur un film, le Navidson Record, réalisé par Will Navidson, un photoreporter, lauréat du prix Pulitzer. Will, qui vient d’emménager avec sa famille dans une maison en Virginie, filme son installation, réalisant une sorte de «home movie». Tout s’annonce bien jusqu’à ce qu’il découvre une pièce qui n’existait pas.
Passé l’étonnement, il se rend à une évidence troublante : la maison est plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur. Navidson tente d’explorer les lieux mais, après avoir manqué se perdre, il engage des explorateurs professionnels. L’horreur commence alors. Aussi bien pour les membres de l’expédition que pour le lecteur – lui-même égaré dans le dédale des notes qui envahissent les pages comme un lierre maléfique. Que cache la maison ? Quel est ce grondement qu’elle émet de temps en temps ? Pourquoi Johnny a-t-il ces cicatrices ? Pourquoi le manuscrit de Zampanó semble-t-il le rendre fou ?
À la fois jeu de piste, récit fantastique, dérive personnelle, essai faussement académique, La Maison des feuilles a pour effet de changer progressivement le lecteur en apprenti sorcier, monteur de salle obscure, détective amateur, spectateur. Une lecture littéralement habitée.
Mon avis : Le livre des feuilles est un OVNI littéraire publié pour la première fois en France par Denoël en 2002. Rapidement épuisé, il est réédité en 2013 dans son format d’origine par la même maison d’édition (dont il faut saluer l’extraordinaire travail de traduction et de composition, avec le concours du Centre national du livre), puis en format poche en 2015 dans la collection Point signatures.
Autant vous le dire tout de suite : inutile d’acheter ce roman unique en petit format, cela serait comme s’offrir Le déjeuner sur l’herbe de Monet, mais en photocopie et en noir et blanc : impossible de rendre justice à ce livre improbable, si ce n’est dans son format originel !
Et 32 €, pour un tel ouvrage, 750 pages d’un format exceptionnel (23.5*17.5 cm) imprimé sur un extraordinaire papier à la fois lourd et très fin, dans une dimension, ce n’est absolument pas exagéré.
Enchantement – Orson Scott Card (1999)
Points – 580 pages – 4.90 €
Le pitch : 1975. La famille du jeune Ivan, dix ans, s’apprête à quitter l’URSS pour échapper aux persécutions antisémites. En attendant le visa, la famille se réfugie à la campagne. Le paradis pour Ivan qui explore la forêt… et y découvre une princesse endormie. Mais un monstre le fait fuir. Le temps passe…
1991. Ivan prépare son doctorat. Son sujet : les contes de fées. La chute de l’URSS permet au jeune homme devenu américain de revenir à Kiev travailler sur les archives. Mais Ivan retrouve la clairière de son enfance… Peu avant l’an 1000.
Dans un univers parallèle, la sorcière Baba Yaga et son mari l’Ours préparent de mauvais coups. L’une de leurs victimes, la princesse Katerina, est endormie aux limites de ce monde alternatif et du nôtre. Le baiser d’Ivan la réveille…
Mon avis : Orson Scott Card est un formidable auteur, connu dans le monde entier pour son best-seller absolu (et mérité) La stratégie Ender. Mais il a dispersé son talent, beaucoup trop écrit, et surtout pour d’innombrables déclinaisons autour d’Ender d’un intérêt discutable.
Alors, quand je suis tombé sur ce récit, un peu tard (le roman date de 1999) je me suis réjoui de retrouver le Card des débuts, l’auteur fabuleux des Maîtres chanteurs, d’Espoir-du-cerf, ou de la saga d’Alvin le faiseur. Un auteur capable d’élever son imagination vers des terres magiques, inconnues, poétiques…
Enchantement est un… enchantement, ça y est je l’ai fait, un parfait mélange entre notre monde réel et un univers que l’on qualifierait un peu rapidement de conte de fées. Ce gros roman (580 pages en édition poche) est bourré jusqu’à la gueule d’idées, de péripéties, d’humour, de personnages étonnants.
L’assassin royal – Robin Hobb (1995 à 1997)
J’ai lu – 1 118 pages – 18.90 €
Le pitch : Au royaume des six Duchés, le prince Chevalerie, de la famille régnante des Loinvoyant – par tradition, le nom des seigneurs doit modeler leur caractère- décide de renoncer à son ambition de devenir roi-servant en apprenant l’existence de Fitz, son fils illégitime. Le jeune bâtard grandit à Castelcerf, sous l’égide du maître d’écurie Burrich.
Mais le roi Subtil impose bientôt que Fitz reçoive, malgré sa condition, une éducation princière. L’ enfant découvrira vite que le véritable dessein du monarque est autre : faire de lui un assassin royal. Et tandis que les attaques des pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater à chaque instant que sa vie ne tient qu’à un fil : celui de sa lame…
Mon avis : Cet énorme volume dont la lecture va vous emmener, non pas au bout de la nuit, mais de plusieurs nuits, est paru à l’origine, en France, en six tomes. Il constitue le roman, finalisé, de L’Assassin royal, imaginé par Robin Hobb entre 1995 et 1997, qui le considérait comme clôt, définitif.
Ce premier cycle, qui se suffit à lui-même et constitue un chef-d’oeuvre absolu de la littérature d’héroïc fantasy. A placer sur le podium, au côté du Seigneur des anneaux et du Trône de fer; rien moins que ça.
De ces trois monuments, L’assassin royal est, de loin, le plus facile à lire et, d’une certaine manière, le plus soft, le moins noir, probablement parce que dans la tête de Robin Hobb, le roman était au départ avant tout destiné aux adolescents.
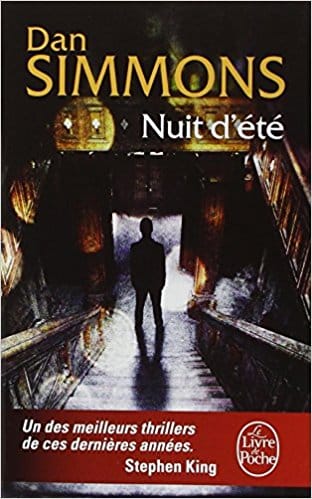
Nuit d’été – Dan Simmons (1991)
Le livre de poche – 597 pages – 7.60 €
Le pitch : Les pensionnaires d’un internat de l’Illinois sont les témoins d’une série d’événements mystérieux et terrifiants : l’un d’entre eux disparaît, des bruits incompréhensibles se font entendre, un soldat de la Première Guerre mondiale réapparaît…
L’enquête menée par un petit groupe de collégiens va les mener vers les bâtiments gothiques d’une ancienne école abandonnée, Old Central. Et c’est, au coeur de l’été, le plus insoutenable des face-à-face qui commence : celui qui met aux prises l’innocence avec la plus monstrueuse terreur qu’on puisse imaginer…
Mon avis : Un des plus grands plaisirs de lecteur est de découvrir tardivement un roman d’un de ses auteurs de genre favoris, roman qui vous avait échappé jusqu’alors pour une raison inconnu. C’est ce qui vient de m’arriver avec Nuit d’été, de Dan Simmons, un des meilleurs auteurs de SF et de fantastique du dernier quart de siècle.
Et ce plaisir a été prolongé tout au long de ma lecture, car le titre fait partie des tops de l’auteur qui, depuis toujours, alterne les chefs-d’oeuvre (Hypérion, L’échiquier du mal, Terreur, Ilium) et les loupés (Flashback, Drood). Il s’agit pourtant d’un roman horrifique, alors que Simmons préfère d’habitude, lorsqu’il s’éloigne de la SF, s’aventurer dans la littérature fantastique. Mais la réussite est indiscutable, magistrale même,
Le mystère du lac – Robert R. McCammon (1991)
Le livre de poche – 768 pages – 7.60 €
Le pitch : Ce que le petit Cory a vu ce matin froid de printemps, au fin fond de l’Alabama, jamais il ne pourra l’oublier : une voiture folle, surgie de nulle part, s’enfonçant dans les profondeurs du lac, un inconnu attaché au volant par des menottes. il luttera de toutes ses forces d’enfant pour découvrir la vérité et conjurer les puissances démoniaques que le mystère du lac a libérées. une étrange prêtresse noire, centenaire, tentera de le guider…
À la lisière du fantastique et du merveilleux, dans le décor mythique du sud profond, Le Mystère du lac évoque, au long d’un périlleux parcours initiatique, les sortilèges d’un pays à jamais disparu : celui de l’enfance.
Mon avis : Parfois, la découverte d’un auteur tient à pas grand chose. Une discussion, un titre évoqué à la radio ou à la télévision, un avis écrit sur un post-it… Avec Robert McCammon, c’est le destin.
Un bouquin trouvé au fond d’une brocante. Improbable, tant les livres de l’auteur ont été soigneusement évités par l’édition française. Incroyable : comment un auteur aussi encensé et connu aux Etats-Unis – quasiment l’équivalent de Stephen King dans la littérature fantastique – peut-il être aussi ignoré en France ? Plus de vingt romans publiés aux US, et tout juste une demi-douzaine en France, la plupart étant épuisés depuis belle lurette ?!
Et pourtant… Le mystère du lac est un grand roman de pur divertissement, tel qu’on rêve d’en lire enfant, adolescent, adulte… à tous les âges de la vie. Près de 800 pages qui vont vous entraîner dans un autre monde.

L’échiquier du mal – Dan Simmons (1989)
Folio SF – 1 024 pages – 15.50 €
Le pitch : Ils ont le Talent. Ils ont la capacité de pénétrer dans notre esprit pour nous transformer en marionnettes au service de leurs perversions et de leur appétit de pouvoir. Ils tirent les ficelles de l’histoire. Sans eux le nazisme n’aurait peut-être jamais existé et nombre de flambées de violence, tueries, accidents inexpliqués n’auraient peut-être pas ensanglanté notre époque. Car ils se livrent aussi entre eux une guerre sans merci, selon des règles empruntées à celles des échecs. À qui appartiendra l’omnipotence ? À celui qui saura maîtriser pleinement son Talent. Ce sont des vampires psychiques…
Un roman-monument qui a obtenu tous les grands prix littéraires anglo-saxons en matière de fantastique.
Mon avis : J’ai eu l’occasion de célébrer à plusieurs reprises sur le site le talent multiforme de Dan Simmons, un auteur qui laissera derrière une bonne demi-douzaine de très grands livres qui auront marqué, tant la SF que la littérature fantastique : Hypérion, Ilium par exemple, pour la première, Terreur, Nuit d’été ou L’échiquier du mal pour la seconde.
Ce dernier roman est un fleuve, une somme, une cathédrale du fantastique qui charrie sur plus de mille pages bien tassées le récit fantastique et horrifique d’une lutte sur plusieurs dizaines d’années entre certains hommes normaux et d’autres qui sont, en fait, des êtres maléfiques, des sortes de vampires psychiques aux pouvoirs terrifiants.
Publié au début des années 90 chez Denoël en deux forts volumes brochés (qui sont soigneusement rangés dans ma bibliothèque…), puis en format poche en deux ou quatre volumes, ce roman indispensable est enfin publié en une intégrale en un seul volume chez Folio SF. L’occasion de découvrir, ou relire ce chef-d’oeuvre.
Ça (2 tomes) – Stephen King (1986)
Le livre de poche – 1 436 pages – 17.50 €
Le pitch : Enfants, dans leur petite ville de Derry, Ben, Eddie, Richie et la petite bande du club des ratés, comme ils se désignaient, ont été confrontés à l’horreur absolue : ça, cette chose épouvantable, tapie dans les égouts et capable de déchiqueter vif un garçonnet de six ans…
Vingt-sept ans plus tard, l’appel de l’un d’entre eux les réunit sur les lieux de leur enfance. Car l’horreur, de nouveau, se déchaîne, comme si elle devait de façon cyclique et régulière frapper la petite cité.
Mon avis : Les deux tomes du chef d’oeuvre de Stephen King (ici, les deux tomes se justifient, car le roman est énorme, plus de 3 millions de signes !).
Il est assez curieux de voir que, chez tous les fans de King, une très large majorité d’entre eux se rejoignent pour considérer ce livre comme le sommet de sa carrière, alors que sa bibliographie ne manque pas de livres remarquables. Une telle unanimité est un signe qui ne trompe pas : courrez lire Ça, vous ne vous en remettrez jamais ! Alors, pourquoi un chef-d’oeuvre ?
La raison la plus évidente semble être la capacité unique de Stephen King a faire ressentir à ses lecteurs les peurs primales et, parmi elles, les plus terrifiantes, celles de l’enfance.
Replay – Ken Grimwood (1986)
Points – 432 pages – 8.00 €
Le pitch : En ce 18 octobre 1988, Jeff Winston se trouve dans son bureau new-yorkais, et écoute sa femme lui répéter au téléphone : « Il nous faut, il nous faut… » Il leur faudrait, bien sûr, un enfant, une maison plus confortable. Mais surtout parler. A cœur ouvert. Sur ce, Jeff meurt d’une crise cardiaque.
Il se réveille en 1963, à l’âge de dix-huit ans, dans son ancienne chambre d’université. Va-t-il connaître le même avenir ? Non, car ses souvenirs sont intacts. Il sait qui va gagner le prochain Derby, et ce qu’il en sera d’IBM et d’Apple…
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir revivre son passé fort de son expérience d’aujourd’hui ? De quoi devenir l’homme le plus puissant du monde, jusqu’à… sa deuxième mort, et qu’une troisième, puis une quatrième vie commencent…
Mon avis : Voilà un des livres pour lesquels j’ai créé ce site : un chef-d’oeuvre dont la notoriété est réelle, établie depuis des années, mais cependant toujours largement insuffisante.
Il faut que vous achetiez Replay, que vous lisiez Replay, puis que vous en achetiez six exemplaires pour l’offrir à ceux qui vous sont chers, qui eux-mêmes le liront, puis…
La chaîne de l’amour du livre, faites la vivre !
Shining – Stephen King (1977)
Le livre de poche – 576 pages – 7.90 €
Le pitch : Situé dans les montagnes Rocheuses, l’Overlook Hotel est tenu pour être l’un des plus beaux lieux du monde. Beauté, confort, luxe, volupté… L’hiver, l’hôtel est fermé. Coupé du monde par le froid, la neige, les glaces. Alors seul l’habite un gardien.
Celui qui a été engagé cet hiver-là s’appelle Jack Torrance, un alcoolique qui tente d’échapper à l’échec et au désespoir. Avec lui vivent sa femme, Wendy, qui espère, grâce à cet isolement, reconstruire son foyer menacé, et surtout leur enfant. Danny. Danny qui possède le don de sentir, de voir, de ressusciter les choses et les êtres, les événements que l’on croit morts.
Ce qu’il voit, lui, dans les cent dix chambres vides de l’Overlook Hotel, c’est la présence du démon. Cauchemar ou réalité le corps de cette femme assassinée ? ces bruits de fête qui dérivent dans les couloirs ? cette vie si étrange qui anime l’hôtel ?
Mon avis : Shining est le troisième roman de Stephen King publié. Après le succès de Carrie (roman et film), l’auteur parvient à faire beaucoup mieux, puisque Shining est sans conteste un de ses chefs-d’oeuvre, et que l’adaptation au cinéma de Stanley Kubrick est tout autant une réussite éclatante qu’un énorme succès commercial. Que rêver de mieux ?!
Ce qui est le plus frappant, lorsqu’on relit cet épais roman (mais où l’on ne s’ennuie pas à une seule page !), c’est la virtuosité avec laquelle King reprend tous les thèmes sur l’enfance développés dans son premier roman (les pouvoirs parapsychologiques subis et non maîtrisés, les traumatismes familiaux avec des parents dysfonctionnels), et parvient à en faire un récit virtuose, équilibre parfait entre le thriller psychologique, le récit fantastique et le pur roman horrifique.
Shining fout la trouille, il faut le dire, le livre fait partie des quelques œuvres de l’auteur qui ne sont pas simplement inquiétantes, mais qui font viscéralement peur. Le délice de mourir de peur en lisant un roman : si vous connaissez ce sentiment, vous savez qu’il est rare en littérature, et que Stephen King est un des rares maîtres à réussir à distiller ce délicieux venin.
Entretien avec un vampire – Anne Rice (1976)
Pocket – 448 pages – 8.10 €
Le pitch : À San Francisco, un journaliste se fait approcher une nuit par un homme se prétendant être un vampire et disposé à lui livrer l’histoire de sa « vie ». Jeune propriétaire terrien vivant en Louisiane à la fin du XVIIIe siècle, Louis est un homme dépressif rongé par la culpabilité depuis la mort de ses proches.
Un soir, il est approché par Lestat, une puissante créature, qui le transforme en vampire. Mais Louis n’accepte pas cette nouvelle condition et refuse de tuer des humains pour survivre.
Après quelques années de vie commune sur la plantation de Louis, les deux vampires quittent la Louisiane pour échapper à une révolte d’esclaves ayant percé leur vraie nature. Ils s’installent alors à la Nouvelle-Orléans où Louis se met à imaginer sa vie loin de Lestat qu’il déteste. Ce dernier, ne voulant pas que son compagnon le quitte, transforme Claudia, une jeune enfant de cinq ans, pour que Louis reste à ses côtés.
Mon avis : Avec Entretien avec un vampire, Anne Rice entamait en 1974 une saga, Les chroniques des vampires, qui allait revisiter de fond en comble le mythe du vampire initié en littérature par le Dracula de Bram Stoker trois quarts de siècle plus tôt. Cette saga s’achèvera, dix tomes plus tard : le fruit d’une réussite exemplaire.
Porté à l’écran en 1994, ce roman va en effet remporter un invraisemblable succès à travers le monde. Ce succès qui sera à l’origine d’un véritable déferlement – un tsunami ! – de romans sur le mythe du vampire, deviendra même un genre littéraire à part entière !
La maison des damnés – Richard Matheson (1971)
J’ai lu – 349 pages – 6.20 €
Le pitch : Parce qu’il sent venir la mort et veut savoir si la survie est ou non une réalité, Deutsch fait appel au physicien et parapsychologue Lionel Barrett. Deutsch a acquis, dans l’État du Maine, la maison Belasco — abandonnée depuis trente ans et fatale à tout visiteur : la maison des damnés. A Barrett de percer le mystère du fantôme de Belasco. Deux spirites, un homme et une femme, accompagneront Barrett.
Et les visiteurs découvrent une demeure qui vibre encore de tous les meurtres et de toutes les profanations dont elle a été le théâtre, une demeure qui métamorphose et « possède » ceux qui osent franchir son seuil. Dans une atmosphère de cauchemar et d’orgie s’engage une lutte atroce…
Mon avis : Quant on aime Richard Matheson, le maître absolu du fantastique (n’en déplaise aux amateurs de Stephen King – dont je fais partie – qui n’est, après tout, qu’un de ces disciples !), impossible de passer à côté de ce roman, modèle absolu du genre.
Certains lecteurs pourraient, sans doute, trouver que ce texte au scénario dense, serré comme un expresso napolitain, manque d’originalité, tant il entre en résonance avec les multiples films de maison hantée tournés au cours des cinquante dernières années. Ce serait pourtant une erreur d’appréciation formidable car c’est au contraire le présent roman qui a inspiré l’intégralité des films de maison hantée !
La maison des damnés est le roman fondateur du genre, celui sans qui il ne serait sans doute pas devenu ce qu’il est…
Rosemary’s baby – Ira Levin (1967)
Pavillons poche – 368 pages – 9.50 €
Le pitch : Un cinq pièces au Bradford en plein coeur de New York, quel bonheur pour un jeune couple ! Rosemary et Guy n’en reviennent pas. Les jaloux disent que l’immeuble est maudit, marqué par la magie noire, que le sinistre Marcato y habita, que les soeurs Trench y pratiquèrent des sacrifices immondes…
Peu de temps après l’arrivée de Rosemary, une jeune fille se jette par la fenêtre. Une étrange odeur règne dans les appartements. Quant aux voisins, leurs yeux sont bizarres, leurs prévenances suspectes. Guy lui-même change, et sa jeune femme, poursuivie par des rêves atroces, lutte en vain contre une terreur grandissante. Que deviendra, dans ces conditions, le bébé de Rosemary…?
Mon avis : Vous croyez que Stephen King est définitivement le meilleur auteur fantastique de ces dernières décennies ? Ah ! Ah ! Pauvres mortels ! Il serait temps de vous plonger dans ce roman fabuleux, écrit par Ira Levin, cet important auteur passé en France un peu à côté de la postérité, pourtant largement méritée (voir par ailleurs ma critique d’Un bonheur insoutenable) !
Est-ce mieux que S. King ? Non, mais c’est aussi accompli que certains de ses meilleurs romans fantastiques.
Mais, allez-vous me dire, vous avez déjà vu l’adaptation cinématographique de Roman Polanski !… Certes, et cette adaptation, fidèle, est remarquable. Mais elle ne vaut pas le roman dont elle est tirée, qui est un petit-chef-d’oeuvre de perversité et de manipulation psychologique.
Je suis une légende – Richard Matheson (1954)
Folio SF – 240 pages – 7.20 €
Le pitch : Comme vous, il croyait que les vampires ne hantaient que les mythes de l’Europe centrale et la littérature d’épouvante. Comme vous, il se trompait.
Il est aujourd’hui l’ultime survivant d’une étrange épidémie qui a fait subir à l’humanité une mutation irréversible : le virus qui contraint les hommes à se nourrir de sang les empêche aussi de mourir tout à fait et les oblige à fuir les rayons du soleil.
Ainsi, chaque jour, Robert Neville doit organiser sa survie et chaque nuit subir les assauts des demi-morts affamés. Mais l’horreur atteint son paroxysme lorsqu’il doit résister à l’appel suppliant de la femme qu’il aime…
Mon avis : La première fois que j’ai lu ce petit chef-d’oeuvre (petit par la longueur, immense par la qualité), je devais avoir douze ans, il m’a hanté des nuits et des nuits, des cauchemars épouvantables.
L’histoire est terrifiante, et le propos universel (qu’est-ce que l’homme ?). La preuve : on n’arrête pas de l’adapter au cinéma (la version avec Will Smith est étonnamment intéressante, bien que non fidèle à bien des égards) et les idées qu’il contient ont été pillées maintes et maintes fois par les scénaristes de ces vingt dernières années.
Les romans de SF
L’homme des jeux – Iain M. Banks (1988)
Le livre de poche – 390 pages – 7.70 €
Le pitch : Dans l’empire d’Azad, le pouvoir se conquiert à travers un jeu multiforme. Jeu de stratégie, jeu de rôle, jeu de hasard, le prix en est le trône de l’Empereur.
Gurgeh est le champion de la Culture, une vaste société galactique, pacifique, multiforme, anarchiste, tolérante, éthique et cynique où le jeu est considéré comme un art majeur. S’il gagne, la paix sera sauvée entre la Culture et Azad. S’il perd…
Voici le premier volume de la fameuse série de la Culture qui a renouvelé avec humour et panache le thème de la société galactique. Il sera suivi de L’Usage des armes et d’Une forme de guerre.
Mon avis : Lorsque j’ai lu L’homme des jeux, le premier tome paru du Cycle de la Culture (mais en fait le second dans l’ordre chronologique d’écriture), j’ai tout de suite pensé que la SF s’était trouvé un nouveau maître.
Le parallèle entre les thèmes traités, le mode d’exposition, la richesse et l’ampleur de l’imagination, de Banks, d’une part, et Isaac Asimov dans son cycle de Fondation, d’autre part, écrit quarante ans auparavant, me paraît assez flagrant.
La stratégie Ender – Orson Scott Card (1985)
J’ai lu – 380 pages – 6.90 €
Le pitch : Andrew Wiggin, dit Ender, n’est pas un garçon comme les autres. Depuis sa naissance, ses faits et gestes sont observés par l’intermédiaire d’un moniteur greffé dans son cerveau. Car ceux qui l’ont conçu ambitionnent de faire de lui rien de moins que le plus grand général de tous les temps, le seul capable de sauver ses semblables de l’invasion des doryphores.
Et alors qu’Ender suit pas à pas le dur chemin de son apprentissage de guerrier, ses créateurs mesurent la gravité de leur choix : en donnant naissance à un monstre, n’ont-ils pas damné l’humanité elle-même ?
Mon avis : Orson Scott Card est un des écrivains majeurs de la SF et de la Fantaisy contemporaines, mais il est avant tout connu pour ce roman (Prix Hugo et Prix Nebula lors de sa sortie) et pour le fait qu’il est mormon.
N’hésitons pas à la dire : La stratégie Ender est un chef d’oeuvre. Il s’agit d’un des meilleurs romans initiatiques que j’ai pu lire et relire (il est très rare que je relise) au fil du temps.
Qui a t-il de plus fascinant que de suivre un enfant franchir, peu à peu, toutes les étapes qui le mèneront à l’âge adulte ?
La servante écarlate – Margaret Atwood (1985)
Pavillons poche – 544 pages – 11.50 €
Le pitch : Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d’esclaves sexuelles les quelques femmes encore fertiles.
Vêtue de rouge, Defred, » servante écarlate » parmi d’autres, à qui l’on a ôté jusqu’à son nom, met donc son corps au service de son Commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l’austérité monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler… En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté.
Mon avis : Avant qu’une com’ démente ne submerge en 2017 les amateurs de littérature américaine, à propos de La servante écarlate, j’avoue n’avoir jamais entendu parlé de ce roman vendu par millions outre-Atlantique…
Étrange, étrange, lorsqu’un livre est publié par un éditeur français en format poche… trente ans après qu’il l’ait sorti en format broché (la publication de Robert Laffont date de 1987) !
Mais sans doute, est-ce dû à la sortie et à la diffusion récente de son adaptation en série télévisée. Terrible pouvoir que celui des séries, dont celui, bénéfique finalement, que de placer sous les feux des projecteurs une oeuvre qui, jusqu’à maintenant, n’avait pas reçu en France l’accueil qu’il méritait !
Car La servante écarlate, s’il est loin d’être l’immense chef-d’oeuvre que certains veulent bien y voir, est un excellent roman, au thème intéressant, qui présente le mérite insigne (et malheureusement assez rare) de faire réfléchir le lecteur.
Ecotopia – Ernest Callenbach (1975)
Folio SF – 336 pages – 9.40 €
Le pitch : Trois États de la côte ouest des États-Unis – la Californie, l’Oregon et l’État de Washington – décident de faire sécession et de construire, dans un isolement total, une société écologique radicale, baptisée Écotopia. Vingt ans après, l’heure est à la reprise des liaisons diplomatiques entre les deux pays. Pour la première fois, Écotopia ouvre ses frontières à un journaliste américain, William Weston.Au fil des articles envoyés au Times-Post, il décrit tous les aspects de la société écotopienne : les femmes au pouvoir, l’autogestion, la décentralisation, les vingt heures de travail hebdomadaire et le recyclage systématique. D’abord sceptique, voire cynique, William Weston vit une profonde transformation intérieure. Son histoire d’amour intense avec une Écotopienne va le placer devant un dilemme crucial : choisir entre deux mondes.
Mon avis : On ne prend jamais assez de temps pour remercier certains éditeurs français, pour leur capacité à aller piocher dans la littérature américaine des décennies passées afin d’en extraire un grand roman peu connu, voire oublié du lectorat francophone et le (re)traduire et le (re)publier.
C’est le cas de l’éditeur Rue de l’échiquier qui, grâce à une traduction de Brice Mathieussent, a exhumé Ecotopia des limbes d’outre-Atlantique, 40 ans après sa première édition (chez Stock), relayé par Gallimard en format poche dans la collection Folio SF.
Rendez-vous avec Rama – Arthur C. Clarke (1975)
J’ai lu – 253 pages – 5.50 €
Le pitch : En l’an 2130… un « objet » pénètre dans le système solaire et aussitôt les ordinateurs répondent : un cylindre, longueur : 30 km, vitesse : 100 000 km/h… Il sera baptisé Rama. Le vaisseau spatial Endeavour part à sa rencontre, réussit à se poser dessus et pour le commandant Norton et ses hommes l’accès de Rama se révèle étonnamment facile.
Un étonnement qui se change en stupeur, en effroi, quand ils pénètrent dans ses flancs : il y a là quatre mille km à explorer, un monde de structures, d’escaliers vertigineux, de routes. Un monde de silence et de non-vie… Où tout semble d’une haute technologie, intact, et pourtant vieux de millions d’années !
Rama continue de fendre l’espace… Qui est aux commandes : un robot ? un esprit ?
Mon avis : Clarke était un génie. Rendez-vous avec Rama n’est pas considéré comme une de ses œuvres majeures, mais pourtant… j’ai une affection particulière pour ce roman, car c’est une histoire d’exploration, et j’adore les histoires d’exploration !
Imaginez Richard Burton (l’explorateur, pas l’acteur !) remontant, non pas les sources du Nil, mais l’intérieur d’un vaisseau-monde… Vous imaginez ? Alors, ici, vous êtes servi : un vaisseau gigantesque, aussi grand qu’un petit pays, à explorer avec, à chaque coin de rue (si je puis me permettre l’expression !) des mystères, des découvertes.
Des fleurs pour Algernon – Daniel Keyes (1972)
J’ai lu – 542 pages – 6.90 €
Le pitch : » Si l’opération réussi bien je montrerai a cète souris d’Algernon que je peux être ossi un télijen quelle et même plus. Et je pourrai mieux lire et ne pas faire de fotes en écrivan et apprendre des tas de choses et être comme les otres. «
Charlie Gordon a 33 ans et l’âge mental d’un enfant de 6 ans. Il voit sa vie bouleversée le jour où, comme la souris Algernon, il subit une opération qui multipliera son Q.I. par 3. Charles va enfin pouvoir réaliser son rêve : devenir intelligent.
Au jour le jour, il fait le compte rendu de ses progrès. Mais jusqu’où cette ascension va-t-elle le mener ?
Mon avis : Ce roman est considéré comme un classique de la science-fiction. Mais la part de science-fiction n’est qu’extrêmement réduite dans l’histoire, elle n’a même en fait aucune importance.
Certes, c’est grâce à une avancée scientifique que nous ne maîtrisons pas encore de nos jours que le « héros » du roman, ce pauvre Charlie qui a les capacités cognitives d’un tout petit enfant, se voit offrir la possibilité de devenir intelligent, très intelligent, suprêmement intelligent.
Mais tout l’intérêt du récit est de suivre comment il évolue, jour après jour, grâce au carnet de bord qu’il tient lui-même. D’une plume plus que malhabile au départ, bourrée de fôtes d’orthographe, dans un style d’une naïveté enfantine extrêmement touchante. Puis, au fur et à mesure que son Q.I. grimpe à la vitesse de la lumière, dans une langue châtiée qui dévoile lentement la profondeur stupéfiante de son intelligence et l’éclosion de son moi et de son surmoi.
Précipitez-vous sur ce roman qui, j’en suis persuadé, vous marquera pou r le reste de votre existence.
Le monde du fleuve – Philip José Farmer (1971)
Mnemos – 1 280 pages – 30 €
Le pitch : Mark Twain, Hermann Goering, Jésus, Richard Burton. Voilà quatre des quarante milliards de protagonistes de cette fabuleuse saga. Lorsque tous les morts de l’histoire de la Terre se réveillent au bord d’un fleuve long de plusieurs millions de kilomètres, c’est une nouvelle vie qui commence.
Mais au lieu de prendre cet événement comme une nouvelle chance, les ressuscités vont poursuivre ou répéter leur première existence. Et dans ce paradis où nul souci matériel n’existe, de petits états totalitaires, esclavagistes, racistes fleurissent.
Seule une infime partie de cette population décide de partir en quête : spirituelle pour certain avec la recherche d’une perfection de l’âme, plus existentielle pour ceux qui se demandent ce qu’ils font là et surtout qui les y a mis. Ils n’auront alors de cesse de remonter le fleuve pour voir ce qui se trouve à sa source.
Mon avis : L’édition en 2016 de l’ intégrale de cette saga comportant cinq volumes* est un bonheur qu’attendaient de nombreux amateurs depuis longtemps. Rien que ça, merci Mnemos !
1 280 pages serrées pour une des œuvres phare de l’histoire de la science-fiction qui, lorsque j’ai lue pour la première fois, quand j’étais encore adolescent, a marqué profondément mon imagination.
Vous avez lu le pitch : Philip José Farmer lançait en 1970 une des plus fabuleuses idées de la SF.
40 milliards d’êtres humains reprenant conscience (ressuscitant ?) au pied de champignons géants, générateurs formidables. Des hommes qui se réveillent les uns à côté des autres, toutes époques et toutes ethnies confondues. Au milieu : un fleuve géant, apparemment sans fin. Où sont-ils ? Au paradis ? En enfer ? Sur une autre planète ? A quelle époque ? Qui les a « ressuscités » ? Un ou des dieux ? Des extra-terrestres ?
Un bonheur insoutenable – Ira Levin (1970)
J’ai lu – 372 pages – 7.50 €
Le pitch : L’action de ce livre se déroule dans un futur qui n’est peut-être pas très éloigné. Toutes les nations sont désormais gouvernées par un ordinateur géant enfoui sous la chaîne des Alpes. Les humains sont programmés dès leur naissance – du moins ceux qui ont été autorisés à naître – et sont régulièrement traités par des médicaments qui les immunisent contre les maladies, mais aussi contre l’initiative et la curiosité.
Il y a cependant des révoltés. L’un d’eux, surnommé Copeau, va redécouvrir les sentiments interdits et d’abord l’amour. Il s’engage alors dans une lutte désespérée contre ce monde trop parfait, inhumain, qui accorde, certes, le bonheur à tous, mais un bonheur devenu insoutenable, parce qu’imposé.
Mon avis : Un des chefs-d’oeuvre de la dystopie, terme savant (et un peu pédant) utilisé pour désigner un récit peignant une société imaginaire organisée de telle façon qu’elle empêche ses membres d’atteindre le bonheur.
Placé au côté du meilleur des mondes, d’Huxley, ou de 1984, d’Orwell, Un bonheur insoutenable soutient franchement la comparaison sur le fond, même si Ira Levin n’est pas un styliste littéraire du même niveau que ces augustes prédécesseurs.
L’homme dans le labyrinthe – Robert Silverberg (1969)
J’ai lu – 308 pages – 7.40 €
Le pitch : « Muller vivait depuis neuf ans dans le labyrinthe. Maintenant, il le connaissait bien. Il savait ses pièges, ses méandres, ses embranchements trompeurs, ses trappes mortelles. Depuis le temps, il avait fini par se familiariser avec cet édifice de la dimension d’une ville, sinon avec la situation qui l’avait conduit à y chercher refuge. «
Tous les hommes qui avaient tenté de pénétrer dans le labyrinthe de Lemnos avant Muller étaient morts d’une façon atroce. Tous ceux qui avaient essayé de l’y rejoindre par la suite avaient été massacrés.
Aujourd’hui, Ned Rowlins a reçu l’ordre de ramener Muller sur la terre, sa planète natale. Qui, neuf ans auparavant, l’a impitoyablement chassé…
Mon avis : Les années 60 furent les années bénies de la SF d’imagination, et Robert Silverberg était l’auteur du genre doté de la plus impressionnante imagination de l’époque.
Quant à L’homme dans le labyrinthe, c’est un des romans d’aventure emblématique de ce bon vieux Robert, dont le cerveau cliquetait presque aussi vite que sa machine à écrire (ce qui n’est pas rien). C’est dire s’il serait vraiment dommage que vous passiez à côté de ce court roman qui, même s’il n’est pas parfait (trop vite écrit ? Mal poli ?), s’inscrit dans la short list des incontournables de la littérature de SF.
En fait, en relisant ce bouquin pour la trois ou quatrième fois, je n’ai pu qu’être frappé par son potentiel cinématographique. Comment se fait-il qu’aucun producteur ne se soit encore emparé de cette histoire parfaitement construite pour une adaptation sur grand écran ?
Le cycle de Tschaï – Jack Vance (1968-1970)
J’ai lu – 960 pages – 10.90 €
Le pitch : Alors qu’il effectuait une mission de reconnaissance autour de la planète Tschaï, le vaisseau Explorateur IV a été abattu par un missile d’origine inconnue. Unique survivant du crash, Adam Reith découvre un monde d’une beauté et d’une âpreté sans pareilles, une terre d’aventures aussi dangereuse qu’attachante.
Obsédé par l’idée de rentrer chez lui, le Terrien va traverser d’immenses et splendides paysages, rencontrer d’autres humains aux moeurs baroques et des extraterrestres belliqueux, vivre mille péripéties, perdre ses certitudes et trouver l’amitié. Parviendra-t-il à regagner la Terre ?
Mon avis : Le cycle de Tchaï est constitué de quatre romans qui se suivent et se lisent à la suite les uns des autres : Le Chasch, Le Wankh, Le Dirdir et Le Pnume. Comme une série TV qui se déroulerait sur quatre saisons.
Ce cycle est désormais (enfin !) disponible en un seul volume format poche (merci J’ai lu !), que vous ne regretterez pas d’avoir acheté, si ce n’est à cause de sa taille : plus de 920 pages.
Tchaï est considéré comme un des romans emblématiques de l’histoire de la SF. Une réputation tout à fait méritée car Jack Vance, entre 1968 et 1970, à littéralement imposé le cycle comme un des chefs-d’œuvre fondateurs (avec Dune, sans doute) du planet opéra, ce genre littéraire spécifique où un héros est amené à explorer une planète étrange et en affronter les dangers.
Ubik – Philip K. Dick (1966)
10/18 – 288 pages – 7.10 €
Le pitch : « Une pulvérisation invisible d’Ubik et vous bannirez la crainte obsédante, irrésistible, de voir le monde entier se transformer en lait tourné ».
Qu’est-ce qu’Ubik ? Une marque de bière ? Une sauce salade ? Une variété de café ? Un médicament ? Peut-être… Et quel est donc ce monde où les portes et les douches parlent et n’obéissent aux ordres qu’en retour de monnaie sonnante et trébuchante ? Un monde où les morts vivent en animation suspendue et communiquent avec les vivants dans les « moratoriums ».
C’est dans cet univers que Glen Runciter a créé un organisme de protection contre les intrusions mentales : télépathie, précognition, para-kinésie. Joe Chip, un de ses employés, est chargé de monter un groupe de « neutraliseurs » de pouvoirs « psy », afin de lutter contre ce qui semble être une menace de grande envergure.
Mon avis : Relire, voire même re-relire un roman qui a marqué votre jeunesse, est un exercice périlleux. Confirmation de la première impression ? Parfait ! Déception profonde ? Cruelle manière de perdre un grand souvenir !
Avec Ubik, un des sommets de l’oeuvre de Philip K. Dick, j’ai ressenti tout au long de sa lecture un léger sentiment d’étourdissement, tant l’impression ressentie s’est révélée supérieure au souvenir, pourtant superbe, que je gardais en mémoire. Explication.
Mettons de côté le fait que la traduction française du grand Alain Dorémieux, datant de 1970, a pris un sacré, sacré coup de vieux (le roman mériterait vraiment une nouvelle traduction). Mettons aussi de côté les nombreux décalages technologiques, parfois étranges, créés par le temps, un demi-siècle s’étant écoulé depuis son écriture (bien qu’on retrouve, de-ci, de-là, la capacité unique de Dick a anticiper sur le progrès, avec notamment un moteur de recherche « à la google » assez génial sur le principe).
Une fois ceci fait, il reste juste un chef-d’oeuvre.
Soleil vert – Harry Harrison (1966)
J’ai lu – 350 pages – 7.10 €
Le pitch : Tandis que l’humanité s’apprête à entrer clans le troisième millénaire, la surpopulation est devenue telle que les ressources naturelles ne suffisent plus à couvrir ses besoins. La nourriture et l’eau sont rationnées, il n’y a plus de pétrole, plus guère d’animaux. Trente-cinq millions de New-Yorkais, pour la plupart sans emploi ni logement, se battent pour survivre.
Andy Rush a un travail, lui. Tous les jours, avec les autres policiers de sa brigade, il part disperser les émeutes de la faim qui se produisent lors de chaque nouvelle distribution de nourriture de synthèse. Alors, qu’importe si un nabab aux activités louches s’est fait descendre ? S’il parvenait à attraper le meurtrier, Andy le remercierait presque pour services rendus…
Mon avis : Parfois, un roman sort de l’anonymat pour des décennies, grâce à son adaptation au cinéma. Soleil vert est l’archétype de ce prototype d’oeuvre à laquelle un film devenu mythique a donné une seconde chance. Dans ce cas de figure, la lecture du roman, sur lequel le lecteur cinéphile va forcément plaquer des images chéries pendant des années, est presque toujours décevante.
Coup de chance : le livre d’anticipation d’ Harry Harrison échappe à cette malédiction et mérite de mener sa propre vie dans l’imaginaire des lecteurs !
Pourtant, ce n’était pas gagné : Soleil vert est un film dont les images, à la fin des années 70, ont marqué à juste raison les esprits.
Dune – Frank Herbert ( 1965)
Pocket – 832 pages – 11.50 €
Le pitch : Il n’y a pas, dans tout l’Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à perte de vue. Une seule richesse : l’épice de longue vie, née du désert, et que tout l’univers convoite.
Quand Leto Atréides reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin des guerriers Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi. Ils rêvent du prophète qui proclamera la guerre sainte et changera le cours de l’histoire.
Cependant les Révérendes Mères du Bene Gesserit poursuivent leur programme millénaire de sélection génétique , elles veulent créer un homme qui concrétisera tous les dons latents de l’espèce. Le Messie des Fremen est-il déjà né dans l’Empire ?
Mon avis : Vous connaissez Dune. Tout le monde connaît Dune. Mais l’avez-vous lu ? Mouais, c’est bien ce que je pensais : il y a beaucoup moins de lecteurs de Dune que l’on ne le pense généralement, car ce n’est pas un roman si accessible que cela.
Les 800 pages serrées de ce livre-monde (j’inclus ici Le messie de Dune, qui se trouve dans le même volume dans l’édition brochée Ailleurs et Demain de ma bibliothèque) demandent un peu d’exigence, car l’univers imaginé par Franck Herbert est d’une complexité inouïe.
En terre étrangère – Robert Heinlein (1961)
Le livre de poche – 768 pages – 8.90 €
Le pitch : Né sur Mars, Valentine Michaël Smith est retrouvé par une expédition de secours venue de la Terre : tous les membres de l’expédition ont péri et Valentine a été recueilli et élevé par les Martiens, ces curieux êtres qui peuplent la planète rouge. Smith est ramené sur Terre mais il rencontre les pires difficultés à s’intégrer dans notre société. Son apparence est humaine mais son esprit est martien.
Protégé par un écrivain célèbre et pittoresque, Jubal Harshaw, Smith réussira enfin à comprendre la place qu’il occupera sur la Terre, celle du nouveau Messie, rien de moins…
Mon avis : Comme j’ai pu l’écrire par ailleurs sur ce site, pour les vrais amateurs de SF, ceux qui bourlinguent depuis des années entre les romans du genre inventé il y a désormais plus d’un siècle par H.G. Wells et Jules Verne, Robert A. Heinlein est une référence. Sans doute un des trois piliers du mouvement hard science, en compagnie d’Isaac Asimov et d’Arthur C. Clarke. Avec 4 prix Hugo en onze ans, entre 1956 et 1967. Rien que ça.
Et, parmi tous ses romans, tous ses succès, c’est sans conteste En terre étrangère, publié en 1961, qui est à ce jour considéré comme son chef-d’oeuvre, l’acmé de sa carrière. Lu alors que j’avais une quinzaine d’années, le roman m’avait laissé une impression très favorable et, bien qu’assez confuse avec le recul, assez troublante.
Minority report – Philip K. Dick (1956)
Folio SF – 448 pages – 8.80 €
Le pitch : Douglas Quail rêve depuis toujours d’aller sur Mars, mais la planète rouge est réservée aux agents du gouvernement et aux personnalités haut placées. Il lui reste toutefois la possibilité de s’acheter des souvenirs. Et pourquoi pas celui d’être allé en visite sur Mars ? Ce ne serait pas la réalité, certes. mais qui sait ?
Après Blade Runner, le chef-d’ouvre de Ridley Scott, les textes de Philip K. Dick ont inspiré de nombreux films : Planète hurlante, Impostor, Minority Report, Paycheck, A Scanner Darkly, L’Agence…
Vous retrouverez dans ce recueil quelques-unes des nouvelles à l’origine de ces longs métrages, ainsi que Souvenirs à vendre («We Can Remember it for You Wholesale») adapté une première fois en 1990 puis de nouveau en 2012, sous le titre Total Recall.
Mon avis : Ce livre est un recueil de nouvelles. Neuf nouvelles, dans l’ensemble assez longues, dont au moins deux sont passées à la postérité pour avoir été adaptées au cinéma : The Minority report, adapté par Spielberg (les autres éditions de poche portent ce titre, avec un visuel flashy de la tête de Tom Cruise dans le film), et We can remember it for your wholesale, adapté par Verhoeven sous le titre Total recall.
Ceci posé, venons en au fait : ces neuf nouvelles (parmi les 120 écrites par Philip K. Dick au cours de sa courte vie) sont d’une lecture absolument indispensables, car elles permettent, pour celui qui ne connait pas l’auteur, d’avoir une sorte de digest très représentatif de son travail de novelliste.
Les enfants d’Icare – Arthur C.Clarke (1953)
Bragelonne – 336 pages – 7.10 €
Le pitch : Ils sont apparus sans crier gare, leurs immenses vaisseaux flottant au-dessus des plus grandes capitales mondiales.
Les Suzerains, des extraterrestres infiniment plus avancés, et qui affirment être là pour le bien de l’humanité. Et effectivement, même s’ils refusent pour le moment de se montrer, tout ce qu’ils font pour la Terre s’avère bénéfique : désarmement général, éradication des maladies, de la faim et de la misère.
Pourtant… ne faudrait-il pas se méfier de ces mystérieux bienfaiteurs ? Et se demander quelles sont leurs véritables intentions quant à l’avenir de l’espèce humaine ?
Mon avis : Arthur C. Clarke, disparu il y a dix ans, était né en décembre 1917. On a donc fêté récemment le centenaire de sa naissance. Comme le temps passe…
Cet auteur, grand journaliste scientifique par ailleurs, passionné d’astronomie et de plongée sous-marine, fut longtemps considéré comme le leader du mouvement Hard science, cette branche de la SF où les auteurs privilégient la spéculation scientifique à la prospective historique ou sociale.
Pourtant, en relisant Les enfants d’Icare, un des nombreux grands titres de Clarke, j’ai été frappé, non par la part du récit accordée à l’évolution scientifique, mais bien par sa dimension métaphysique !
Fahrenheit 451 – Ray Bradbury (1953)
Folio SF – 224 pages – 5.90 €
Le pitch : Montag est un pompier du futur d’un genre particulier : il brûle les livres.
Jusqu’au jour où il se met à en lire, refuse le bonheur obligatoire et rêve d’un monde perdu où la littérature et l’imaginaire ne seraient pas bannis. Devenant du coup un dangereux criminel…
Mon avis : Comme j’ai pu l’écrire par ailleurs, Ray Bradbury est sans conteste un des auteurs majeurs de toute l’histoire de la science-fiction.
Farenheit 451 est son roman le plus célèbre, son talent s’étant épanoui surtout dans le format des nouvelles (y compris Chroniques martiennes, qui est un recueil de nouvelles).
Ce roman est d’une beauté et d’une tristesse sidérante, dont François Truffaut sut saisir l’essentiel dans son adaptation qui date déjà de cinquante ans (comme le temps passe…).
Demain les chiens – Clifford D. Simak (1952)
J’ai lu – 283 pages – 8.00 €
Le pitch : Les hommes ont disparu depuis si longtemps de la surface de la Terre que la civilisation canine, qui les a remplacés, peine à se les rappeler. Ont-ils véritablement existé ou ne sont-ils qu’une invention des conteurs, une belle histoire que les chiens se racontent à la veillée pour chasser les ténèbres qui menacent d’engloutir leur propre culture ?
Fable moderne, portrait doux-amer d’une humanité à la dérive, Demain les chiens est devenu un classique de la littérature. Il est ici publié dans une nouvelle traduction, avec l’épilogue ajouté ultérieurement par l’auteur et une postface de Robert Silverberg.
Mon avis : Demain les chiens est l’oeuvre la plus célèbre de Clifford D. Simack, un des maîtres de la SF classique américaine. En relisant pour la troisième ou quatrième fois ce faux recueil de nouvelles, j’ai retrouvé toutes les sensations qui m’avaient marqué profondément, dès ma première lecture, alors que j’étais adolescent.
Demain les chiens est en fait un roman, composé de huit récits sans lien direct entre eux (d’où cette notion de « nouvelles » souvent utilisée à leur propos), mis en perspective historiquement par un système de « notes » , rédigées par ce qu’on imagine être un historien. Cette composition, particulièrement habile et rarement pratiquée dans la littérature, permet à l’auteur de retracer en tout juste 300 pages l’histoire de la fin de l’humanité.
Effacement progressif de l’homme, au bénéfice d’autres espèces animales, dont – en majeure – les chiens. Cet effacement résulte d’une succession de choix et décisions improbables de quelques humains à des moments clés.
Cycle de Fondation (1) – Isaac Asimov (1951)
Folio SF – 832 pages – 14.90 €
Le pitch : Grâce à la psychohistoire qu’il a inventée, Hari Seldon prévoit l’effondrement de l’Empire galactique, suivi d’une ère de ténèbres de trente mille ans. Seule solution pour réduire cette période à mille ans : la Fondation.
Mais celle-ci a de nombreux et puissants ennemis…
Mon avis : Le cycle de Fondation est un des dix chefs-d’oeuvre de la science-fiction, écrit par Isaac Asimov, l’homme à la plume prolifique qui fut, pendant une trentaine d’année, le patriarche absolu du genre, respecté par tous pour, au moins, deux inventions majeures : les trois règles de la robotique, dans sa série de nouvelles sur les robots, et la psychohistoire, dans Fondation .
Cette intégrale éditée par Folio SF (qu’il faut remercier de ses efforts actuels pour remettre « en ligne » dans les meilleurs conditions les œuvres fondamentales du genre), regroupe la trilogie originelle du cycle, composée des romans Fondation, Fondation et empire et Seconde fondation (vous pouvez vous arrêter là, les romans écrits beaucoup plus tard par Asimov, sous la pression du succès commercial, sont dispensables).
Cette trilogie, qui a remporté en 1966 le prix Hugo spécial de la meilleure série de science-fiction/fantasy de tous les temps, stupéfie le lecteur par son ambition, son ampleur et son intelligence. Constitué, en fait, d’une dizaine de nouvelles qui couvrent le futur de l’histoire humaine, l’oeuvre est un sommet de la science fiction intelligente des années 60, époque où les meilleurs auteurs du genre utilisaient le futur pour réfléchir sur l’histoire et l’humanité.
Plongez-vous dans ce récit passionnante, vous ne pourrez ensuite oublier des personnages comme le Mulet…
♠ Les autres sélections et articles du
Tourne Page sur la littérature anglo-saxonne ♠
Racisme : les grands livres américains
sur les minorités noires et indiennes
Westerns : les meilleurs romans et BD sur l’ouest américain
Etats-Unis : le meilleur des romans du sud profond (deep south)
Les meilleurs romans britanniques
♠
Le coin cadeau ** Les livres du jour**L’actualité des sorties
**Les meilleures ventes** La vie d’un lecteur
Rappel : Le modèle économique du Tourne Page repose sur le principe de l’affiliation. En cliquant sur le lien permettant d’accéder au partenaire du Tourne Page, Amazon, pour acquérir un livre conseillé, le visiteur permet au Tourne Page de percevoir une commission sur le chiffre d’affaires réalisé par son intermédiaire.
Le Tourne Page a été créé pour la promotion du livre et de la lecture. Pour que l’entreprise puisse vivre et prospérer (elle représente un investissement en temps quotidien considérable) mais aussi pour qu’elle garde son indépendance, il est essentiel que les visiteurs passent par ces liens pour acheter les livres qu’ils ont identifié sur le site.
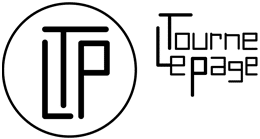
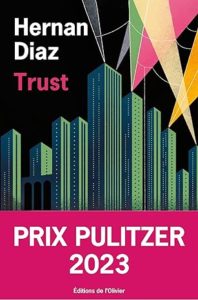
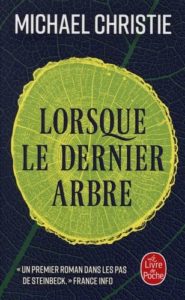
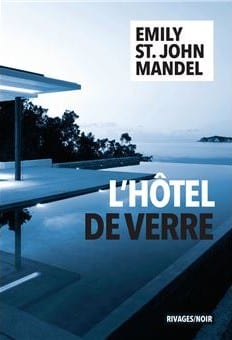
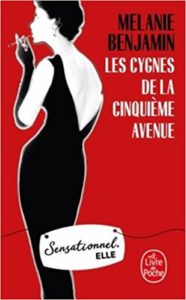
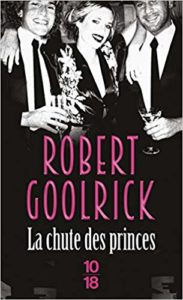

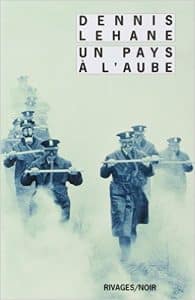

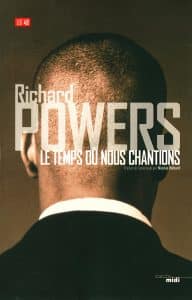
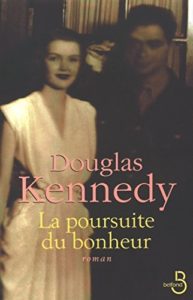

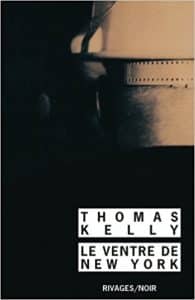

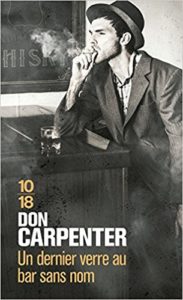
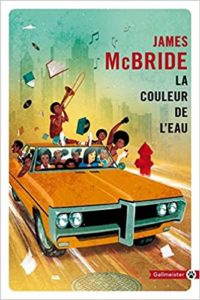

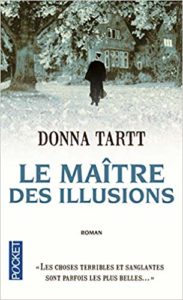
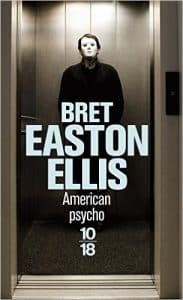




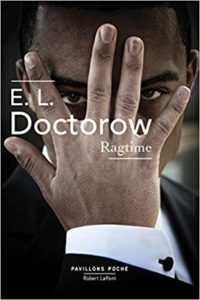

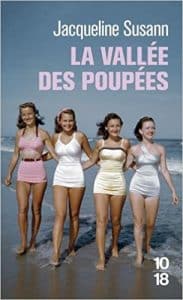
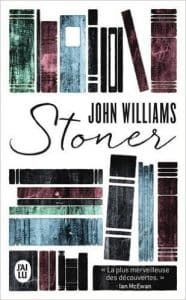


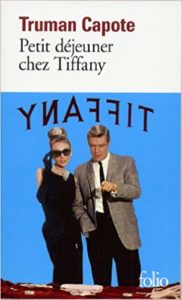
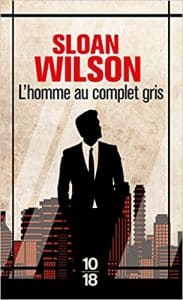
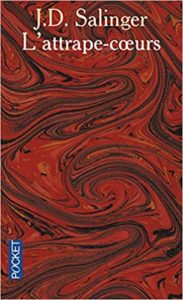

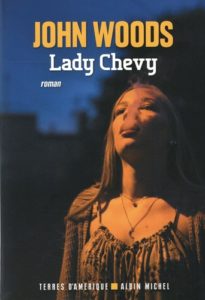

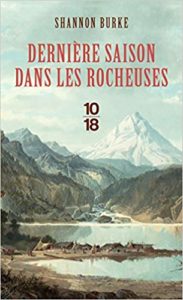
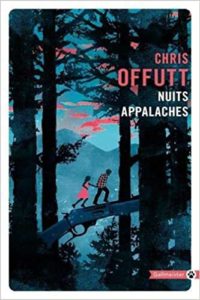
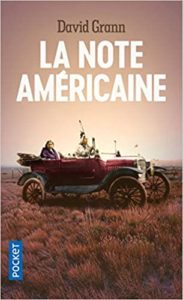


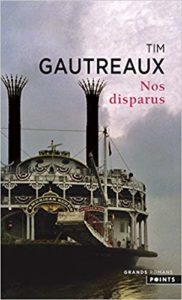

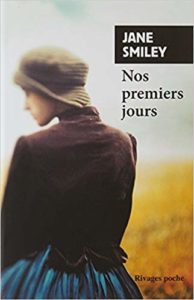
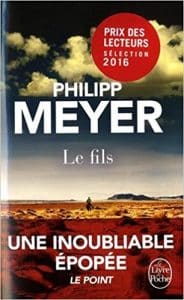
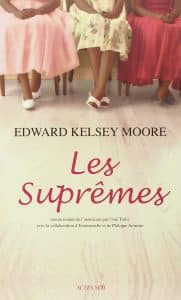
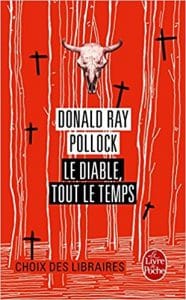
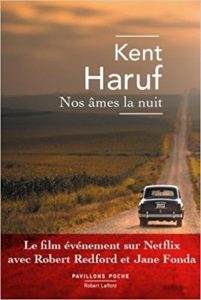
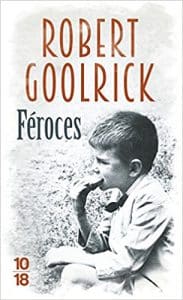
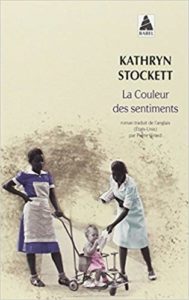
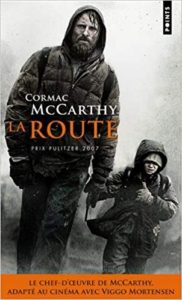
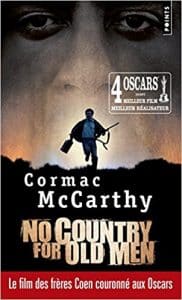

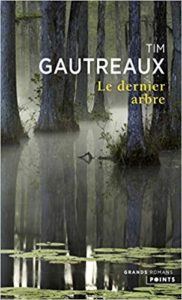
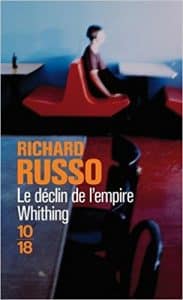
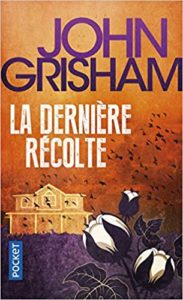
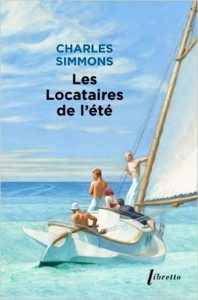
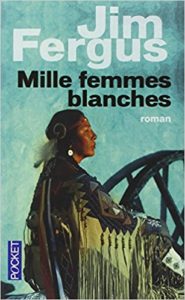
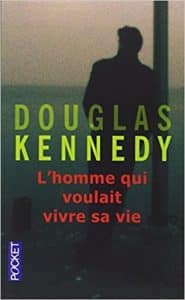
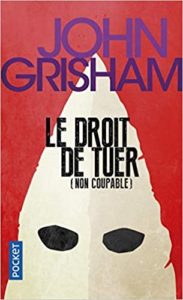

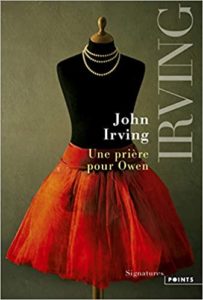
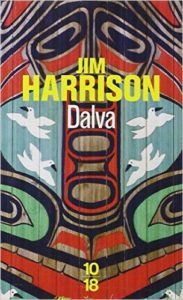

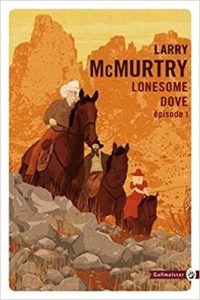
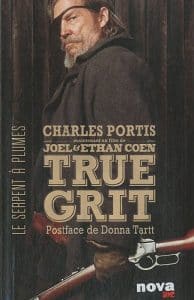
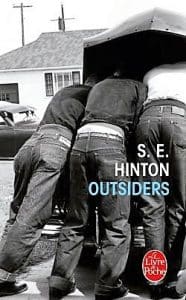



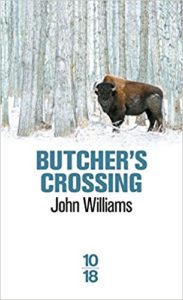
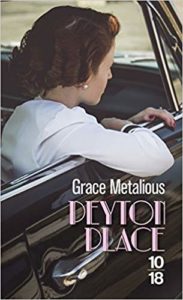
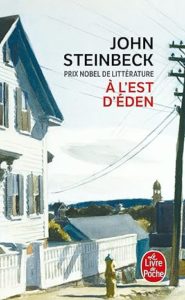
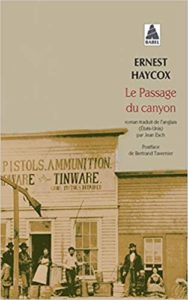
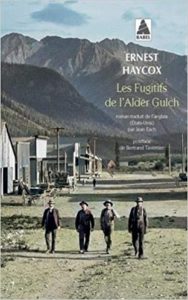
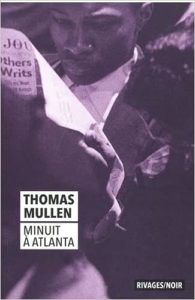
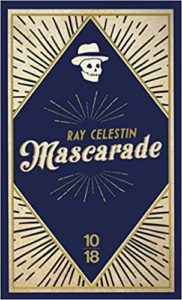
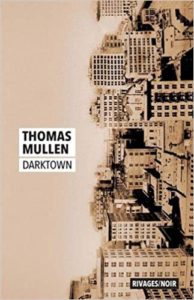
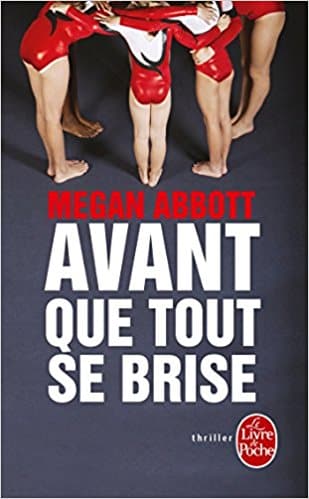
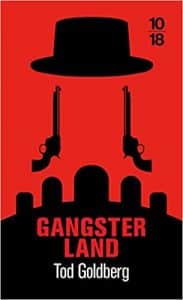
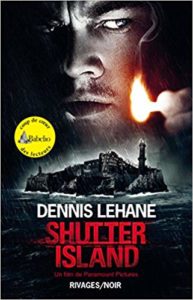

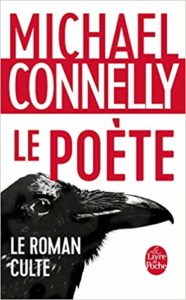
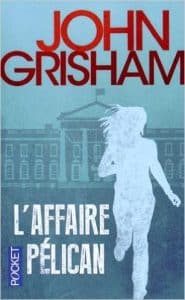
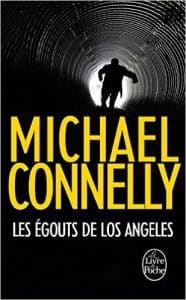
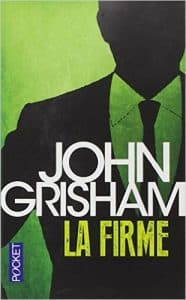
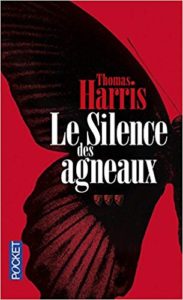

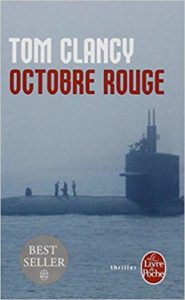
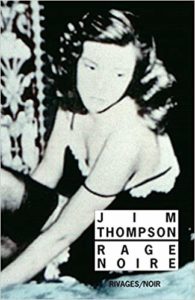
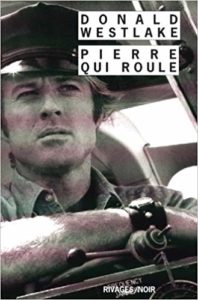
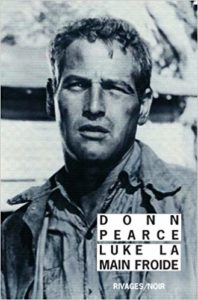
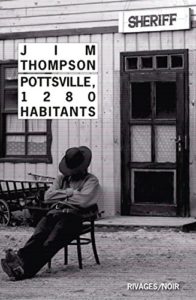
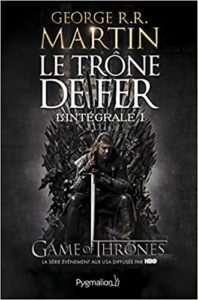
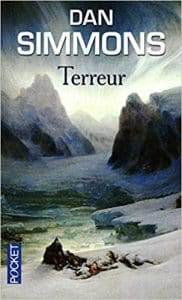
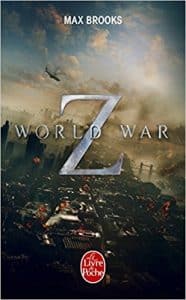

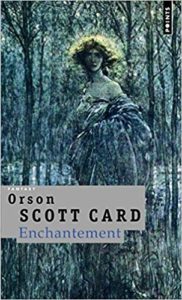
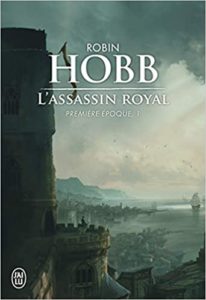
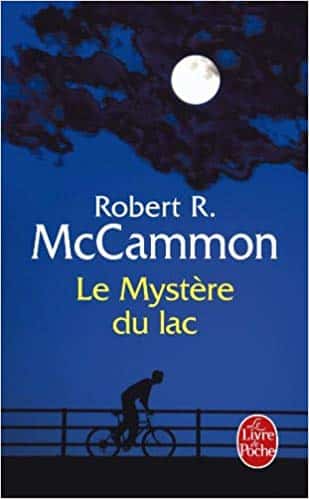

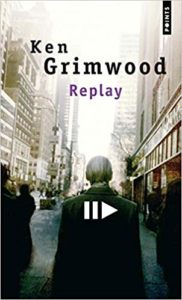
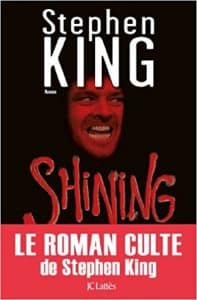
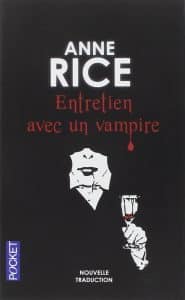

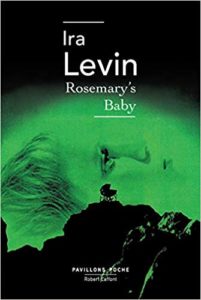

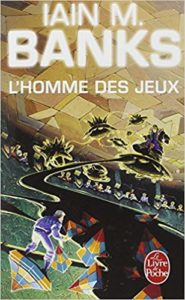

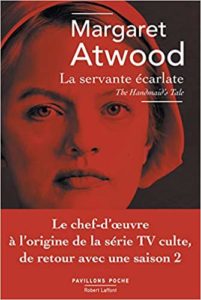



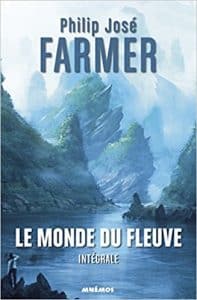
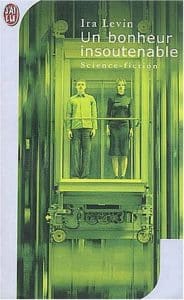
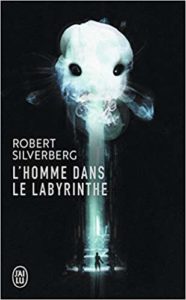
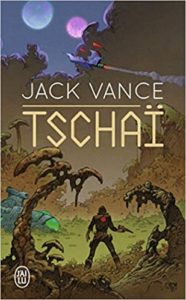


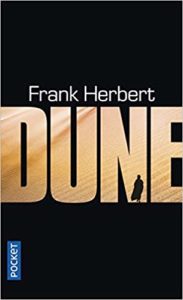



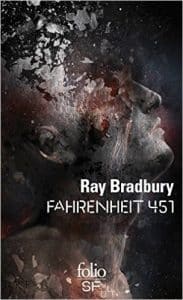
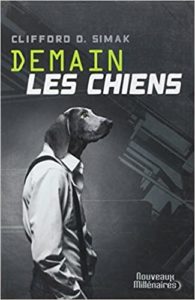
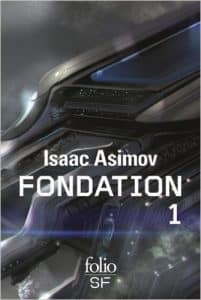
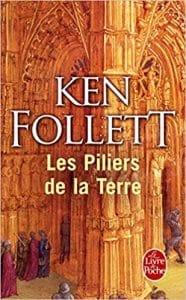
Votre sélection m’enchante
Belle sélection qui peut servir pour mon groupe de lecture, j’ai lu certains de ces livres….Depuis des années je recherche un roman américain, lu dans les années 70, donc traduit en français et paru , sans doute, dans les années 60-70; j’ai malheureusement oublié titre et auteur, pouvez vous m’aider ?C’est un roman plus pour les ados et jeunes adultes, une histoire triste et très émouvante d’adolescents, cela se passe sur la côte Est(Peut-être dans une île)…Peut-être cela va vous parler et pourrez me proposer quelques livres..Merci d’avance…
Merci pour votre commentaire !
En ce qui concerne votre colle, cela va être difficile avec si peu de précisions. Le seul livre que m’évoque votre description est « Sa majesté des mouches » de William Golding (auteur anglais, mais une histoire triste pour adolescents sur une île), d’ailleurs critiqué sur ce site. Si cela peut vous aider…
Bravo pour votre ouverture d’esprit et votre éclectisme. J’adore la littérature américaine et c’est de loin la sélection la plus intéressante que j’ai pu trouver.
Enfin une sélection large et qui affirme sa personnalité !
Merci beaucoup pour ces encouragements !
Hi, I’m from the US. Sorry for the bad French, I used Google Translate. Great list! I haven’t heard of a lot of these myself. If you’re looking for more good American literature, I’d recommend checking out Charles Bukowski. His books include « Ham on Rye », « Post Office », and « Women. » One of his literary inspirations was Louis-Ferdinand Céline.
Bonjour, je viens des États-Unis. Désolé pour le mauvais français, j’ai utilisé Google Translate. Grande liste! Je n’en ai pas entendu beaucoup moi-même. Si vous cherchez plus de bonne littérature américaine, je vous conseillerais de consulter Charles Bukowski. Ses livres incluent « Ham on Rye », « Post Office » et « Women ». Louis-Ferdinand Céline fut l’une de ses inspirations littéraires.
Thank you very much for the compliment, glad that this list (not exhaustive) interests you. I have not read Bukowski since my adolescence (he is well known in France for an alcoholic scandal he had made in a very popular literary show), your suggestion makes me want to get back to it! Note: I also use a lot of Google trad!
Merci beaucoup pour le compliment, ravi que cette liste (non exhaustive) vous intéresse. Je n’ai pas lu Bukowski depuis mon adolescence (il est très connu en France pour un scandale alcoolisé qu’il avait fait dans une émission littéraire très populaire), votre suggestion me donne envie de m’y remettre ! A noter : j’utilise aussi beaucoup Google trad !
Belle sélection. J’en ai lu beaucoup, et parcourir cette liste m’a donné envie d’en relire avec parfois 30 ans de plus. Je partage sans réserve la plupart de vos avis.
Merci beaucoup. C’est bien mon objectif : donner envie !
Il manque sur votre liste, au demeurant remarquable, Roth, ellroy et bukowski
Merci pour votre appréciation !
En fait, cette sélection est un « work in progress » que je vais encore nourrir avec de nouveaux noms et nouveaux titres dont, entre autres, Ellroy, Bukowsky, mais aussi Auster, Irving, Harrison, Oates, et ce n’est pas fini !
Bonjour merci pour ces idées de lecture passionnantes. Pourriez-vous nous concocter une série sur l’esclavage par exemple. Merci beaucoup
C’est une excellente idée… qui correspond en grande partie à un de mes projets d’article, les romans américains consacrés aux minorités. A venir bientôt !
Bonjour,
Bravo et merci à vous pour cette liste que j’ai bien l’intention de consulter attentivement et régulièrement. ..
Une critique cependant : nombre de ces ouvrages conseillés sont de véritables « pavés » 7oo,800, plus de 1000 p. parfois …Si je veux découvrir Soljenitsyne, je commencerais par « Une journée d’Ivan Denissovitch » plutôt que l’ Archipel …, non ?
Merci beaucoup pour le compliment ! Je comprends votre remarque mais mon intention était de présenter les livres qui, à mon avis, ressortaient dans l’histoire de la littérature américaine au cours des dernières 75 années.
Le hasard fait qu’effectivement, nombre de ces romans sont très épais… Mais, pour reprendre votre analogie, si je devais réaliser le même travail pour la littérature russe, ce n’est pas « Une journée.. » que je mettrais en exergue chez Soljenitsyne, mais bien « L’archipel… », « Le pavillon des cancéreux » et « Le premier cercle », tous comportant de 800 à 1 000 pages !
Bonjour, je recherche une trilogie sur l’arrivée et l’installation d’une famille de colons en Amérique , lue dans les années 60 mais sûrement plus ancienne .
» Les bois , les champs , la ville »
Merci d’avance
Soisik S
James Baldwin est un auteur incontournable de la littérature afro-américaine que je vous conseille vivement.
Merci pour cette très chouette liste, très variée ! Le thème de mon prochain club de lecture est « la littérature américaine », j’ai trouvé plein d’idées grâce à vous 🙂
Par contre, je me dois d’éliminer Margaret Atwood de la liste, elle est canadienne ! 🙁
C’est un plaisir si j’ai pu vous donner des pistes de lecture, c’était l’objectif visé !
Pour Margaret Atwood, c’est une « nord » américaine, n’est-ce pas ? J’ai triché une, ou plutôt deux fois, dans cette sélection. Quelque part se cache une anglaise… à vous de trouver !
Mais où est donc passé Paul Auster ?!
Juste ! Mais work in progress signifie que tout n’est pas terminé… Quoiqu’il en soit, oubli réparé. Merci.
Bonjour, je conseille aussi vivement les romans de Pat Conroy et particulièrement Beach music !!
Bonjour,
Toutes mes félicitations pour votre liste des meilleurs romans américains contemporains!
Puis-je me permettre d’y ajouter « Le Prince des Marées », de Pat Conroy, et « La source Vive » et « La Grève » d’Ayn Rand, qu’en pensez-vous?
Cordialement,
Philippe
Merci pour vos encouragements !
En ce qui concerne « Le prince des marées », je n’ai pas du tout (mais pas du tout !) accroché lors de sa lecture, il y a déjà pas mal d’années.
Pour Ayn Rand, eh bien… je ne la connaissais pas ! Votre conseil m’a donné envie d’essayer. Merci !
Sincèrement impressionné par la sélection et la richesse de vos commentaires, je voulais néanmoins rendre hommage à James Michener, notamment à travers deux romans époustouflants : Colorado saga (1974) et Chesapeake (1978).
Votre passion est à partager dans toutes les écoles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour vos encouragements !
En ce qui concerne James Michener, je me rappelle avoir été impressionné par l’ampleur de Colorado Saga, lu durant mon adolescence, avec cette manière unique de raconter l’histoire d’un pays au travers des siècles. Cela me donne envie de m’y remettre !
Super sélection ! J’y ajouterai le démon de Hubert selby junior et bien sûr ce bon vieux buck
Belle sélection très éclectique mais il manque quand même Philip Roth
Bonjour,
Pette anecdote : il y a trois jours, voyant avec horreur que j’étais sur le point de terminer mon livre, j’ai essayé de trouver sur internet des conseils pour des romans américains, dont je me délecte depuis tant d’années, et je suis tombé sur votre site. Un bonheur ! qui a aussi fait du bien à mon égo, ayant constaté que j’avais déjà lu une bonne partie de votre sélection -;) Bref, quelques heures plus tard, j’étais à la FNAC pour acheter deux livres de votre liste. Merci beaucoup !
Quelques conseils également pour agrémenter votre liste :
– Le seigneur des porcheries de Tristan Egolf, une véritable petite pépite, une sorte de Comte de Monte-Cristo des temps modernes, version américaine ;
– My Absolute Darling de Gabriel Tallent, un vrai poing dans la face, le genre de livre absolument impossible à oublier une fois lu ; attention, âmes sensibles s’abstenir !
– au moins un roman de l’immense Tolkien !! Bilbo le Hobbit, le Seigneur de Anneaux, le Silmarillion…
– Le gang de la clé à molette, d’Edward Abbey (raison de la découverte de votre site…), l’histoire de quatre huluberlus partis dans une mission de sabotage d’infrastructures (ponts, barrages, lignes de chemins de fer…) dans l’Utah pour protester contre la destruction de l’environnement par l’urbanisation. Excellentissime !
– Lolita, de Nabokov, qu’on ne présente plus, un vrai chef d’œuvre…
J’en oublie bien sûr… En tout cas, encore merci et bravo pour cette remarquable sélection !
Bonjour,
Merci pour ces compliments, qui me réchauffent le coeur, comme on dit ! 🙂
Je ne connais pas le seigneur des porcheries, que je vais découvrir.
Je n’ai pas placé Nabokov dans ma sélection (je parle de Lolita à plusieurs reprises sur le site) car il est avant tout russe, avant de devenir américain. Quant à Tolkien, ne dîtes pas aux anglais qu’il est américain, voyons !
A ce propos, vous avez peut-être remarqué que j’ai également écrit un article équivalent sur le meilleur de la littérature britannique…
Bonne lecture !
Merci mille fois pour cette sélection. Heureuse d’y trouver à la fois des romans qui m’ont marqué et de l’envie pour les prochains. Je vous rejoins parfaitement sur la qualité de la production américaine. Si je peux vous suggérer Colson Whitehead (Underground railroad) et Ayana Mathis (les 12 tribus d’Hattie)…
Merci à mon tour pour vos encouragements !
En ce qui concerne le livre de Colson Whitehead, vous trouverez ma critique sur le site. Je ne l’ai pas placé dans ma sélection, car je l’ai trouvé un ou deux crans au dessous de sa réputation et loin derrière d’autres romans traitant du même sujet (voir ma sélection sur les romans traitant des minorités américaines). Par contre, je ne connais pas Ayana Mathis, j’irai voir chez Gallmeister, merci pour la suggestion !
Votre liste est carrément géniale, je suis moi même fan de la littérature américaine et j’ai aimé tous les livres que j’ai lus dans votre liste. Ce qui me laisse penser que ceux que je n’ai pas lus valent le détour ! Mais il manque malgré tout mon auteur préféré, Wallace stegner, en particulier son roman angle d’équilibre.
Merci pour votre message ! Quant à Wallace Stegner, voilà une piste que je vais explorer car je ne l’ai jamais lu !